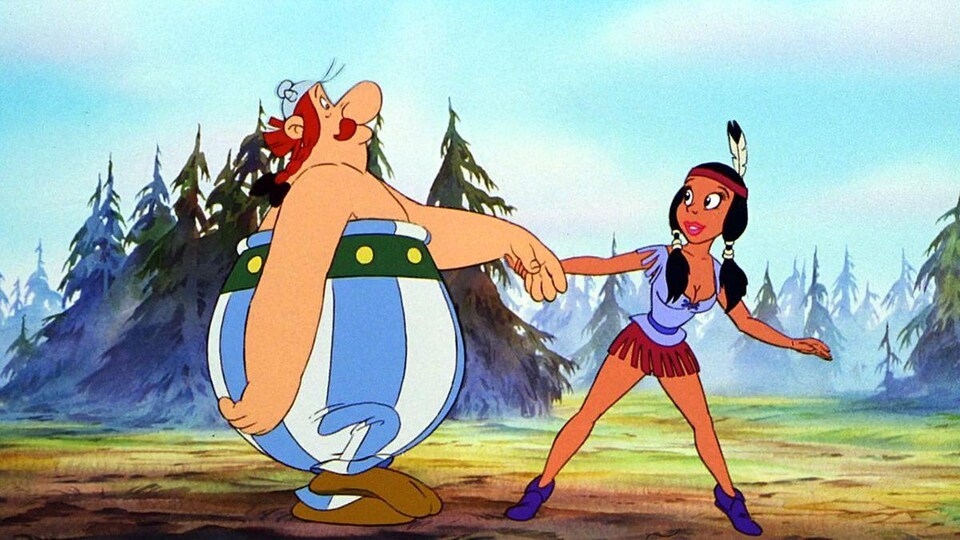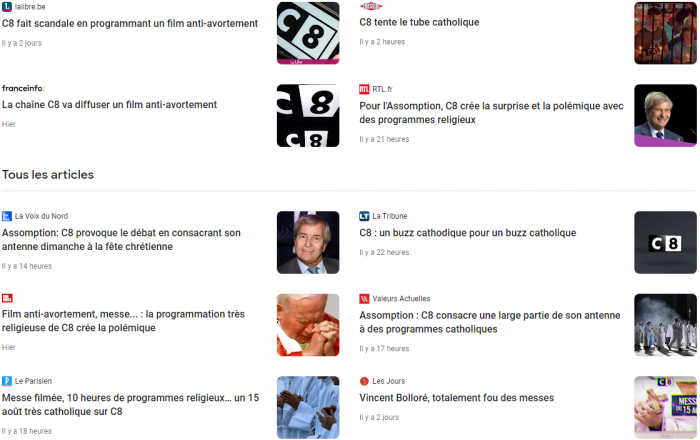D'Edward Pentin sur le National Catholic Register :
Le Saint-Siège ferait pression pour des pourparlers avec les talibans afin d'éviter une catastrophe humanitaire
Les représentants du Vatican n'ont pas souhaité faire de commentaire lorsque le Register les a contactés, mais un journaliste italien a rapporté ce week-end qu'un " canal confidentiel " avait été ouvert entre le Saint-Siège et les Talibans.
23 août 2021
CITÉ DU VATICAN - Le Saint-Siège appelle à l'ouverture de pourparlers entre les talibans, les dirigeants politiques régionaux et les pays occidentaux afin d'éviter une catastrophe humanitaire lors du retrait des forces américaines et alliées d'Afghanistan.
Dans un éditorial publié en première page le 19 août, le journal du Vatican L'Osservatore Romano affirme qu'il "sera bien sûr nécessaire de négocier avec les talibans" sur les questions de migration ainsi que sur "les droits de l'homme et les libertés fondamentales, afin qu'ils accordent à ceux qui ne se sentent pas en sécurité la possibilité de quitter l'Afghanistan". Il ajoute que ces pourparlers "doivent être menés rapidement".
L'éditorial, intitulé "La responsabilité d'accueillir - la tragédie des Afghans en fuite", appelle la communauté internationale à "agir pour que la situation des réfugiés afghans ne se transforme pas en une nouvelle urgence humanitaire catastrophique".
L'article accuse également les nations "qui ont un rôle responsable en Afghanistan" de ne pas avoir prévu une telle urgence, affirmant qu'il est "surprenant" qu'un tel scénario n'ait pas été envisagé - ou pire, que les nations aient été conscientes d'une telle crise probable "et que rien n'ait été fait pour l'éviter."
L'article précède l'affirmation, ce week-end, du journaliste et lobbyiste italien chevronné Luigi Bisignani, selon laquelle un "canal confidentiel a été ouvert de manière inattendue entre le Saint-Siège et les talibans pour créer un corridor humanitaire pleinement opérationnel".
Dans une lettre adressée au quotidien italien Il Tempo et publiée le 22 août, M. Bisignani affirme que, sous l'impulsion du pape François, la Secrétairerie d'État du Vatican et la Congrégation pour les Églises orientales travaillent à un dialogue tripartite avec les talibans, sous la médiation du président turc Recep Tayyip Erdogan.
M. Bisignani a déclaré qu'un tel dialogue "pourrait miraculeusement nous aider" à la lumière d'un rapport de renseignement classifié qui circule dans les ministères du gouvernement et qui prévoit une nouvelle vague d'immigration produisant des "scénarios inquiétants" et un risque élevé d'attaques terroristes.
La prétendue initiative diplomatique du Saint-Siège fait suite à l'appel du pape François, le 15 août, à prier pour la situation en Afghanistan "afin que le vacarme des armes cesse et que des solutions puissent être trouvées autour d'une table de dialogue." Le pape n'a pas mentionné la crise en cours lors de son discours de l'Angelus du 22 août.
Le bureau de presse du Saint-Siège n'a pas répondu aux questions du Register concernant l'affirmation de M. Bisignani.
L'archevêque Paul Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, et l'archevêque Christophe El-Kassis, nonce apostolique au Pakistan, qui supervise l'Afghanistan en l'absence de liens diplomatiques officiels, n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires du Register sur l'approche du Saint-Siège, car ils sont tous deux en vacances.
Un retrait bâclé
L'administration Biden a été largement critiquée pour ce que de nombreux critiques considèrent comme un retrait bâclé qui n'a pas respecté l'accord de paix de 2020 entre les talibans et les États-Unis, a entraîné la chute inattendue du gouvernement afghan et a permis aux talibans de prendre le contrôle du pays.
Alors que le régime s'emparait de la capitale Kaboul la semaine dernière, des milliers d'Afghans ont cherché à fuir la nation musulmane. Beaucoup d'entre eux se sont dirigés vers l'aéroport de la ville, certains faisant une chute mortelle en s'accrochant à l'extérieur d'un avion militaire américain dans des tentatives désespérées de partir. Selon les rapports, environ 28 000 personnes ont été évacuées du pays depuis le 14 août.
Dans une déclaration du 19 août, le président de l'Aide à l'Église en détresse, Thomas Heine-Geldern, a déclaré que l'accord de paix de 2020 n'indiquait pas clairement comment les Afghans qui n'adhèrent pas à la pratique de la charia (loi islamique) des talibans seront traités. Il a également souligné les avantages et les inconvénients de l'approbation et de la reconnaissance internationales du régime islamiste.
Si le régime n'est pas reconnu internationalement, il n'y aura pas de "canaux officiels" pour engager le dialogue avec les Talibans sur les questions de droits de l'homme, a-t-il observé. "Le fait que la plupart des ambassades occidentales ferment, et que les observateurs internationaux partent, comme ils l'ont fait en Syrie en 2011, n'est pas de bon augure", écrit Heine-Geldern.
D'autre part, il a affirmé que les pays déclarant leur sympathie pour le nouvel émirat "non seulement contribueraient à légitimer les talibans, mais aussi à enhardir les régimes autoritaires du monde entier, en particulier dans la région, ce qui entraînerait des violations croissantes des libertés religieuses dans leurs propres pays".
Une telle approbation internationale créerait "un aimant pour les petits groupes islamiques radicaux, créant une nouvelle constellation de factions terroristes religieuses qui pourraient supplanter Al-Qaïda et l'État islamique". Heine-Geldern a prédit que la situation des chrétiens et des autres minorités religieuses "qui souffrent déjà d'oppression" dans la région allait "se détériorer davantage."
Dans une déclaration publiée le 23 août, la branche italienne de l'Aide à l'Église en détresse a averti que la menace contre la liberté religieuse en Afghanistan ne vient pas seulement des Talibans, mais aussi de l'État islamique de la province de Khorasan (ISKP), la filiale afghane de l'État islamique, et d'Al-Qaïda.
"L'ISKP continue de se consolider, notamment après la défaite d'ISIS en Syrie et en Irak et après le début des pourparlers de paix entre les talibans et l'OTAN", peut-on lire dans la déclaration de l'ACN-Italie. "Différent des talibans, l'ISKP compte dans ses rangs un nombre croissant de jeunes afghans éduqués et issus de la classe moyenne, qui sont rejoints par des groupes de djihadistes expérimentés d'Al-Qaïda."
"Nous craignons que la reconnaissance du régime taliban par certains pays n'encourage également la prolifération de groupes islamiques radicaux actuellement plus petits mais capables de se structurer en un réseau terroriste potentiellement capable de supplanter les formations historiques comme Al-Qaïda et l'État islamique", ajoute le communiqué. "En plus de cela, les relations entre le Pakistan, les organisations terroristes présentes en Palestine et dans la province syrienne d'Idlib et le régime afghan, sont particulièrement préoccupantes."
Les chrétiens en danger
L'ACN Italie s'est fait l'écho des préoccupations de Heiner-Geldern, qui craignait que la réintroduction de la charia ne "balaie les quelques libertés péniblement conquises, y compris la très fragile liberté religieuse" et elle a prédit que "tous ceux qui ne partagent pas l'islamisme des talibans, y compris les sunnites modérés, sont donc en danger."
Plus de 99 % des 27,6 millions d'habitants de l'Afghanistan sont musulmans ; la plupart sont sunnites et seulement 10 % sont chiites. Selon l'AED, le nombre de chrétiens n'est pas clair, et pourrait aller de 1 000 à 20 000, car beaucoup pratiquent leur foi en secret. En 2018, seuls environ 200 catholiques vivaient en Afghanistan.
L'organisme de bienfaisance a rappelé qu'en 2010, les talibans ont tué 10 travailleurs humanitaires accusés de diffuser le christianisme et d'être des espions étrangers. Le groupe aurait également dit aux dirigeants d'églises clandestines qu'ils étaient surveillés, et les inquiétudes se sont accrues quant au fait que des chrétiens puissent être tués, ou que des jeunes filles chrétiennes soient données en mariage à des combattants talibans.
"Même avant la prise de pouvoir par les talibans, les chrétiens convertis à l'islam étaient confrontés à l'ostracisme et même à la violence des membres de leur famille", rapporte ACN. "Au 16 août, deux jésuites indiens et quatre missionnaires de la charité attendaient d'être évacués."
Entre-temps, un groupe protestant clandestin a affirmé le 19 août que les chrétiens afghans avaient fui vers les montagnes "dans une tentative désespérée d'échapper aux talibans qui font du porte-à-porte pour les tuer". Les islamistes ont une "liste de chrétiens connus qu'ils ciblent pour les poursuivre et les tuer", affirme le rapport.
"La charia des talibans est catastrophique pour les droits de l'homme", écrit Nina Shea, directrice du Centre pour la liberté religieuse de l'Institut Hudson, dans The Epoch Times. "Sans droits fondamentaux, en fait, tout le monde risque d'être arrêté et puni arbitrairement", a ajouté Shea.
Le père Barnabite Giovanni Scalese est responsable de la Missio sui iuris en Afghanistan, la seule entité catholique du pays, créée par le pape Jean-Paul II en 2002. En avril, il a exprimé des doutes quant à la capacité des talibans à restaurer un émirat islamique, mais comme beaucoup, il n'a pas non plus prédit la chute du gouvernement afghan.
S'adressant au Register la semaine dernière, le père Scalese a déclaré que le pays traversait un "moment très difficile" mais n'a pas voulu en dire plus en raison de la sensibilité de la situation.
Il a ajouté : "La seule chose que je peux vous dire, c'est de prier pour nous".