De Samuel Pruvot sur le site de Famille Chrétienne :
François Fillon : « le choc des civilisations est en germe »
EXCLUSIF MAG - En déplacement au Proche-Orient, le candidat aux primaires de la droite dénonce le communautarisme qui bloque aujourd’hui le Liban et qui pourrait demain s’exporter en France. Entretien.
Le déclin du modèle libanais signe-t-il l’échec du Pacte national de 1943 (à savoir faire adhérer les musulmans à une identité qui dépasse l’appartenance confessionnelle) ?
Chaque fois que je vais au Liban, je suis partagé. D’un côté, il y a le pessimisme lié au constat de la persistance des conflits et, de l’autre, l’optimisme dégagé par tous ces Libanais que je rencontre. Dans ce Liban fragile, il y a des espoirs de renaissance puis des temps de déprime comme aujourd’hui.
Cela dit, si le Hezbollah avait vraiment la volonté de déstabiliser et de mettre la main sur le Liban, il aurait les moyens de le faire. Le Pacte national est toujours vivant malgré tout.
Quelle est la marge de manœuvre des chrétiens libanais, devenus minoritaires même au Liban ?
Le plus désespérant, c’est leur division. Leur seule chance de conserver une influence est de faire preuve d’un minimum d’unité. Je ne parle pas d’un réflexe d’autodéfense, mais d’une volonté de peser dans le jeu politique. Il est évident que les autres camps – sunnites et chiites – jouent de leurs divisions.
Cette situation rappelle des épisodes très anciens… Souvenons-nous que dans un tout autre contexte, celui des croisades, les chrétiens ont payé au prix fort leurs rivalités. Pour revenir à l’actualité, je crois qu’il existe une société civile libanaise plus apte à dépasser les affrontements communautaires que les clans politiques du pays.
Michel Aoun, homme d’État libanais, a confié à famillechretienne.fr son inquiétude face à la présence de 1,5 million de réfugiés : « Qui peut recevoir un nombre de réfugiés qui correspond à la moitié de sa population ? » Y a-t-il un risque de nouvelle guerre civile ?
Ce pays est capable de résister à tout. Il fait preuve d’une résilience extraordinaire ! Mais il y a ici une injustice criante qui devrait faire honte aux Européens et aux Américains : notre incapacité à appréhender correctement la crise syrienne qui est à l’origine de la crise migratoire. Remontons le temps. S’il n’y avait pas eu la décision funeste de M. Bush d’intervenir en Irak, il n’y aurait pas eu de déstabilisation et aujourd’hui d’État d’islamique.
L’entêtement de notre diplomatie à ne voir dans la crise syrienne qu’une révolution populaire contre un tyran doit cesser. En fait, rapidement s’est créé un affrontement entre communautés, une guerre civile dans laquelle chaque belligérant a ses soutiens. La France porte une part de responsabilité dans la crise actuelle. Le gouvernement français n’a cessé de clamer que Bachar el-Assad allait s’effondrer d’une minute à l’autre, mais cela fait quatre années que ça dure. Il y a donc quelque chose de faux dans notre diplomatie.

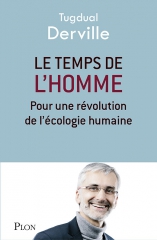
 De Riccardo Cascioli sur le site de la nuova bussola quotidiana
De Riccardo Cascioli sur le site de la nuova bussola quotidiana