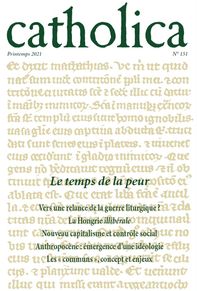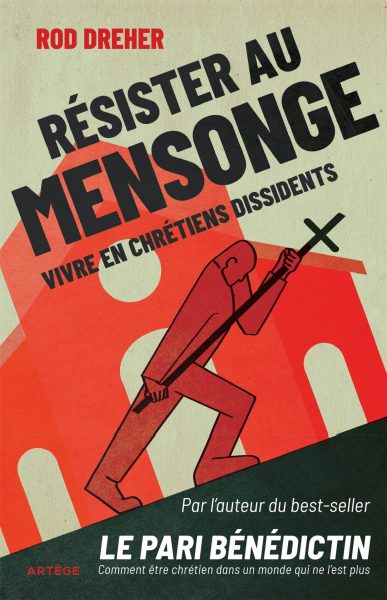Du site "Pour une école libre au Québec" :
La Révolution racialiste, et autres virus idéologiques (recension)
8 avril 2021
Mathieu Bock-Côté, sociologue bien connu, va publier un nouvel essai à Paris le 15 avril 2021. Voici la recension de son nouvel ouvrage par Michel de Jaeghere publiée dans Le Figaro Histoire (avril-mai 2021).
IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
Nous croyons trop souvent avoir affaire à des échappés de l’asile.
Devant les délires de la cancel culture [culture du bâillon], le boycottage vertueux de Sylviane Agacinski, l’interruption violente des représentations d’une pièce d’Eschyle, ou la justification balbutiante de réunions non mixtes, réservées aux « non-Blancs », par la présidente de l’Unef, nous avons le sentiment d’assister à de déplorables sorties de route, témoignant que la montée de l’intolérance est corrélée à celle de la bêtise. Nous sourions de l’extension illimitée du domaine de la lutte. De la multiplication des phobies traquées par les experts auto proclamés de la sociologie comme par leurs servants du monde médiatique, vigilants de la conscience morale ou professionnels de l’indignation, vérificateurs de faits du politiquement correct associant l’arrogance du bas clergé à la science confuse de Diafoirus, et prompts à recueillir les humeurs des représentants des minorités ethniques ou sexuelles avec une servilité de domestiques.La Révolution racialiste, le nouveau livre de Mathieu Bock-Côté, vient mettre fin à notre insouciance. Il nous révèle qu’il ne suffit pas d’éteindre nos télévisions non plus que de déserter les réseaux sociaux pour échapper au cirque. Les thèmes mis en circulation, depuis cinquante ans, par les tenants du décolonialisme, pourfendeurs du racisme systémique ou militants de l’indigénisme qui ont prospéré sur les campus américains ou dans les universités françaises, ne relèvent pas d’une polémique absurde. Ils forment une « idéologie toxique », un corpus doctrinal d’une cohérence redoutable.