Autre pays, autre discours. Au Royaume-Uni, le premier ministre n'hésite pas à revendiquer l'appartenance de son pays au christianisme.
"La Grande-Bretagne, pays chrétien, ne doit pas avoir peur de le dire
400 ans de la « King James Bible », discours de David Cameron
ROME, jeudi 12 janvier 2012 (ZENIT.org) – « La Grande-Bretagne est un pays chrétien et personne ne doit avoir peur de le dire », a déclaré le Premier ministre anglais David Cameron lors d’un discours à Oxford à l’occasion des 400 ans de la traduction de la bible en anglais attribuée au roi Jacques Ier d’Angleterre. Il insiste sur le fait que c’est justement « la tolérance que le christianisme exige de notre société » qui « donne plus de place aux autres religions » en Grande Bretagne
Des extraits de ce discours, prononcé le 16 décembre dernier, sont publiés par le quotidien du Saint-Siège, L’Osservatore Romano en italien de ce 12 janvier 2012, sous le titre : « La Bible qui fit l’Angleterre ».
Le Premier ministre ouvre son discours expliquant ouvertement que son intervention n’est pas celle d’un « fervent chrétien en mission pour convertir le monde » mais celle d’un Premier ministre qui estime qu’il est « juste de reconnaître » l’impact qu’a eu cette traduction sur le pays et dans le monde entier.
Lire la suite
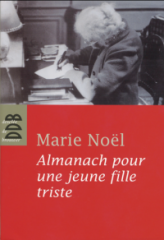 La récente édition de "l'Almanach pour une jeune fille triste" a remis - et ce n'est que justice - Marie Noël à l'honneur.
La récente édition de "l'Almanach pour une jeune fille triste" a remis - et ce n'est que justice - Marie Noël à l'honneur.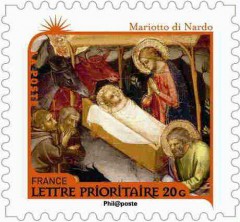 HISTOIRE VÉCUE ET RÉVÉLATRICE A LA POSTE DE GIVET
HISTOIRE VÉCUE ET RÉVÉLATRICE A LA POSTE DE GIVET La Revue « Canticum Novum », organe de l’Académie de Chant grégorien de Belgique a interrogé à ce sujet le directeur du Festival de Watou qui réuni tous les trois ans des milliers de festivaliers autour des auditions et des liturgies animées par plus de 25 chorales venues du monde entier. Un événement musical et religieux unique en son genre qui aura pour thème cette année : « Unam petii a Domino » , illustrant le désir de Dieu au cœur de l’homme.
La Revue « Canticum Novum », organe de l’Académie de Chant grégorien de Belgique a interrogé à ce sujet le directeur du Festival de Watou qui réuni tous les trois ans des milliers de festivaliers autour des auditions et des liturgies animées par plus de 25 chorales venues du monde entier. Un événement musical et religieux unique en son genre qui aura pour thème cette année : « Unam petii a Domino » , illustrant le désir de Dieu au cœur de l’homme.