De Canal Académie :
Où est la spécificité de la conception chrétienne du salut ?
12 janvier 2022
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
De Canal Académie :
Où est la spécificité de la conception chrétienne du salut ?
12 janvier 2022
De Christel Juquois sur le site du journal La Croix :
« Les reliques du Christ », de Nicolas Guyard : entre le réel et le merveilleux
À travers l’histoire des reliques, c’est celle de toute la chrétienté que raconte ce livre qui fourmille de détails et d’anecdotes
12/01/2022
Les reliques du Christ. Une histoire du sacré en Occident
de Nicolas Guyard
Cerf, 312 p., 24 €
Évoquer les reliques appelle aujourd’hui le sourire indulgent ou l’ironie grinçante. Mais réveille aussi, parfois, la fascination pour ces objets merveilleux qui ont traversé bien des époques et bien des lieux. Maître de conférences à l’université de Montpellier, spécialiste du sacré, l’auteur interroge dans ce livre l’histoire des reliques. Pourquoi tant de rois, d’empereurs ou d’abbés ont-ils acquis autant de ces objets et à de tels prix ? Quelles relations y a-t-il entre les reliques et la construction religieuse, politique et culturelle des sociétés chrétiennes ?
Terre Sainte
La légende de « l’invention » (c’est-à-dire de la découverte) des reliques de la Passion au IVe siècle par la mère de l’empereur Constantin à Jérusalem, diffusée notamment par Ambroise de Milan, renforce et valorise le goût naissant pour les pèlerinages en Terre sainte. Elle assoit aussi le pouvoir de l’empereur : « Le couple Hélène-Constantin, mère-fils, (…) devient, sous la plume d’Ambroise, un écho de celui formé par la Vierge et son Fils. »
De nombreux pèlerins rapportent alors en Occident des objets de Terre sainte. Quand Jérusalem est menacée par les conquêtes musulmanes, les plus précieux sont mis à l’abri à Constantinople, qui les offrira ou les revendra plus tard aux princes d’Occident. C’est ainsi que peu à peu, avec les reliques, « l’essentiel de la puissance sacrale de Jérusalem » se déplace vers Rome, Aix-la-Chapelle ou Paris, légitimant le pouvoir des empereurs et des rois.
« Saint Sang »
Les reliques se multiplient à profusion. Le XIIe siècle s’emballe pour le « Saint Sang » du Christ, invitant les fidèles à « associer la matérialité d’une relique et la spiritualité d’une dévotion centrée autour des mystères de l’Eucharistie ». L’acquisition à grands frais par Louis IX de la couronne d’épines témoigne aussi des évolutions de la dévotion chrétienne : « Si la relique de la Vraie Croix renvoyait depuis Constantin à l’image d’un Christ victorieux accompagnant l’empereur dans ses succès, la Couronne d’épines possède une connotation beaucoup plus doloriste, insistant sur les souffrances et la mort de Jésus. »
→ À LIRE. Pourquoi met-on des reliques dans les autels ?
« Au début du XVIe siècle, l’Occident chrétien est saturé de sacré en général, et de reliques du Christ en particulier. » La Réforme protestante, qui promeut une religion « intériorisée et spiritualisée », n’y voit que superstition et idolâtrie. L’Église catholique n’a pas d’arguments théologiques à lui opposer. Mais, au XVIIe siècle, quelques jésuites prennent la défense des reliques. Ils cherchent à en retracer l’histoire et à prouver leur authenticité, qui devient « désormais autant affaire d’érudition que d’engagement d’une autorité ecclésiastique ».
Polémiques érudites
Cependant, « cette production massive d’histoires de reliques et de sanctuaires ouvre la porte à des polémiques érudites, autour notamment des méthodes de production de connaissances historiques et authentiques », mettant en cause l’authenticité qu’elle voulait prouver. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières verront dans les reliques « la preuve éclatante des ténèbres apportées par le monde ecclésiastique sur les esprits de leurs fidèles ».
La Révolution française provoquera quelques destructions, mais aussi le déplacement et le sauvetage de nombreux objets sacrés. Même si le culte des reliques connaît un certain regain au XIXe siècle, le clergé s’en désintéresse peu à peu et les relègue au rang de la piété populaire. Quant au XXe siècle, c’est à la science que les ardents défenseurs des reliques s’adressent désormais pour les authentifier, pendant que certains objets quittent les églises pour rejoindre les musées. Tendant ainsi à effacer « la frontière entre cultuel et culturel ».
Ce livre se lit comme une épopée. Fourmillant de détails et d’anecdotes sans prétendre à une impossible exhaustivité, richement sourcé, il dessine à travers l’histoire des reliques celle de toute la chrétienté. Interrogeant notre rapport au sacré, et les relations qu’entretiennent le matériel et le spirituel dans une religion de l’Incarnation, qui croit en un Dieu qui s’est vraiment fait homme.
La loi dite « Gaillot » vient d’être adoptée (le 30 novembre 2021) en 2nde lecture à l’Assemblée Nationale.
Elle contient notamment :
La vie humaine n’a jamais été autant attaquée !
La vie humaine vous attend nombreux, pour une Marche historique.
De Francis X. Rocca, Luciana Magalhaes et Samantha Pearson sur le site du Wall Street Journal :
Pourquoi l'Église catholique perd l'Amérique latine
Les pentecôtistes conservateurs font d'énormes progrès malgré le premier pape de la région ; le Brésil est sur le point de devenir une minorité catholique dès cette année.
11 janv. 2022
RIO DE JANEIRO-Tatiana Aparecida de Jesus avait l'habitude d'arpenter les rues de la ville en tant que travailleuse du sexe, défoncée au crack. L'année dernière, cette mère de cinq enfants a rejoint une petite congrégation pentecôtiste du centre-ville de Rio, appelée Sanctification in the Lord, et a laissé son ancienne vie derrière elle.
"Le pasteur m'a serrée dans ses bras sans rien demander", a déclaré Mme de Jesus, 41 ans, qui a été élevée dans la religion catholique et fait partie du million de Brésiliens qui ont rejoint une église évangélique ou pentecôtiste depuis le début de la pandémie, selon les chercheurs. Lorsque vous êtes pauvre, le fait que quelqu'un vous dise simplement "bonjour", "bon après-midi" ou vous serre la main fait toute la différence", a-t-elle déclaré.
Pendant des siècles, être latino-américain, c'était être catholique ; la religion n'avait pratiquement aucune concurrence. Aujourd'hui, le catholicisme a perdu des adhérents au profit d'autres religions dans la région, en particulier le pentecôtisme, et plus récemment dans les rangs des non-chrétiens. Ce changement s'est poursuivi sous le premier pape latino-américain.
Sept pays de la région - l'Uruguay, la République dominicaine et cinq pays d'Amérique centrale - comptaient une majorité de non-catholiques en 2018, selon une enquête de Latinobarómetro, un institut de sondage basé au Chili. Dans une étape symbolique, le Brésil, qui compte le plus de catholiques de tous les pays du monde, devrait devenir minoritairement catholique dès cette année, selon les estimations d'universitaires qui suivent l'affiliation religieuse.
Dans l'État de Rio, c'est déjà le cas. Les catholiques représentent 46 % de la population, selon le dernier recensement national de 2010, et un peu plus d'un tiers de certaines favelas, ou bidonvilles, frappées par la pauvreté.
"Le Vatican est en train de perdre le plus grand pays catholique du monde - c'est une perte énorme, irréversible", a déclaré José Eustáquio Diniz Alves, démographe brésilien de renom et ancien professeur à l'agence nationale de statistiques. Au rythme actuel, il estime que les catholiques représenteront moins de 50 % de tous les Brésiliens au début du mois de juillet.
Les raisons de ce changement sont complexes, notamment les changements politiques qui ont réduit les avantages de l'Église catholique par rapport aux autres religions, ainsi que la sécularisation croissante dans une grande partie du monde. Pendant la pandémie, les églises évangéliques ont été particulièrement efficaces dans l'utilisation des médias sociaux pour maintenir l'engagement des gens, a déclaré M. Diniz Alves.
Les critiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église catholique soulignent également son incapacité à satisfaire les demandes religieuses et sociales de nombreuses personnes, en particulier les pauvres. Les Latino-Américains décrivent souvent l'Église catholique comme déconnectée des luttes quotidiennes de ses fidèles.
L'essor de la théologie de la libération dans les années 1960 et 1970, époque à laquelle l'Église catholique d'Amérique latine a de plus en plus insisté sur sa mission de justice sociale, en s'inspirant dans certains cas des idées marxistes, n'a pas réussi à contrer l'attrait des religions protestantes. Ou, pour reprendre les termes d'une boutade désormais légendaire, attribuée de diverses manières à des sources catholiques et protestantes : "L'Église catholique a opté pour les pauvres et les pauvres ont opté pour les pentecôtistes".
Voir, sur Aleteia :
et sur Vatican News :

Au Congo, la disparition de la forte personnalité du Cardinal Laurent Monsengwo, décédé au mois de juillet 2021, laisse l’Eglise à la merci des petits jeux d’une caste politique corrompue et le peuple entre la torpeur et le fatalisme : un tunnel sans issue prochaine à l’horizon (JPSC). Rapport de l’observatoire de la dépense publique (Odep) de la RDC :
« Le rapport de l’Odep est sans appel. Les pratiques de corruption se sont aggravées pendant l’année 2021 en République démocratique du Congo (RDC). L’ONG y dénonce une institutionnalisation des mauvaises pratiques, avec un Parlement transformé « en temple de la corruption », une Inspection générale des finances (IGF) qui banalise les violations de la loi, mais surtout un gouvernement court-circuité par les conseillers de la présidence « qui assurent les fonctions de ministre, sans aucun fondement juridique ». Un triste constat alors que le président Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption l’une de ses principales priorités.
Un Etat budgétivore
En épluchant les comptes, l’Odep ne comprend pas pourquoi, les institutions de la République sont aussi gourmandes en argent public. Les dépenses de la présidence ont explosé de plus de 200%, tout comme celles de l’Assemblée nationale (103%), du Sénat (133%) et de la Primature (131%). Le gouvernement Sama Lukonde avait pourtant promis de réduire le train de vie de l’Etat, alors que les dépenses pour la santé, l’éducation, l’accès à l’eau, à l’électricité ou aux infrastructures manquent cruellement.
La présidence a augmenté le nombre de ses personnels de 455 en 2018, à 1.018 en 2021. Idem à l’Assemblée nationale, au Sénat et à la Primature, qui ont fortement augmenté le nombre de leurs collaborateurs. Une situation qui amène également une forte disparité de salaire. Dans un cabinet politique, les salaires se situent entre 800 dollars et 3.000 dollars alors que la rémunération moyenne d’un enseignant est de 180 dollars. L’Odep estime qu’il est possible de revaloriser de 100 dollars le salaire des enseignants « si le gouvernement opte pour la suppression d’institutions budgétivores comme le CNSA » et en réduisant son train de vie.
Des projets lancés sans études, sans devis, sans calendrier…
La gratuité de l’enseignement de base, l’une des mesures phares du programme présidentiel, est elle aussi épinglée par l’ONG spécialisée dans la bonne gouvernance. Il manque toujours 1,25 milliards de dollars pour couvrir les besoins réels de cette mesure. Bilan : les parents continuent de payer, les classes sont surchargées et les enseignants sont en colère. L’Odep pointe également la surfacturation d’écoles au Kasaï-Oriental dans le cadre de projets financés par le Fonds de promotion de l’industrie pour plus d’un million de dollars.
Le projet « Tshilejelu », censé réhabiliter des kilomètres d’infrastrures routières dans tout le pays, a été lancé sans études de faisabilité, sans mise en concurrence, sans devis, selon le rapport de l’Odep. Des frais d’études jamais validés ont tout de même été décaissés par l’Office de voirie et de drainage (OVD) pour… 7 millions de dollars. Ces mauvaises pratiques auraient été réalisées « en connivence avec certains conseillers de la présidence de la République ». Résultat : la majorité des travaux n’ont même pas commencé.
Un dircab de la présidence tout-puissant
Un autre projet a été lancé dans les mêmes conditions douteuses : Kinshasa « zéro trou ». Là encore, aucune étude, aucun calendrier n’ont été avancés. Pire, pointe le rapport de l’Odep, le ministre du budget n’a jamais approuvé le projet. Pour l’ONG, la raison en est simple, la République démocratique du Congo est actuellement gérée par un gouvernement parallèle, piloté directement par la présidence et son directeur de cabinet, Guylain Nyembo. Une situation, qui a pour conséquence, « la course à l’enrichissement illicite », se désole l’Odep. La Cour des comptes a récemment fait part de ses doutes sur la bonne utilisation de 50 millions de dollars alloués à la lutte contre le Covid par le FMI. Un peu plus de 31 millions ont été redistribués, sans respecter la procédure, vers la présidence ou l’Assemblée nationale.
Depuis 2019, les affaires de détournement de fonds publics se sont enchaînées autour du programme présidentiel des « 100 jours », des 15 millions de dollars destinés aux compagnies pétrolières et disparus dans la nature, ou de la très contestée taxe téléphonique RAM, dont la Commission économique parlementaire n’arrive pas à en trouver trace dans les comptes publics. Tout cela entache fortement l’image de chantre de l’anti-corruption qu’a voulu se forger Félix Tshisekedi à son arrivée à la tête de la RDC. Cela laisse enfin l’étrange impression qu’à la place du changement de système promis par le chef de l’Etat, une nouvelle élite corrompue a pris la place de la précédente, laissant la majorité des Congolais à leur triste sort. »
Christophe Rigaud – Afrikarabia »
Ref. La RDC de Tshisekedi toujours rongée par la mal gouvernance
De Nico Spuntoni sur le Daily Compass :
La campagne de dénigrement contre Ratzinger reprend de plus belle
11-01-2022
Ratzinger a été accusé par l'hebdomadaire Die Zeit de couvrir un prêtre pédophile. Les faits remontent à 1980, lorsque le pape émérite était archevêque de Munich et Freising. Mais l'affaire est déjà bien connue et s'est retrouvée sous les feux des projecteurs en mars 2010. Que se cache-t-il derrière cette énième attaque contre le Pape émérite ?
La campagne de dénigrement contre Ratzinger a recommencé. Celui qui restera dans les mémoires pour avoir d'abord dénoncé "la saleté de l'Eglise" lors du Via Crucis de 2005, puis pour l'avoir combattue une fois devenu pape, est accusé par l'hebdomadaire Die Zeit d'avoir couvert un prêtre pédophile.
Les faits remonteraient à 1980, alors que le pape émérite était archevêque de Munich et Freising. Selon le magazine allemand, la charge explosive se trouve dans un document de 2016 rédigé par le tribunal ecclésiastique archidiocésain, qui affirme que les évêques d'Essen et de Munich ont manqué à leur devoir de protection des mineurs.
Le protagoniste de l'affaire est le "Père H.", un prêtre du diocèse d'Essen, qui est accusé d'avoir forcé un garçon de 11 ans à pratiquer une fellation en 1979 et qui a été transféré dans le diocèse principal de Bavière en 1980 pour une thérapie avec le consentement de l'archevêque de l'époque, Mgr Ratzinger. Le "Père H.", comme il est désigné dans les articles sensationnalistes qui paraissent actuellement, n'est autre que Peter Hullermann, et l'implication présumée de l'actuel pape émérite dans son cas avait déjà été mise en lumière en mars 2010.
À l'époque, en effet, Der Spiegel avait publié cette révélation les jours mêmes où était rendue publique la Lettre pastorale aux catholiques d'Irlande, document-symbole du pontificat de Benoît XVI sur le sujet de la pédophilie. Le timing n'était probablement pas accidentel et a eu pour effet de porter un coup à la crédibilité avec laquelle le Pontife régnant de l'époque entendait nettoyer l'Église.
Aujourd'hui, presque douze ans plus tard, cette histoire est rappelée par un autre hebdomadaire allemand avec pour seule nouveauté un document de 2016 du tribunal ecclésiastique de l'archevêché qui s'est retrouvé entre les mains de la presse juste avant la publication annoncée - entre le 17 et le 22 janvier - du rapport sur les abus et les dissimulations à Munich dans la période 1945-2019. Le rapport a été préparé par WSW, le même cabinet d'avocats qui a produit le premier rapport commandé par l'archevêché de Cologne, qui a ensuite été bloqué par le cardinal Rainer Maria Woelki parce qu'il aurait présenté d'importantes lacunes juridiques et violé les droits des personnes concernées.
Dans la livraison du Soir d'aujourd'hui, Fanny Declercq se fait l'écho (bien tardif) des théories de Josselin Tricou sur "la masculinité atypique des prêtres catholiques". En septembre dernier, Louis Daufresne, sur Aleteia, avait publié une note éclairante sur la parution du livre "Des soutanes et des hommes" de ce "sociologue engagé" :
La figure du prêtre au bistouri de la sociologie engagée
Moins elle est influente, plus elle intrigue : l’Église catholique deviendrait-elle de plus en plus un objet d’étude et de curiosité, une sorte de point dur polarisant à l’excès ? Un certain public la regarde sur le mode de la fascination/répulsion, sans doute car il s’agit d’un milieu clos, même s’il se dit ouvert sur le monde et attentif à ses souffrances. Que se passe-t-il derrière les murs du séminaire, du presbytère, du monastère ? Pour survivre dans un monde libéré de tout, les clercs se rendent forcément coupables d’hypocrisie. C’est ce que narrait Frédéric Martel. En 2019, le journaliste avait gratifié la planète médiatique d’une enquête fleuve « au cœur du Vatican » intitulée Sodoma. Si le style s’inspirait plus de Bussy-Rabutin que de Durkheim, Martel exhaussait la présence d’un « lobby gay ». Conclusion : la morale de l’Église doit changer car ses prélats, du moins une partie d’entre eux, la transgressent.
« Acteur engagé »
Un nouveau livre réarme cette idée mais de manière très différente. Sous le titre à la Steinbeck Des soutanes et des hommes (PUF), Josselin Tricou n’exhume pas les souvenirs de frous-frous romains. Pendant deux ans, il a enquêté pour le compte de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, la CIASE, dont le rapport attendu mardi prochain 5 octobre s’annonce tonitruant. Il s’agit d’une très sérieuse thèse de doctorat en science politique-études de genre. Les PUF en font même 472 pages ! Et Le Monde se fait dithyrambique sur ce maître-assistant à l’université de Lausanne : « C’est à une formidable exploration que nous invite […] Josselin Tricou dans ce livre, résultat d’un travail de recherche d’une dizaine d’années sur “la subjectivation genrée et les politiques de la masculinité au sein du clergé catholique français depuis les années 1980”.» La formulation fleure la novlangue LGBT.
Tricou a l’honnêteté de se présenter comme un « acteur engagé » et selon ses mots, son sujet « suscite à la fois de l’embarras à l’intérieur et des fantasmes à l’extérieur ». Comme si son doigt, habilement inséré dans le trou de la serrure, servait de clef de compréhension et que la porte s’ouvrait sur un abîme de non-dit. Pour le sociologue suisse, « l’Église a été façonnée pendant des siècles à la fois par une forte présence de prêtres homosexuels et par un discours très hétéronormatif ». Voilà un flagrant délit de contradiction jouissif. Comme Martel, il s’agit de pointer le hiatus entre le discours et les actes. Mais à la différence du journaliste, Tricou interroge la figure du prêtre ou plutôt déconstruit son intimité, les remparts qu’érige le clergé pour qu’elle s’épanouisse à l’abri des regards. Le sociologue fait passer au sacerdoce une visite médicale, le met sur le billard et dissèque sa maladie de foi avec le bistouri des nouvelles mœurs.
Les placards des sacristies
Son diagnostic est le suivant : « En sacralisant le prêtre, l’Église en a fait un être à part, dégenré et désexualisé. » N’y voyons pas un propos polémique. Dans l’esprit du monde, la figure du prêtre est devenue si dérangeante et incompréhensible qu’on ne la conçoit plus que comme incongrue et malsaine. Les sciences humaines sont là pour dire cette névrose, l’impensé du masculin.
Il sous-entend aussi que sous la soutane se cache un homme qui en aime un autre et que la posture homophobe sert à protéger cette autre forme d’incompatibilité que l’Église et sa morale réprouvent.
Le prêtre, ce non-être, est victime d’une « émasculation symbolique ».Tricou prend comme point de départ les années quatre-vingt. L’Église postconciliaire ne recrute plus dans les couches populaires mais, comme le note Libération, « dans la haute bourgeoisie très pratiquante ». La prêtrise devient « une voie pour ceux qui se sentent homosexuels mais ne peuvent assumer leur sexualité dans leur milieu social », ajoute Libé. Le chercheur rend même hommage à l’institution qu’« en certains lieux et en certains temps, elle [ait] pu être un espace protecteur dans un monde marqué par l’homophobie et qu’elle [ait] su mettre en place des dispositifs d’accompagnement et de souci de soi, comme dirait Michel Foucault, presque libérateurs ». Au bout du compte, juge Tricou, l’Église, à son corps défendant et à rebours de sa doctrine, est devenue un sanctuaire gay, un lieu d’« émancipation paradoxale ». Les sacristies cacheraient des « placards » où l’homosexualité pourrait être assumée. Le pragmatisme triompherait ainsi de la morale.
Sous-entendu
Selon le sociologue, le clergé le sait et se trouve mal à l’aise quand la Manif pour tous descend dans la rue contre le mariage de personnes de même sexe. Attachées à une image mythique du sacerdoce, les ouailles de cette militance attendent que les prêtres soient des chefs pétris de valeurs viriles. Elles mettent alors le système en surrégime en exerçant« une pression très forte sur les prêtres et religieux homosexuels », précise le chercheur. Celle-ci est d’autant plus efficace qu’elle émane de « ceux que ces prêtres sont tenus d’instruire et de guider ». Tricou pense que ce sont les scandales de pédocriminalité cléricale qui permettent de « relâcher cette pression conservatrice ». À quelque chose malheur est bon…
Des soutanes et des hommes est un titre qui en dit plus qu’il en a l’air : Le "et" sert à éloigner la soutane de l’homme, comme si les deux étaient incompatibles. Il sous-entend aussi que sous la soutane se cache un homme qui en aime un autre et que la posture homophobe sert à protéger cette autre forme d’incompatibilité que l’Église et sa morale réprouvent.
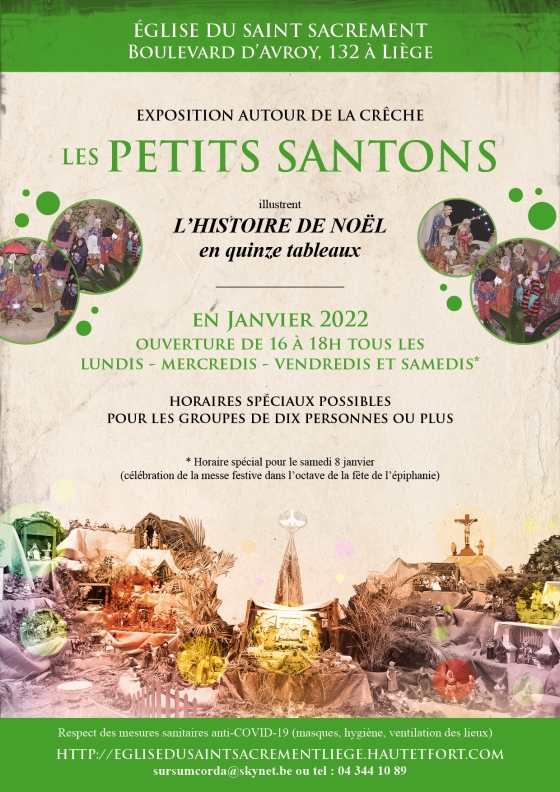





De Jonah McKeown sur Catholic News Agency :
Retournement de situation : les Missionnaires de la Charité en Inde sont à nouveau autorisés à recevoir des dons étrangers
8 janv. 2022
Les Missionnaires de la Charité ont été autorisés à recevoir et à utiliser des fonds étrangers en Inde, après que l'ordre religieux fondé par Mère Teresa ait été inopinément jugé inéligible à recevoir des dons de l'étranger à la fin de l'année dernière.
Vatican News a rapporté samedi que le gouvernement indien a rétabli le 7 janvier la licence FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) pour l'ordre religieux, permettant au groupe de recevoir et d'utiliser à nouveau des fonds étrangers.
Le ministère indien de l'Intérieur avait, le jour de Noël, déclaré les Missionnaires inéligibles aux dons étrangers, sans donner d'explication complète sur la raison.
Sunita Kumar, porte-parole des Missionnaires de la Charité à Calcutta, a déclaré au New York Times, le 28 décembre, qu'elle était convaincue que le problème pouvait être résolu. Elle a indiqué que le financement du travail des missionnaires ne serait pas affecté immédiatement en raison du soutien local.
Quelques jours plus tard, cependant, les missionnaires ont commencé à rationner leur distribution de nourriture et d'autres articles aux pauvres, ce qui a provoqué la consternation et l'inquiétude des personnes pauvres aidées par les missionnaires.
Le revirement du gouvernement indien est un soulagement.
"Nous ne nous attendions pas à ce que notre enregistrement soit annulé, mais c'est arrivé", a déclaré M. Kumar à UCA News après l'annonce du 7 janvier.
"Nous sommes heureux que le rétablissement de notre licence se soit fait sans beaucoup de retard".
Les licences accordées aux ONG en vertu de la loi indienne de 1976 sur la réglementation des contributions étrangères sont soumises à une période de validité de cinq ans. Ces derniers temps, le gouvernement indien a renforcé son contrôle du financement étranger d'autres organisations à but non lucratif, telles qu'Amnesty International.
Ces problèmes juridiques en Inde surviennent dans un contexte de tensions politiques, sociales et religieuses, ainsi que de problèmes d'extrémisme religieux anti-chrétien dans de nombreuses régions.
Les dons étrangers aux Missionnaires de la Charité ont représenté plus de 13 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant en mars 2021, selon les documents déposés par l'organisation. L'organisation ne déclare pas publiquement son revenu total, selon le New York Times.
Le père Dominic Gomes, vicaire général de l'archidiocèse de Calcutta, avait qualifié l'annonce initiale de "cadeau de Noël cruel pour les plus pauvres des pauvres."
Il a déclaré qu'il y avait 22 000 personnes directement à charge et bénéficiaires dans les centres des Missionnaires de la Charité en Inde, rapporte UCA News. Les sœurs et les frères des Missionnaires de la Charité "s'efforcent d'élever des milliers de personnes et sont souvent les seuls amis des lépreux et des exclus de la société dont personne ne s'aventure à s'approcher".
Sainte Thérèse de Calcutta a fondé les Missionnaires de la Charité en 1950, sous l'égide de l'archidiocèse de Calcutta. Le gouvernement a accordé aux missionnaires une maison pour servir les pauvres de Calcutta en 1952. L'organisation compte aujourd'hui des centaines de maisons dans le monde entier et ses membres comprennent des sœurs et frères religieux et des prêtres, ainsi qu'une organisation laïque.
J’ai découvert Juan Manuel de Prada il y a des années (...). Il vient de publier un essai dont AM Valli reproduit ici une recension en italien, sur la situation « apocalyptique » (attention à ne pas se méprendre sur le sens de ce terme) que nous vivons. Je n’essaierais pas de résumer, j’en suis bien incapable. Je me contente de savourer, en invitant le lecteur à en faire autant.
Ces jours que nous vivons. Et le règne de l’Antéchrist
« Il y a une profonde signification surnaturelle dans tout ce qui se passe ». Ce sont les mots de Juan Manuel De Prada, auteur de Enmienda a la totalidad [1], un livre dans lequel l’écrivain espagnol d’origine basque, confronté à l’homologation des forces et des institutions politiques à une idéologie technocratique, récupère la pensée traditionnelle, en partant de la dimension surnaturelle de l’existence humaine, et dénonce la haine de la vie qui prévaut.
Juan Manuel De Prada, brillant écrivain d’origine basque, est l’un des principaux intellectuels du catholicisme espagnol. Il est connu pour son anticonformisme, qui ressort avec force dans son dernier livre : Enmienda a la totalidad, un titre qui fait allusion à la nécessité d’un « amendement total » concernant les idéologies contemporaines, qui sont fallacieuses dans leurs prémisses et ruineuses dans leurs conclusions.
Dans ce dernier essai, l’écrivain espagnol oppose la pensée traditionnelle à la pensée unique de l’idéologie. Alors que les idéologies, explique De Prada, prônent un « être humain en évolution continue » et indéfiniment modifiable selon les désirs du pouvoir, la pensée traditionnelle défend un « être humain stable qui reconnaît dans sa nature un datum, quelque chose de donné, d’inamovible », une « nature spécifiquement spirituelle, que les idéologies renient ou méconnaissent ».