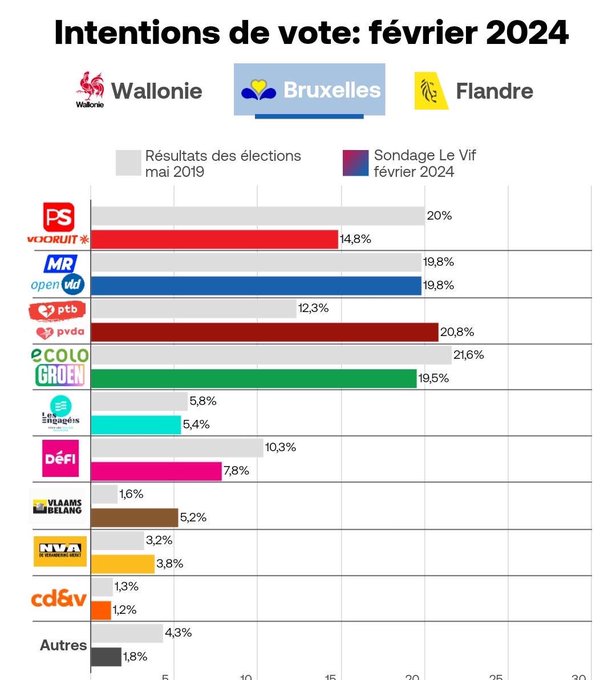De gènéthique.org (lettre mensuelle de février 2024) :
Consentement et fin de vie : consentir à mourir ?
Alors qu'en France le projet de loi sur la fin de vie devrait être prochainement discuté, même si le calendrier n’est pas clairement fixé (cf. Fin de vie : un calendrier difficile à fixer), Aline Cheynet de Beaupré, professeur de Droit privé à l’Université d’Orléans et spécialiste des sujets bioéthiques, nous éclaire sur la question du consentement face à l’euthanasie ou au suicide assisté. Peut-on réellement consentir à mourir ?
Lire les questions de fin de vie sous l’angle juridique du consentement met en exergue la profonde complexité du sujet. Consent-on à l’euthanasie pour mourir ou ne plus souffrir ? L’euthanasie est-elle demandée ou proposée ? Les questions sont nombreuses.
En droit des contrats, le consentement désigne la manifestation de volonté des parties. Cum-sentire c’est « sentir avec », soulignant ainsi l’accord, la conformité ou l’acquiescement à quelque chose. Appliqué à la fin de vie, le chemin simple allant de l’« offre » à l’« acceptation de l’offre », valable en droit des contrats, devient à la fois flou et complexe, mais aussi juridiquement insatisfaisant et malmenant le consentement.
Consentir par avance ?
Les évolutions observées à l’étranger en matière d’euthanasie montrent que le « demandeur » peut craindre, ou vouloir prévenir, une souffrance future. Au moment de sa « demande de mort provoquée », il n’est donc pas un patient, mais un « futur potentiel patient » vis-à-vis de pathologies ou de symptômes qui ne sont pas (encore) là. Comment décider par avance d’une situation inconnue, existentielle et changeant notre vision des choses ?
Selon le Code de la Santé Publique (CSP), les directives anticipées[1] peuvent être rédigées par une personne atteinte d’une maladie grave ou qui « pense » être proche de sa fin de vie, ou par une personne qui « pense » être en bonne santé ou n’est pas atteinte d’une maladie grave. Les deux « modèles » sont prévus pour « le cas où je ne serais plus en mesure de m’exprimer au moment de la fin de ma vie ». La loi Leonetti de 2005 leur a conféré une valeur légale, mais leur statut juridique est imprécis.
Ces « directives » ne sont en effet pas impératives, et les soignants peuvent ne pas les suivre lorsqu’elles apparaissent « manifestement inappropriées ». Tel fut, par exemple, le cas pour homme demandant non pas qu’on arrêtât les traitements, mais qu’on le maintînt en vie. Au regard de sa situation, la demande a été considérée comme étant « manifestement inappropriée »[2] (cf. Conseil constitutionnel : les directives anticipées pourront être écartées).
Les « exemples » médiatisés de Line Renaud ou de l’ami de Marina Carrère d’Encausse confirment la complexité du problème. Line Renaud a fait un AVC en 2019, mais aucune directive anticipée n’a été évoquée autour de cet « incident ». Idem pour le compagnon de Marina Carrère d’Encausse. Pourtant, les discours véhiculés dans ces deux « histoires » invitent à des directives à spectre large de « non maintien en vie ».
En cas de directives anticipées, le rédacteur, qu’il soit malade ou non, n’est pas assisté d’un soignant. S’il est malade, il serait pourtant « bon » que ses « directives » soient « éclairées » par un professionnel. S’il n’est pas malade, il est encore plus « seul » pour prendre des options, gravissimes et vitales, sur des sujets qu’il ignore : la maladie, la souffrance et la mort. Le consentement est dès lors tout sauf « éclairé ».
 On sait que le pape François porte en lui le souci d’aller aux « périphéries existentielles », afin de toucher les âmes éloignées du message évangélique. Quand on observe la sociologie du catholicisme français, dont les forces vives résident aujourd’hui principalement dans une bourgeoisie relativement aisée – honneur à elle d’avoir su conserver le flambeau et le transmettre –, on comprend l’urgence de s’adresser aux classes populaires et à cette « France périphérique » si délaissée par nos élites parisiennes. Il est en effet anormal que l’Église, qui honore tant la figure du pauvre, ne parvienne pas en France à toucher davantage les milieux les plus défavorisés, exception faite, il est vrai, de nombreux Antillais et Africains catholiques particulièrement fervents.
On sait que le pape François porte en lui le souci d’aller aux « périphéries existentielles », afin de toucher les âmes éloignées du message évangélique. Quand on observe la sociologie du catholicisme français, dont les forces vives résident aujourd’hui principalement dans une bourgeoisie relativement aisée – honneur à elle d’avoir su conserver le flambeau et le transmettre –, on comprend l’urgence de s’adresser aux classes populaires et à cette « France périphérique » si délaissée par nos élites parisiennes. Il est en effet anormal que l’Église, qui honore tant la figure du pauvre, ne parvienne pas en France à toucher davantage les milieux les plus défavorisés, exception faite, il est vrai, de nombreux Antillais et Africains catholiques particulièrement fervents.