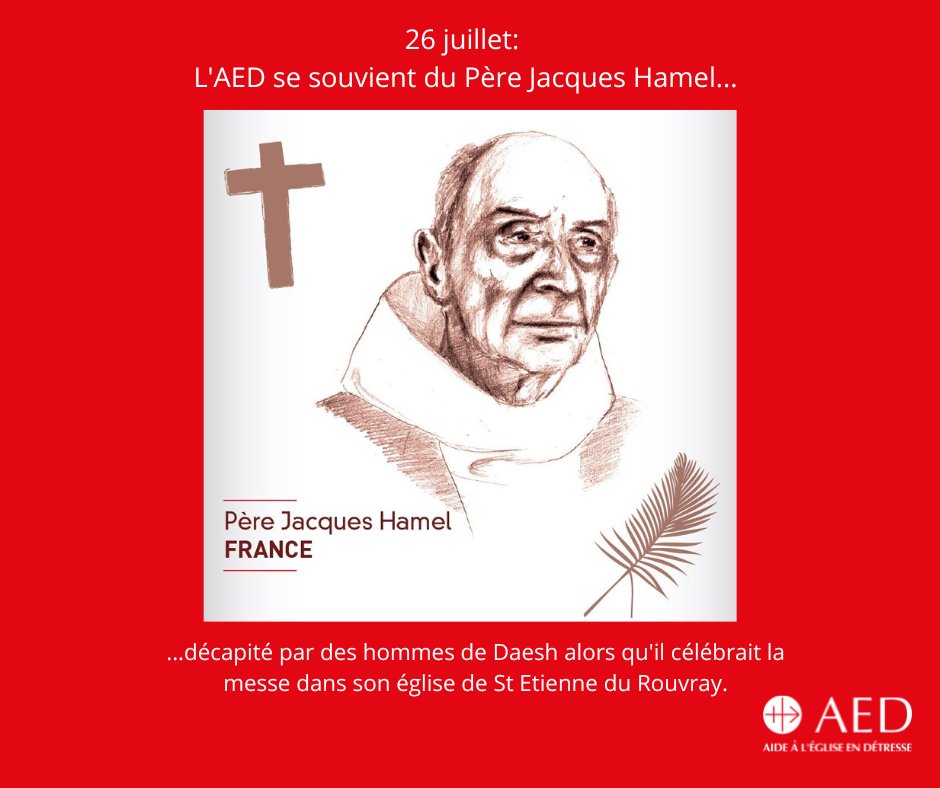Témoignages - Page 90
-
C'était un 26 juillet...
Lien permanent Catégories : Eglise, Foi, islamisme, Persécutions antichrétiennes, Société, Témoignages 0 commentaire -
Jean-Pierre Snyers célèbre ses 40 ans d'écriture; une rétrospective époustouflante
Jean-Pierre Snyers: 40 ans d'écriture1982-2022: voilà juste 40 ans que notre ami Jean-Pierre Snyers se livre à l'écriture.Afin de se remémorer toutes ces années, il vient de constituer un dossier (composé de 123 photos) sur son blog internet.
C'est l'occasion également de voir évoquées les très nombreuses rencontres de Jean-Pierre Snyers avec des personnalités de premier plan.
Si le coeur vous en dit d'y avoir accès, tapez sur google jpsnyers.blogspot.com.
https://drive.google.com/
drive/folders/ 1tVJv4O4VEmZicHEW1TbR0Rq_ N6UdZUJb?usp=sharing Lien permanent Catégories : Culture, Débats, Foi, Livres - Publications, Médias, Témoignages 3 commentaires -
Plus de deux mille martyrs victimes des "Rouges" lors de la guerre civile espagnole
De Dawn Beutner sur The Catholic World Report :
Martyrs du communisme de la guerre civile espagnole
Il y a plus de deux mille martyrs de la guerre civile espagnole dans le calendrier actuel de l'Église, datant de 1934 à 1939.
23 juillet 2022
L'année 1936 marque le début d'une horrible guerre civile en Espagne.
Peut-être que, comme moi, vous ne vous souvenez pas d'avoir appris la guerre civile espagnole en cours d'histoire au lycée. Après tout, le nombre de victimes de la guerre civile espagnole semble faible (un million tout de même ! ndB) par rapport aux millions de morts de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que des nombreux autres conflits sanglants du XXe siècle. Il n'est pas surprenant que les manuels d'histoire se concentrent davantage sur les guerres aux causes plus simples et au bilan plus lourd.
Quels sont les événements qui ont conduit à la guerre civile espagnole ? En 1931, le roi d'Espagne s'est enfui en Angleterre, et le gouvernement qui a été mis en place peu après a été généralement décrit comme inefficace. Deux camps se sont formés pour tenter de prendre le contrôle du pays : les républicains et les nationalistes. Le reste de l'histoire est compliqué (1) mais mérite d'être compris.(2) Cependant, pour les catholiques fidèles d'Espagne, le choix était clair.
Les dirigeants républicains étaient en grande partie une alliance de socialistes, de communistes et d'anarchistes. Leur objectif premier n'était pas d'assurer la transition pacifique de leur pays vers un meilleur mode de vie pour tous les Espagnols, mais de mener une révolution violente qui renverserait le gouvernement en place et établirait une forme d'État communiste. Quels que soient les reproches que l'on puisse faire au leader nationaliste Francisco Franco et à son règne ultérieur en tant que dictateur fasciste de l'Espagne, pour les catholiques espagnols à l'époque de la guerre, il n'y avait pas de véritable alternative. Les Républicains suivaient le même plan de bataille que celui utilisé dans toutes les autres révolutions communistes, et l'une des tactiques les plus connues dans cette lutte était de tuer les chrétiens.
En Espagne, cela signifiait tuer les catholiques. Suivant la stratégie évidente selon laquelle il est plus efficace d'exécuter les dirigeants de ceux qui s'opposent à vous, plutôt que la base, les républicains ont particulièrement recherché toute personne portant une soutane ou un habit religieux.
C'est pourquoi le bienheureux Joan Huguet Cardona a été tué. Il n'avait été ordonné prêtre que depuis un mois lorsque les miliciens républicains sont entrés dans sa ville de Ferreries. Comme il portait une soutane, ils l'ont trouvé rapidement, l'ont arrêté, l'ont obligé à enlever sa soutane et lui ont ordonné de cracher sur un objet de dévotion (une sorte de chapelet) qu'il portait. Lorsqu'il a refusé de le faire, il a été abattu. Cela s'est passé le 23 juillet 1936.
-
Un court-métrage sur la bienheureuse Pauline Jaricot
De l'Agence Fides :
Cité du Vatican - A l'anniversaire de sa naissance aujourd'hui, un court-métrage sur la bienheureuse Pauline Jaricot disponible en 4 langues
22 juillet 2022Cité du Vatican (Agence Fides) - La fondatrice de l'Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi (OPFP), béatifiée le 22 mai dernier dans sa ville natale, est née à Lyon le 22 juillet 1799. Le court-métrage "Guardare dall'alto" (Regarder d'en haut), produit par le POPF avec la collaboration de l'Agence Fides à l'occasion de cette année jubilaire (voir Agence Fides 3 mai 2022) lui a été dédié ainsi qu'à son message toujours d'actualité. Le court-métrage, disponible dès maintenant en anglais, italien, français et espagnol, présente sous la forme d'un court-métrage et d'un docu-film l'histoire et l'expérience de foi de Pauline Jaricot, en la racontant à travers les yeux et la vie de Claire, une jeune femme de notre temps. Pensé et conçu comme un outil d'évangélisation, il a été mis à la disposition des Directions nationales des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), qui le diffusent et, dans certains cas, le traduisent dans leur propre idiome, en produisant des versions sous-titrées et même doublées. Les lieux de tournage incluent non seulement les endroits de Lyon où Jaricot a vécu son expérience de foi, mais aussi Rustrel, une commune de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, connue comme le "Colorado de la Provence", où Pauline Jaricot avait fondé l'usine Notre Dame des Anges. La personne qui a reçu le miracle de la guérison par l'intercession de Pauline Jaricot : Mayline Tran, une petite fille de trois ans à l'époque, apparaît également dans les dernières scènes du court-métrage. La famille Tran a participé à la phase finale du projet, partageant l'esprit du projet et racontant sa propre expérience.
(EG) (Agence Fides 22/7/2022)
-
Chine communiste : Le Parlement européen appelle le Vatican à soutenir pleinement le cardinal Zen
L'arrestation de Zen est une attaque contre la liberté religieuse et toutes les allégations des autorités chinoises doivent être abandonnées, demandent les députés. Lu sur le site kath net :

« STRASBOURG/BRUXELLES (kath.net/mk) Dans une résolution du 7 juillet, le Parlement européen a appelé le Saint-Siège à « apporter son plein soutien au cardinal Zen de Hong Kong » et à intensifier la pression diplomatique sur les autorités chinoises pour que les allégations soient abandonnées, note le Catholic World Report. En toile de fond: l'arrestation et l'inculpation de l'homme de 90 ans en mai pour avoir soutenu le mouvement démocratique et n'avoir pas enregistré d'association.
Le Parlement européen a fait référence à la liberté de religion et a désigné le cardinal comme un grand défenseur du mouvement démocratique de Hong Kong.
Le cardinal Zen est également un critique majeur de l'accord entre le Vatican et le régime communiste chinois à propos de la nomination des évêques. "Le martyre fait partie de notre Église", a-t-il dit. Le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, quant à lui, a déclaré le lendemain de l'arrestation de Zen qu'il espérait que cela ne compliquerait pas le dialogue du Saint-Siège avec la Chine.
Le procès de Zen et d'autres dirigeants pro-démocratie doit commencer le 19 septembre… »
Ref. Le Parlement européen appelle le Vatican à soutenir pleinement le cardinal Zen
Bref, le sermoneur sermonné ou le monde à l’envers? (JPSC)
-
Les mines de cobalt entretenues par la Chine au Congo exploitent 40 000 enfants travailleurs
De Zelda Caldwell sur Catholic News Agency :
Témoignage : Les mines de cobalt soutenues par la Chine au Congo exploitent 40 000 enfants travailleurs
Travail des enfants au Congo

Hervé Diakiese Kyungu, avocat congolais spécialisé dans les droits civils, témoigne le 14 juillet 2022, lors d'une audition du Congrès à Washington, D.C., sur l'utilisation du travail des enfants dans les mines de cobalt soutenues par la Chine en République démocratique du Congo. | Capture d'écran de la vidéo YouTube
16 juillet 2022
La Chine exploite des enfants en République démocratique du Congo, les forçant à travailler dans des conditions dangereuses pour extraire le cobalt qui alimente les appareils électroniques et les voitures électriques, ont témoigné cette semaine des témoins lors d'une audience du Congrès sur les violations des droits de l'homme.
"Sur le dos des travailleurs victimes de la traite et des enfants travailleurs, la Chine exploite les vastes ressources en cobalt de la RDC pour alimenter son économie et son agenda mondial", a déclaré le représentant Christopher Smith, R-New Jersey, qui a présidé l'audition de la Commission des droits de l'homme Tom Lantos le 14 juillet.
L'audience était intitulée "Travail des enfants et violations des droits de l'homme dans l'industrie minière de la République démocratique du Congo".
"La quête du Parti communiste chinois de cobalt pour les batteries et de lithium pour les panneaux solaires afin d'alimenter la soi-disant économie verte motive la rapacité humaine alors qu'environ 40 000 enfants au Congo travaillent dans des mines artisanales non réglementées dans des conditions dangereuses", a déclaré M. Smith.
La République démocratique du Congo (RDC) produit plus de 70 % du cobalt mondial, dont 15 à 30 % dans des mines artisanales. Depuis des années, ces exploitations à petite échelle sont connues pour leurs violations des droits de l'homme. Le Council on Foreign Relations attribue les conditions de travail inhumaines, en partie, à l'instabilité de la RDC, "un pays affaibli par de violents conflits ethniques, Ebola et des niveaux élevés de corruption".
Hervé Diakiese Kyungu, avocat congolais spécialisé dans les droits civils, a déclaré lors de l'audition que les enfants sont victimes de trafic et d'exploitation en raison de leur petite taille.
Les mines artisanales "ne sont souvent rien de plus que des puits étroits creusés dans le sol, c'est pourquoi les enfants sont recrutés - et dans de nombreux cas forcés - à y descendre, en utilisant uniquement leurs mains ou des outils rudimentaires sans aucun équipement de protection, pour extraire du cobalt et d'autres minéraux", a-t-il déclaré.
Lien permanent Catégories : Actualité, Economie, Ethique, International, Jeunes, Société, Témoignages 2 commentaires -
Béatification d'un jésuite allemand du XVIIème siècle
De Vatican News :
En Allemagne, le missionnaire jésuite Philipp Jeningen béatifié
Le jésuite allemand Philipp Jeningen a été béatifié ce samedi 16 juillet à Ellwangen (Etat de Bade-Wurtemberg). La cérémonie a été présidée par le cardinal luxembourgeois Jean-Claude Hollerich. Dans les années qui ont suivi la guerre de Trente Ans, Philipp Jeningen a évangélisé la région, gagnant l'estime de la société allemande par une vie de service, d'ascèse et de mission.
Plusieurs milliers de personnes étaient réunies ce samedi 16 juillet dans la basilique Saint-Guy, pour vénérer la tombe de Philipp Jeningen. Le missionnaire allemand est né dans la ville de Eichstätt, en Bavière, en 1642. Après des études de philosophie à partir de 1659, il entra au noviciat jésuite de Landsberg en 1663, puis fut ordonné prêtre de sa ville natale en 1672. Le jésuite fut alors envoyé à Ellwangen, autour de l'actuelle frontière entre la Bavière et le Bade-Wurtemberg, où il resta jusqu'à sa mort. A son contact, le nombre de pèlerins dans la région augmenta considérablement, contribuant à la recatholisation de Souabe, au sud-ouest du pays.
Dans son texte rédigé en latin à l'occasion de la messe de béatification, le Pape François a rendu hommage à ce «prédicateur infatigable de l'Évangile», qui fut également un «propagateur zélé de la dévotion à Marie». Le 8 février a été désigné comme jour de commémoration liturgique.
Un homme «de la rencontre amoureuse»
La cérémonie de béatification a été présidée par le cardinal Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg et président de la Commission des évêques de l'UE (COMECE). Evoquant la foi profonde de Philipp Jeningen en Dieu et son travail infatigable de missionnaire populaire, le cardinal a souligné que «sa foi se caractérisait par un lien profond avec Dieu au quotidien».
«Dieu remplissait, Il remplissait sa vie», a déclaré Jean-Claude Hollerich, soulignant que le père jésuite avait fait sien «le regard de Dieu», et a ainsi pu «offrir son amour aux personnes qu'il rencontrait.» Le bienheureux Philipp Jeningen était par ailleurs «ouvert à toutes les personnes qu'il rencontrait, ouvert à vos besoins spirituels et physiques. C'était un homme de la rencontre amoureuse. Cette nature de sa piété était reconnue par les gens, et c'est ainsi qu'ils l'appelaient le bon Père Philippe», a affirmé le cardinal au cours de son homélie.
Un lien entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes
Les chrétiens peuvent aujourd'hui apprendre plusieurs choses de ce nouveau bienheureux: «C'est le lien entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes, vécu par le bon Père Philippe, qui fait de nous des témoins de l'Évangile dans ce monde concret.» Son exemple peut également nous donner de la force face aux nombreux problèmes imposés au quotidien, a déclaré l'archevêque avec confiance. Les histoires de souffrance personnelle en font partie, tout comme les conséquences d'une sécularisation largement répandue, le changement climatique, la guerre en Ukraine ou encore la pandémie de Coronavirus.
Réimplanter une pratique religieuse
Dès son arrivée à Ellwangen, le père Philipp Jeningen avait mis en place des «promenades» missionnaires. Il se rendait de village en village lors de cinq grandes tournées dans les diocèses de la région, dans le but de redresser la vie religieuse et morale en friche, et réimplanter une pratique religieuse. Il n'accordait pas beaucoup d'importance à la force de persuasion rhétorique, mais témoignait avec des mots simples de sa confiance inébranlable en la Providence divine, et convertissait beaucoup d’habitants touchés par sa piété eucharistique et mariale. Son mode de vie ascétique - il dormait sur le sol nu et ne s'offrait une paillasse qu'en hiver – tout comme ses relations aimables et pleines d'humour, lui valurent l'estime de toutes les strates de la population, et en particulier des enfants.
Philipp Jeningen jouissait déjà de son vivant d'une réputation de saint, en raison de son don de guérison et de prédiction. Il est mort à Ellwangen le 8 février 1704, admiré de tous.
Lien permanent Catégories : Actualité, Eglise, Foi, Histoire, Spiritualité, Témoignages 0 commentaire -
Dernière à l'échafaud
17 juillet : les Bienheureuses Charlotte et ses compagnes, carmélites de Compiègne, martyres (†1794) (source : Evangile au Quotidien)
En 1790, il y avait 21 sœurs au Carmel de Compiègne dont la plus âgée avait 75 ans et la plus jeune 26 ans. Chassées de leur Carmel en 1792, elles s'installèrent dans 3 maisons voisines. Lors d'une perquisition des révolutionnaires, ceux-ci trouvèrent des images du Sacré-Cœur (emblème vendéen et royaliste) ainsi que des lettres destinées à des prêtres réfractaires. Arrêtées, elles furent escortées jusqu'à Paris et là, jugées sommairement et guillotinées sur la Place du Trône (aujourd'hui, Place de la Nation).
En montant sur l'échafaud, elles chantaient le Veni Creator et la mère supérieure donna la bénédiction à chacune avant d'être elle-même guillotinée. Seule une sœur en réchappa, absente le jour de l'arrestation, et publia un récit en 1836, basé sur de nombreux témoignages.
Elles furent béatifiées le 27 mai 1906 par Pie X.
Noms, dates et lieux de naissances des seize Martyres :
1 - Mère Thérèse de St. Augustin : Madeleine-Claudine Lidoine, 1752, Paris, St Sulpice
2 - Sœur Saint Louis : Marie-Anne-Françoise Brideau, 1751, Belfort
3 - Sœur de Jésus Crucifié : Marie-Amie Piedcourt,1715, Paris, St. Innocents
4 - Sœur Charlotte de la Résurrection : Anne-Marie-Madeleine-Françoise Thouret, 1715, Mouy (Oise)
5 - Sœur Euphrasie de l’Immaculée Conception : Marie-Claude-Cyprienne Brard, 1736, Bourth (Eure)
6 - Mère Henriette de Jésus : Marie-Françoise de Croissy, 1745, Paris, St. Roch
7 - Soeur Thérèse du Cœur de Marie : Marie-Anne Hanisset, 1742, Reims
8 - Sœur Thérèse de St. Ignace : Marie-Gabrielle Trézel, 1743, Compiègne, St. Jacques
9 - Sœur Julie-Louise de Jésus : Rose Crétien de Neuville, 1741, Évreux (Eure)
10 - Sœur Marie-Henriette de la Providence : Anne Pelras, 1760 Cajarc (Lot)
11 - Sœur Constance de Jésus : Marie-Geneviêve Meunier, 1765, St. Denis
12 - Sœur Marie du Saint-Ésprit : Angélique Roussel, 1742, Fresne-Mazancourt (Somme)
13 - Sœur Ste Marthe : Marie Dufour, 1741, Bannes (Sarthe)
14 - Sœur St. François-Xavier : Elisabeth-Juliue Verolot, 1764, Lignières (Aube)
15 - Sœur Catherine : Marie-Anne Soiron, 1742, Compiègne, St. Jacques
16 - Sœur Thérèse : Marie-Thérêse Soiron, 1748, Compiègne, St. JacquesLe seize Martyres de Compiègne furent béatifiées le 13 mai 1906 par saint Pie X (Giuseppe Sarto, 1903-1914).
-
Des bienheureuses martyres exécutées au nom de la liberté et de l'égalité (16 juillet)
BBses Marie-Rose de Gordon et 6 compagnes
Religieuses et martyres † 16 juillet 1794Durant les troubles de la Révolution, 29 religieuses chassées de leurs couvents avaient trouvé refuge dans une maison de Bollène. Là, depuis dix-huit mois, elles partageaient une vie de prière et de totale pauvreté. Elles furent arrêtées en avril 1794 pour avoir refusé de prêter le serment de liberté-égalité exigé par la municipalité et que leur conscience réprouvait. Elles furent incarcérées le 2 mai à Orange, dans la prison de la Cure, près de la cathédrale, où étaient déjà détenues 13 autres consœurs.
Les religieuses s’organisèrent en communauté et passaient leur temps à prier. Elles furent condamnées à mort par la Commission populaire qui siégeait dans l’actuelle chapelle Saint-Louis, et transférées au Théâtre antique en attendant d’aller à la guillotine dressée sur le cours Saint-Martin. Trente-deux d’entre elles furent exécutées (16 ursulines, 13 sacramentines, 2 cisterciennes et 1 bénédictine).
Le 6 juillet : Sœur Marie-Rose, bénédictine de Caderousse (Suzanne Deloye, née à Sérignan en 1741) ;
le 7 juillet : Sœur Iphigénie, sacramentine de Bollène (Suzanne de Gaillard, née à Bollène en 1761) ;
le 9 juillet : Sœur Sainte-Mélanie, ursuline de Bollène (Madeleine de Guilhermier, née à Bollène en 1733) et Sœur Marie-des-Anges, ursuline de Bollène (Marie-Anne de Rocher, née à Bollène en 1755) ;
le 10 juillet : Sœur Sainte-Sophie, ursuline de Bollène (Gertrude d’Alauzier, née à Bollène en 1757) et Sœur Agnés, ursuline de Bollène (Sylvie de Romillon, née à Bollène en 1750) ;
le 11 juillet : Sœur Sainte-Pélagie, sacramentine de Bollène (Rosalie Bès, née à Beaume-du-Transit en 1753), Sœur Saint Théotiste, sacramentine de Bollène (Elisabeth Pélissier, née à Bollène en 1741), Sœur Saint-Martin, sacramentine de Bollène (Claire Blanc, née à Bollène en 1742) et Sœur Sainte-Sophie, ursuline de Pont-Saint-Esprit (Marguerite d’Albarède, née à Saint-Laurent-de-Carnols en 1740) ;
le 12 juillet : Sœur Rose, sacramentine de Bollène (Thérèse Talieu, née à Bollène en 1746), Sœur du Bon-Ange, converse sacramentine de Bollène (Marie Cluse, née à Bouvantes en 1761), Sœur Marie de Saint-Henri, cistercienne de Sainte-Catherine d’Avignon (Marguerite de Justamond, née à Bollène en 1746) et Sœur Saint-Bernard, ursuline de Pont-Saint-Esprit (Jeanne de Romillon, née à Bollène en 1753).
le 13 juillet : Sœur Madeleine, sacramentine de Bollène (Elisabeth Verchières, née à Bollène en 1769), Sœur Marie-de-l’Annonciation, sacramentine de Bollène (Thérèse Faurie, née à Sérignan en 1770), Sœur Saint-Alexis, sacramentine de Bollène (Andrée Minutte, née à Sérignan en 1740), Sœur Saint-François, ursuline de Bollène (Marie-Anne Lambert, née à Pierrelatte en 1742) et Sœur Sainte-Françoise, converse ursuline de Carpentras (Marie-Anne Depeyre, née à Tulette en 1756), Sœur Saint-Gervais, supérieure des ursulines de Bollène (Anastasie de Roquard, née à Bollène en 1749) ;
le 16 juillet: Sœur Aimée, sacramentine de Bollène (Rose de Gordon, née à Mondragon en 1733), Sœur Marie-de-Jésus, sacramentine de Bollène (Thérèse Charrensol, née à Richerenches en 1758), Sœur Saint-Joachim, converse sacramentine de Bollène (MarieAnne Béguin-Royal, née à Bouvantes en 1736), Sœur Saint-Michel, converse ursuline de Bollène (Marie-Anne Doux, née à Bollène en 1738), Sœur Saint-André, converse ursuline de Bollène (Marie-Rose Laye, née à Bollène en 1728), Sœur Madeleine, ursuline de Pernes (Dorothée de Justamond, née à Bollène en 1743) et Sœur du Coeur-de-Marie, cistercienne de Sainte-Catherine d’Avignon (Madeleine de Justamond, née à Bollène en 1754) ;
le 20 juillet : Sœur Saint-Basile, ursuline de Pont-Saint-Esprit (Anne Cartier, née à Livron en 1733) ;
le 26 juillet : Sœur Saint-Augustin, sacramentine de Bollène (Marguerite Bonnet, née à Sérignan en 1719), Sœur Catherine, ursuline de Pont-Saint-Esprit (Marie-Madeleine de Justamond, née à Bollène en 1724), Sœur Claire, ursuline de Bollène (Claire Dubas, née à Laudun en 1727) et Sœur du Cœur-de-Jésus, supérieure des ursulines de Sisteron (Elisabeth de Consolin, née à Courthézon en 1736).Elles montèrent toutes joyeusement à l’échafaud, chantant et priant pour leurs persécuteurs qui admiraient leur courage : « Ces bougresses-là meurent toutes en riant ». Les dix autres religieuses détenues furent sauvées par la chute de Robespierre, le 28 juillet, et libérées en I795.
Les corps des martyres furent jetés dans des fosses communes, dans le champ Laplane (à Gabet), situé à 4 kilomètres de la ville, au bord de l’Aygues, et une chapelle y fut bâtie en 1832.
Les 32 religieuses ont été béatifiées par le pape Pie XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti, 1922-1939) le 10 mai 1925.
-
La " persécution polie " des points de vue catholiques sur l'avortement et la sexualité se fait plus insistante au niveau international
De Lauretta Brown sur le National Catholic Register :
Un responsable de l'USCCB (United States Conference of Catholic Bishops) met en garde contre une augmentation de la " persécution polie " des points de vue catholiques sur l'avortement et la sexualité au niveau international.
L'administration Biden et des groupes à l'étranger continuent de promouvoir un programme " LGBT " et pro-avortement dans les pays pauvres.
11 juillet 2022
WASHINGTON - Au cours du Sommet international sur la liberté religieuse 2022 qui s'est tenu la semaine dernière à Washington, Lucas Koach, directeur du Bureau de la justice internationale et de la paix de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, a averti que dans le monde en développement, il y a une impulsion "pour pousser à des politiques que l'Église pense contraires à la dignité humaine innée de la personne humaine et attacher cela à l'aide étrangère des États-Unis ou à d'autres leviers diplomatiques".
Koach a pris la parole lors d'un panel de la Heritage Foundation intitulé "Victimes de persécution 'polie' : Les croyants ciblés par les activistes laïques de l'avortement et du genre." Le titre faisait référence aux remarques de 2016 du pape François sur la persécution "déguisée en culture, déguisée en modernité, déguisée en progrès." Le pape a qualifié cette persécution de "persécution polie, lorsque quelqu'un est persécuté non pas pour avoir confessé le nom du Christ, mais pour avoir voulu démontrer les valeurs du Fils de Dieu."
Koach a déclaré que les politiques qui sont en contradiction avec l'enseignement de l'Église sur la dignité humaine "sont souvent formulées sous le couvert de la protection d'autres personnes, comme une mère confrontée à une grossesse non désirée, ou une personne attirée par le même sexe ou souffrant de dysphorie de genre, subissant une violence ou une discrimination indue. Ainsi, on peut dire ou voir que cela semble bien intentionné, et nous sommes certainement d'accord que les personnes vulnérables et marginalisées doivent être protégées."
Il a déclaré que l'Église catholique croit, "comme tant de nos traditions de foi l'ont bien articulé, que chaque être humain est fait à la ressemblance et à l'image de Dieu et porte une dignité inviolable ; la violence de toute sorte doit être condamnée."
"Nous commençons à voir qu'il existe une différence subtile et croissante, et parfois pas si subtile, entre la protection contre la violence à l'égard de tous et l'approbation d'une certaine vision du monde", a déclaré Koach, qui "peut aller à l'encontre de la dignité humaine innée, aller à l'encontre de la nature et du but de la famille humaine. Nous avons vu, de plus en plus, des régimes passer de notions de protection pour tous à l'exportation d'une vision du monde qui va à l'encontre de ces notions de protection et promeut une nouvelle compréhension de cette nature de la personne humaine et du sexe humain."
Poussée sur l'idéologie du genre
M. Koach a déclaré que cette pression n'est pas nouvelle, mais "elle a pris de l'ampleur, elle s'est développée et est devenue moins voilée." Il a fait référence aux directives de l'Agence américaine pour le développement international de juin 2021 pour "l'intégration des considérations LGBTI+ dans les programmes d'éducation", qui, selon lui, "donne des conseils très précis aux entrepreneurs ou aux ONG qui mettent en œuvre des programmes éducatifs [sur] la façon de réorienter et de reprogrammer le matériel éducatif, pour affirmer votre éventail d'idéologies de genre ou d'orientations sexuelles".
-
Dans cinquante jours : la béatification de Jean-Paul Ier
De Vatican News (Alessandro Di Bussolo):
11 juillet 2022
Béatification de Jean-Paul Ier: le programme se précise
La messe de béatification du Pape Jean-Paul Ier sera célébrée sur la Place Saint-Pierre le 4 septembre prochain. Un temps de prière est prévu à Rome la veille au soir, tandis qu’une messe d’action de grâce aura lieu le dimanche suivant dans le village natal d’Albino Luciani, en Vénétie.Il reste un peu plus de 50 jours avant la béatification de Jean-Paul Ier, prévue le dimanche 4 septembre sur la place Saint-Pierre à 10h30, au cours d’une messe présidée par le Pape François.
À Rome ainsi qu’à Canale d’Agordo, village d’origine du pontife italien entouré des cimes des Dolomites, les cérémonies sont en train d’être peaufinées, mais plusieurs éléments sont déjà connus.
Comment participer à la messe?
Ainsi, au cours de la messe de béatification, la pétition – demande officielle de béatification adressée au Pape - sera lue par Mgr Renato Marangoni, évêque du diocèse de Belluno-Feltre, le diocèse d’origine du Pape Luciani, qui est aussi le siège exceptionnel de sa cause de canonisation. Le postulateur de la cause, le Cardinal Beniamino Stella et la vice-postulatrice Stefania Falasca seront eux aussi présents. Le postulateur fera don au Saint-Père d'un reliquaire contenant une relique du nouveau bienheureux.
Pour participer à cette célébration du 4 septembre, les billets - gratuits - doivent être demandés à la Préfecture de la Maison pontificale, tandis que tous les évêques et prêtres qui souhaitent concélébrer et les diacres qui souhaitent assister à la messe doivent s'inscrire directement sur: biglietti.liturgiepontificie.va
La veille, samedi 3 septembre, à 18h30, une veillée de prière aura lieu dans la basilique Saint-Jean-de-Latran, présidée par le cardinal Angelo De Donatis, vicaire général de Sa Sainteté pour le diocèse de Rome. Jean-Paul Ier a pris possession de cette basilique, qui contient la chaire de l’évêque de Rome, le 23 septembre 1978. Le temps de prière sera animé par des chants et des lectures de passages du magistère de Jean-Paul Ier. Aucun billet ne sera nécessaire pour y assister, l'entrée étant gratuite.
L’Église de Vénétie en fête
La messe d'action de grâce pour la béatification de Jean-Paul Ier aura lieu le dimanche 11 septembre dans le diocèse de Belluno-Feltre. Elle aura lieu à 16h00 sur la place de Canale d'Agordo, avec la participation des évêques et des communautés des trois sièges épiscopaux dans lesquels Jean-Paul Ier avait exercé son ministère sacerdotal et épiscopal. Autrement dit, le patriarcat de Venise, dirigé par Mgr Francesco Moraglia, le diocèse de Belluno-Feltre, avec Mgr Renato Marangoni, et le diocèse de Vittorio Veneto, qui a pour évêque Mgr Corrado Pizziolo. La messe sera présidée par le patriarche Francesco Moraglia, métropolite de la province ecclésiastique de Venise.
Protéger son héritage matériel et spirituel
Dans les jours précédant la béatification, une conférence de presse se tiendra au Bureau de presse du Saint-Siège, à laquelle participeront également la jeune fille argentine miraculeusement guérie en 2011, grâce à l'intercession du vénérable Jean-Paul Ier, Candela Giarda, sa mère Roxana Sousa et le père José Dabusti, le curé de l'église voisine de l'hôpital de Buenos Aires où Cande était soignée et qui a suggéré d'invoquer Jean-Paul Ier.
La cause de canonisation de Jean-Paul Ier a été ouverte en 2003, vingt-cinq ans après sa mort, dans son diocèse natal de Belluno-Feltre, et s'est conclue le 9 octobre 2017 par le décret sur les vertus sanctionné par le Pape François. «L'ouverture de la cause, souligne la vice-postulatrice Stefania Falasca, vice-présidente de la Fondation vaticane Jean-Paul Ier, a également rendu possible un travail fondamental qui n'avait jamais été fait auparavant et qui nous permet de parler en connaissance de cause de Luciani: l'acquisition des sources. Un travail de recherche, de protection du patrimoine, d'étude de son œuvre et de son magistère qui est aujourd'hui mené par notre Fondation», ajoute-t-elle.
-
Une rencontre avec la "femme pro-vie" de l'année
De Maisy Sullivan sur Catholic News Agency (CNA) :
Rencontrez la "femme pro-vie de l'année" : Lauren Muzyka, de Sidewalk Advocates for Life.

Lauren Muzyka, qui a été nommée femme pro-vie de l'année le mois dernier. | Sidewalk Advocates for Life9 juilet 2022
Lauren Muzyka, présidente et directrice générale du groupe pro-vie Sidewalk Advocates for Life (SAFL), a été nommée femme pro-vie de l'année lors de la conférence des femmes pro-vie qui s'est tenue à Indianapolis le mois dernier.
Les efforts de Mme Muzyka, ainsi que l'aide de tous les défenseurs des trottoirs, permettent de sauver près de "4 500 bébés par an... Ce sont des statistiques où une mère a réellement choisi la vie pour son bébé", a-t-elle déclaré à CNA.
Muzyka supervise le programme de la SAFL, où elle soutient pacifiquement la mission et la vision de l'organisation, qui consiste à offrir aux femmes des alternatives à l'avortement qui leur permettent de vivre en dehors des cliniques d'avortement.
L'énoncé de mission de la SAFL dit : "Nous avons pour mission de transformer le trottoir devant chaque clinique d'avortement en Amérique et au-delà en un lieu d'aide et d'espoir réels et de mettre fin à l'avortement."
Sa foi catholique, dit-elle, joue un rôle majeur dans son travail de leader pro-vie.
"Quand vous savez que chaque vie humaine qui vient à l'existence est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela vous aide à réaliser ce qui est en jeu dans la bataille de l'avortement et dans le mouvement pro-vie dans son ensemble, n'est-ce pas ?" a-t-elle demandé. "C'est donc beau et motivant de savoir que chaque âme éternelle qui croise notre chemin dans un centre d'avortement a une histoire."
Mme Muzyka a également raconté à CNA l'expérience la plus émouvante qu'elle ait vécue en tant que militante sur le trottoir.
Elle a parlé à une femme qui était sur le point d'entrer dans un centre d'avortement et l'a orientée vers un centre de grossesse favorable à la vie. La femme a écouté, mais s'est tout de même rendue dans le centre d'avortement afin de pouvoir évaluer ses options. La femme a ressenti l'obscurité du centre d'avortement et a choisi la vie. Quelques mois plus tard, Muzyka a pu tenir cet enfant dans ses bras. C'est le premier bébé qu'elle a pu rencontrer et dont elle a personnellement aidé la mère en tant qu'avocate de trottoir.
Elle se souvient d'avoir prié pour pouvoir vivre cette expérience et qualifie sa prière exaucée de "moment très spécial".
Pour son travail, Mme Muzyka a reçu le prix de la femme pro-vie de l'année. Abby Johnson, militante pro-vie et fondatrice de la conférence, lui a remis ce prix à la fin de la conférence.
"Grâce à la vision de Lauren, à ses efforts, à la vision de Dieu, à Sa main dans sa vie, à la formation qu'elle a mise en place et aux personnes qui se trouvent sur le trottoir, [ces femmes] ont pris une décision différente et ont choisi la vie", a déclaré Mme Johnson.
Mme Muzyka a accepté le prix au nom de tous les "saints défenseurs des trottoirs" et a déclaré à CNA qu'elle était touchée par cet "honneur incroyable".
La conférence a débuté le 24 juin, le jour où la Cour suprême a annulé l'arrêt Roe v. Wade, qui a légalisé l'avortement dans tout le pays en 1973. En réaction, Mme Muzyka et de nombreuses autres femmes pro-vie ont fait la fête ensemble.
"C'était une célébration comme vous n'en avez jamais vu auparavant", a déclaré Muzyka dans un communiqué de presse. "Je suis en admiration devant ce que Dieu a fait. Ces moments resteront à jamais gravés dans mon cœur."
L'expérience de plus de 20 ans de Muzyka dans la défense des trottoirs pro-vie ne se termine pas avec le renversement de Roe v. Wade. Au contraire, elle a déclaré que "le cœur de ce ministère consiste à donner aux [femmes] des options, des ressources, de l'espoir et de l'aide" et qu'il y aura toujours des femmes prêtes à franchir les frontières des États pour obtenir des services d'avortement.
"Ce n'est pas parce que l'arrêt Roe est terminé que les grossesses inattendues sont terminées", a déclaré Mme Muzyka. La principale question du mouvement pro-vie est donc la suivante : "Comment pouvons-nous atteindre au mieux les femmes de notre communauté avant qu'elles ne soient tentées de franchir les frontières de l'État et de considérer l'avortement comme une solution ?"
Muzyka a invité "toute personne qui a le cœur à atteindre les mères en crise". Elle a ajouté que toute personne qui plaide en faveur de services de grossesse favorables à la vie peut faire une "différence incroyable".
Lien permanent Catégories : Actualité, Débats, Défense de la Vie, Eglise, Ethique, Famille, Foi, International, Politique, Société, Solidarité, Témoignages 0 commentaire