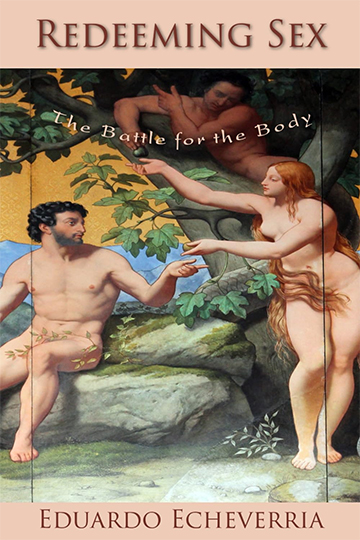D' sur le site du Figaro (extraits) :
«Nous ne voulons pas d’une société qui donne la mort» : à Paris, la «marche pour la vie» à l’épreuve du calendrier politique
Pendant que les bénévoles terminent les préparatifs. Geneviève Bourgeois, gériatre et porte-parole de la «marche pour la vie», inscrit le sujet dans une lecture historique, et met en garde contre une pente qu’elle estime déjà observable ailleurs en Europe : «Plus on regarde l’histoire, que ce soit en France ou dans les autres pays d’Europe, plus on se rend compte que depuis plus de 50 ans un mouvement mortifère tente de s’emparer de la conscience collective et attire les politiques vers des décisions toujours plus contraires à la vie.»
Marie-Lys Pellissier, autre porte-parole, assume la ligne politique du mouvement : «Nous ne voulons pas d’une société qui donne la mort mais d’une société qui protège et accompagne les plus fragiles, à tous les moments de leur vie, quels que soient leur état de dépendance et le coût de leur existence.» Face à l’expression de «droit à mourir dans la dignité», elle oppose un autre impératif : «Nous demandons un droit effectif - et je dis bien effectif - à un accompagnement médical complet, c’est-à-dire aux soins palliatifs, seule solution légitime au problème de la fin de vie en France.» Le Sénat a remplacé «le droit à l’aide à mourir» par «une assistance médicale à mourir» : qu’en penser ? Marie-Lys Pellissier tranche : «Il est question d’assistance médicale, donc on considère le fait de donner la mort comme un soin.»
«Là où la vie cesse d’être inviolable, l’homme perd sa liberté»
À 14 heures, la place Vauban change de visage. Les arrivées s’accélèrent, par vagues. Des familles, des groupes de jeunes, des couples, des personnes âgées. Les pancartes se distribuent rapidement : «La souffrance se soigne, la vie se protège», «La dignité, pas la mort», «Soigner, pas supprimer ». L’ambiance est joyeuse, paisible, presque festive - une légèreté revendiquée, comme pour éviter de réduire la marche à une procession de contestation.
Sur la scène, les discours prennent un ton plus martial. Mgr Dominique Rey, évêque émérite de Fréjus-Toulon, dénonce : «Ce projet de loi est un dévoiement de la mission du corps médical, qui est de protéger la vie. L’histoire l’a montré, là où la vie cesse d’être inviolable, l’homme perd sa liberté.» Vient ensuite le témoignage de Maxence Clicquot de Mentque. 21 ans, étudiant à Toulouse, atteint de la myopathie de Duchenne, il dit sa joie de vivre malgré un corps très atteint. Un hommage suit, à Charlie Kirk, «mort pour avoir défendu la vie», influenceur américain conservateur et représentant de la jeunesse pro-Trump, tué par balle sur un campus d’une université de l’Utah le 10 septembre 2025. Puis le cortège s’élance.
La marche avance pour une boucle dans le quartier. Parmi les jeunes regroupés près de la tête, Gonzague, 23 ans, venu de Bourgogne, ne cache pas une forme de colère froide : «Malgré le fait que la loi avance dans son processus législatif, il faut ne rien lâcher. Même si la loi passe, le but est aussi d’influencer l’opinion, de montrer que la jeunesse se mobilise et que la vie doit être défendue quoi qu’il arrive.» Il poursuit : «Si l’euthanasie est inscrite dans la loi, ça ne nous empêchera pas de défendre la vie de sa conception jusqu’à sa fin. Les législateurs ne se rendent pas compte qu’ils ouvrent une boîte à toutes les dérives.» (...)
Selon les organisateurs, la «marche pour la vie» 2026 a rassemblé 10.000 participants, et 7.300 selon la préfecture de police de Paris au plus fort de la manifestation. (...)