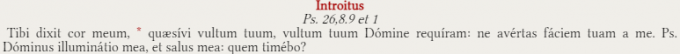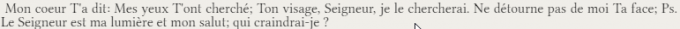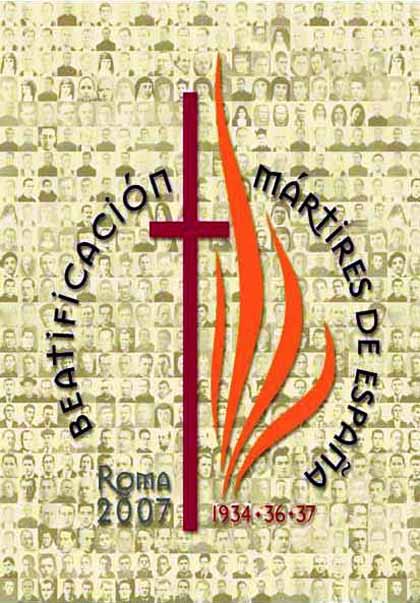De George Weigel sur le Catholic World Report :
Des nids-de-poule sur la route vers le Synode 2024
L’idée selon laquelle « l’expérience synodale » a mis l’Église en mouvement vers la mission est historiquement absurde.

Quant à la chose lassante : le cardinal Jean-Claude Hollerich, SJ, rapporteur général des synodes 2023 et 2024, nous a informé dans un communiqué de presse du 14 juin du bureau du synode du Vatican que « le Saint Peuple de Dieu a été mis en mouvement pour la mission grâce à l'expérience synodale ». Eh bien, non, Votre Éminence, ce n'est pas tout à fait exact.
Il y a deux millénaires, le Seigneur Jésus a lancé le peuple saint de Dieu dans la mission, lorsque le groupe apostolique a reçu l’ordre d’« aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit… » (Matthieu 28, 19). Les apôtres ont été confirmés dans cette mission par l’effusion du Saint-Esprit rapportée dans Actes 3, et l’Église a continué sa mission depuis lors. Le caractère et la portée de la mission de l’Église au XXIe siècle ont été définis par le pape saint Jean-Paul II dans l’encyclique de 1990, Redemptoris Missio (La mission du Rédempteur), qui enseignait que chaque catholique est baptisé dans une vocation missionnaire et que le territoire de mission est partout. Les parties vivantes et dynamiques de l’Église mondiale ont adopté cet enseignement et le vivent aujourd’hui.
L’idée selon laquelle « l’expérience synodale » a mis l’Église en mouvement pour la mission est donc absurde sur le plan historique. C’est aussi de la propagande pour un exercice qui s’est jusqu’à présent enlisé dans le nombrilisme ecclésiastique contre lequel le cardinal Jorge Mario Bergoglio, SJ, a mis en garde dans le discours pré-conclave à la Congrégation générale des cardinaux qui l’a aidé à accéder à la charge de Pierre. Le pape François a réitéré cette mise en garde contre l’autoréférentialité ecclésiale dans une homélie le lendemain de son élection.
Quant au synode de 2023, il n’avait rien à voir avec la première Pentecôte chrétienne. Car après la descente du Saint-Esprit, les premiers chrétiens ne se sont pas assis en petit groupe dans la chambre haute en disant : « Waouh, c’était quelque chose. Parlons-en. » Non, ils sont allés directement dans les rues en mission, « et ce jour-là, le nombre des disciples s’est accru d’environ trois mille âmes » (Actes 3:41). Rien de tout à fait semblable n’a suivi les « Conversations dans l’Esprit » fastidieuses et manipulées en petits groupes au synode de 2024.
Les choses changeront-elles en octobre prochain, lors du Synode 2024 ? Il y a des raisons d’être sceptique.
Du 4 au 14 juin, un groupe de théologiens a travaillé – mes doigts maladroits ont presque tapé « woked ! » – pour aider à préparer le document de travail du Synode 2024, basé sur les rapports post-Synode 2023 que le Secrétariat général du Synode avait reçus. Les théologiens invités semblaient refléter les préoccupations du bureau du Synode en matière de DEI, bien que leur diversité ne soit pas particulièrement théologique. La théologie catholique aux États-Unis et les théologiens américains travaillant à l’étranger (dans certains cas, à dix minutes en taxi du bureau du Synode) comptent parmi les penseurs les plus créatifs de l’Église aujourd’hui. Pourtant, il faudrait chercher (et sans succès) des membres de l’Académie de théologie catholique basée aux États-Unis ou du Projet Sacra Doctrina basé aux États-Unis parmi ceux appelés à Rome pour cette consultation de dix jours – et ce malgré le fait que les membres de ces organisations cochent toutes les cases ethniques, raciales et de « genre » apparemment requises. Existe-t-il un parti pris implicite au bureau du Synode, selon lequel les orthodoxes dynamiques ne doivent pas postuler ?
Du 4 au 14 juin, un groupe de théologiens a travaillé - mes doigts maladroits ont failli taper "woked !" - pour aider à préparer le document de travail du Synode 2024, sur la base des rapports post-Synode 2023 que le Secrétariat général du Synode avait reçus. Les théologiens invités semblaient refléter les préoccupations du bureau du Synode en matière d'IED, même si leur diversité n'était pas particulièrement théologique. La théologie catholique aux États-Unis et les théologiens américains travaillant à l'étranger (dans certains cas, à dix minutes de taxi du bureau du Synode) comptent parmi les penseurs les plus créatifs de l'Église aujourd'hui. Pourtant, on chercherait difficilement (et en vain) des membres de l'Académie de théologie catholique basée aux États-Unis ou du projet Sacra Doctrina basé aux États-Unis parmi les personnes appelées à Rome pour cette consultation de dix jours - et ce malgré le fait que les membres de ces organisations cochent toutes les cases ethniques, raciales et de "genre" apparemment requises. Existe-t-il un préjugé implicite au bureau du Synode, selon lequel les orthodoxes dynamiques n'ont pas besoin de s'inscrire ?
Le cardinal Hollerich n’est pas le seul membre du Collège des cardinaux à raconter des histoires sur le « processus synodal » qui suscitent des inquiétudes quant au synode de 2024. Le secrétaire général du synode, le cardinal Mario Grech, a parcouru le monde depuis le synode de 2023, dans le cadre de ce que certains ecclésiastiques considèrent comme une campagne pour la papauté, ou du moins une campagne pour devenir un grand électeur lors du prochain conclave. Quoi qu’il en soit, l’interview du cardinal en mars dernier dans un journal suisse a déclenché plusieurs sonnettes d’alarme.
Le cardinal a d’abord admis que « lorsque nous parlons d’unité, de communion, nous ne faisons pas référence à l’unité de pensée ». Vraiment ? Ne sommes-nous pas en communion de conviction unifiée lorsque nous récitons ensemble le Credo de Nicée ? Le Credo des Apôtres ? Le catholicisme local – le genre de catholicisme dans lequel un péché grave en Pologne est une source de grâce à dix kilomètres de là, de l’autre côté de la frontière germano-polonaise – est-il vraiment catholique (ce qui, après tout, signifie « universel ») ?
Le cardinal a ensuite déclaré qu'il imaginait l'Eglise « comme un arc-en-ciel ». Une image intéressante, en effet. Grech est maltais, ce qui signifie que l'anglais lui est parfaitement familier. Il lui est donc impossible de ne pas saisir ce que signifie le fait de parler d'une « Eglise arc-en-ciel » dans la culture mondialisée d'aujourd'hui.
Le mois d’octobre promet d’être intéressant à Rome.