Selon Jean-Marie Guénois (le Figaro),
Le Synode s'achève sur une victoire importante pour le pape François
Au terme de trois semaines de débats, le pape a la possibilité d'ouvrir, au cas par cas, la communion pour les divorcés-remariés.
Les évêques réunis en Synode à Rome depuis trois semaines sur les questions du mariage et de la famille ont voté à plus des deux tiers requis, tous les articles du document final qui, si le pape François le confirmait, pourrait ouvrir, au cas par cas, la communion pour les divorcés-remariés.
Ce vote marque une victoire importante du pape réformateur après le refus, l'an passé, lors de la première session du même synode, d'une partie des évêques, d'avancer vers cette ouverture en direction des divorcés-remariés.
L'article 85 (traduction ICI) du document portait sur l'admission des divorcés remariés à la communion et sous certains conditions. (En fait, comme le fait remarquer S. Magister, il n'y est pas fait explicitement mention, ndbelgicathol) Sur les 94 articles c'est celui qui a reçu le moins de suffrages - avec 178 votes pour et 80 votes contre - mais qui passe toutefois la majorité des deux tiers, fixée à 177 voix pour 265 votants.
Sans être le sujet central de cette assemblée mondiale d'évêques, la question des divorcés-remariés en a été le sujet le plus brûlant et le plus disputé.
Loin d'un feu vert pour toutes les situations, c'est la proposition des évêques allemands qui a fini par emporter l'adhésion d'au moins les deux tiers du synode même si l'opposition à cette évolution a été très puissante pendant tout le temps des débats. Et le demeurera, en particulier de la part des épiscopats africains et polonais.
Le groupe germanophone a en effet proposé de mettre au point une série de «critères» pour évaluer - sous la responsabilité de l'évêque local - l'histoire de chaque couple de divorcés remariés qui seraient réellement motivés pour accéder aux sacrements de l'Eglise. Ensemble ils pourraient décider de leur admission à la confession et à la communion. Il s'agirait, à chaque fois, insiste-t-on à Rome, l'œuvre d'un «discernement» spécifique.
Le synode a donc transmis officiellement au pape ce «document final» et il reste à François la charge de décider de la mise en œuvre de cette nouvelle pastorale de l'Eglise qui contient toutefois de profonds germes de divisions au sein des communautés.
Mais il ne fait pas de doute que François ira dans le sens de cette ouverture puisqu'il l'a souhaitée, dès le début de son pontificat, convoquant en fait ce synode, pour faire passer cette mesure.
Le pape pourrait s'exprimer dans une «lettre apostolique» ou une «exhortation post synodale» ou sous une autre forme, il est souverain dans la modalité, qui pourrait être publiées au cours de «l'année jubilaire de la miséricorde» qu'il va ouvrir à Rome le 8 décembre 2015 pour aider l'Eglise à changer sa culture.
Ce qu'un évêque belge, Mgr Van Looy, résumait d'une formule: «c'est la fin du jugement des personnes. C'est la fin d'une Eglise qui juge et le début d'une Eglise qui écoute, qui parle. Nous avons une Eglise de tendresse envers tous. Cela pourrait être le début d'une Eglise nouvelle.»
(les "gras" sont du fait de belgicatho)
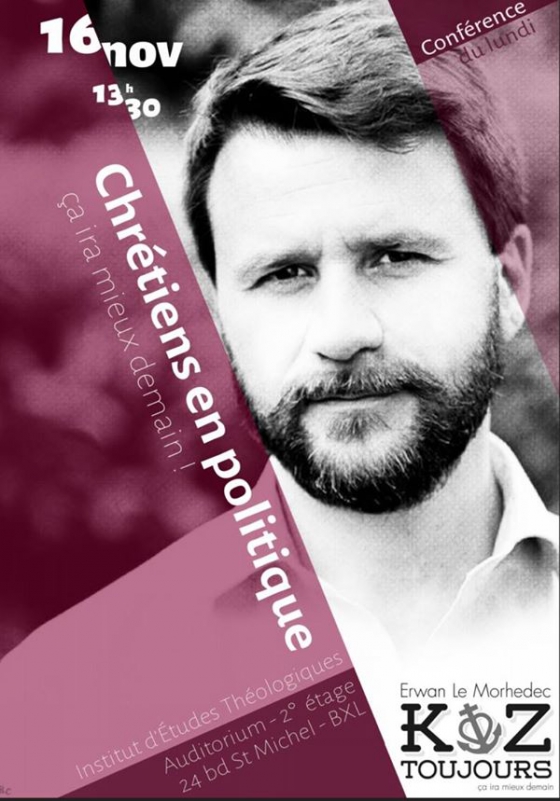
 L’Afrique a-t-elle sauvé le Synode sur la Famille d’une dangereuse dérive pastorale et doctrinale ? Après tant de défaitisme, les paroles élogieuses et optimistes du cardinal Wilfrid Fox Napier, archevêque de Durban, relatées ci-dessous, arrivent comme une bouffée d’air frais, alors que la session de l’assemblée synodale vient d’entrer dans sa dernière ligne droite. Les travaux en carrefours sont terminés. La présentation du rapport final et son vote sont programmés pour le samedi 24 octobre.
L’Afrique a-t-elle sauvé le Synode sur la Famille d’une dangereuse dérive pastorale et doctrinale ? Après tant de défaitisme, les paroles élogieuses et optimistes du cardinal Wilfrid Fox Napier, archevêque de Durban, relatées ci-dessous, arrivent comme une bouffée d’air frais, alors que la session de l’assemblée synodale vient d’entrer dans sa dernière ligne droite. Les travaux en carrefours sont terminés. La présentation du rapport final et son vote sont programmés pour le samedi 24 octobre. « Le discours du Saint Père pour le 50ème anniversaire de l’institution du Synode des Evêques, quoique non officiellement traduit dans les autres langues, a déjà fait l’objet de nombreux commentaires, surtout dans un climat de vives discussions synodales où la question de l’autonomie des conférences épiscopales revient souvent. Pour les tenants de cette ligne, le Pape vient les conforter dans leur position. Pour ceux qui craignent un émiettement ecclésial, c’est la perplexité. Le Pape serait-il en train de donner les conclusions du Synode avant la fin des travaux ? Cette forme d’interrogation ne serait pas la première, puisqu’elle a déjà été faite au sujet des Motu proprio sur la nullité en mariage, qui ont été promulgués avant la tenue de la deuxième partie synodale sur la famille. Pourquoi le Pape n’a-t-il pas attendu la fin du processus synodal pour rendre publique ces dispositions ? Est-ce le commencement de l’année de la miséricorde qui demandait cette célérité ? Il y a enfin ceux qui se disent qu’il y a dans ce discours du Pape une voie pour un nouveau départ dans la communion véritable. Devant les cris de victoire des uns, les interrogations des autres, et les lueurs d’espoir d’autres encore, les simples fidèles du Christ, vivant dans un coin perdu de l’Afrique, se demandent bien ce qui se passe. Ils veulent mieux comprendre les enjeux actuels de l’Eglise en synode.
« Le discours du Saint Père pour le 50ème anniversaire de l’institution du Synode des Evêques, quoique non officiellement traduit dans les autres langues, a déjà fait l’objet de nombreux commentaires, surtout dans un climat de vives discussions synodales où la question de l’autonomie des conférences épiscopales revient souvent. Pour les tenants de cette ligne, le Pape vient les conforter dans leur position. Pour ceux qui craignent un émiettement ecclésial, c’est la perplexité. Le Pape serait-il en train de donner les conclusions du Synode avant la fin des travaux ? Cette forme d’interrogation ne serait pas la première, puisqu’elle a déjà été faite au sujet des Motu proprio sur la nullité en mariage, qui ont été promulgués avant la tenue de la deuxième partie synodale sur la famille. Pourquoi le Pape n’a-t-il pas attendu la fin du processus synodal pour rendre publique ces dispositions ? Est-ce le commencement de l’année de la miséricorde qui demandait cette célérité ? Il y a enfin ceux qui se disent qu’il y a dans ce discours du Pape une voie pour un nouveau départ dans la communion véritable. Devant les cris de victoire des uns, les interrogations des autres, et les lueurs d’espoir d’autres encore, les simples fidèles du Christ, vivant dans un coin perdu de l’Afrique, se demandent bien ce qui se passe. Ils veulent mieux comprendre les enjeux actuels de l’Eglise en synode.