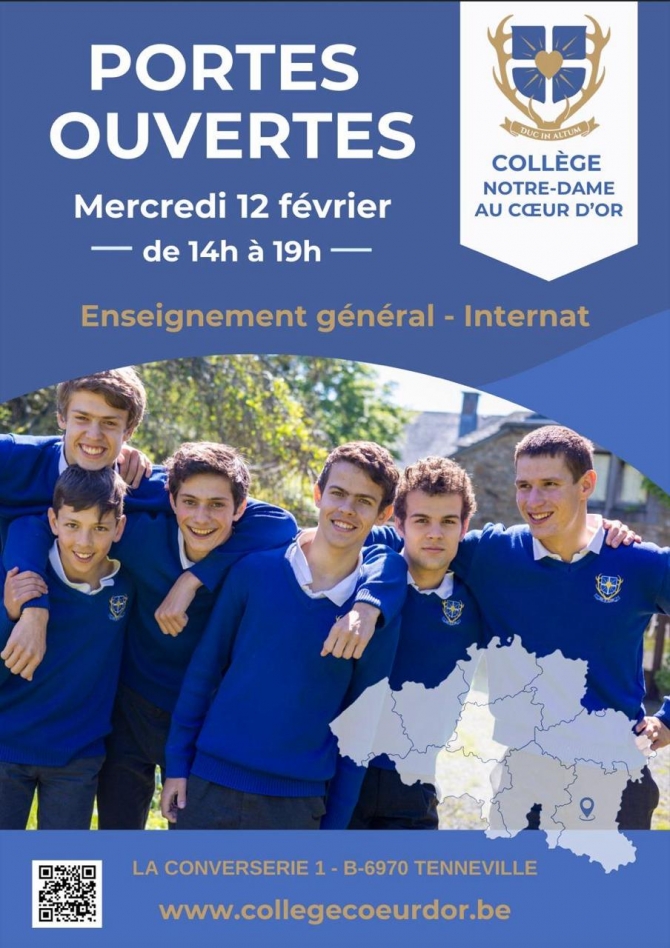Intervention de Grégor Puppinck, directeur de l'ECLJ, au Sénat espagnol, lors du 6e Sommet du Political Network for Values, les 1er et 2 décembre 2024.
Transcription:
Orienter la société vers la culture de vie, ce n’est pas seulement empêcher l’avortement et l’euthanasie par la loi. Car la véritable cause de la culture de mort est plus profonde : c’est la dépression morale de la société. La culture de mort est le fruit de l’athéisme et du matérialisme. C’est la volonté de puissance désespérée. Orienter la société vers la culture de vie, c’est d’abord rendre à la société sa vitalité : la joie et la fierté d’exister. C’est faire sortir la société de la dépression morale.
Il faut agir à trois niveaux, par ordre d’importance
Au niveau militant, politique, et religieux.
- Combattre les artisans de la culture de mort
Il faut combattre. Nous le savons tous dans cette salle. Nous sommes tous ici des combattants. Merci à Lola et au Political Network for Values de nous rassembler à Madrid. C’est une joie d’être ensemble.
Nous devons combattre le lobby de la culture de mort à tous les niveaux, dans toutes les institutions. Dans les parlements, dans les tribunaux, à l’ONU, etc.
Combattre la culture de mort, ce n’est pas seulement combattre le Planning Familial et les fondations Ford, Rokefeller, Soros, Gates et Buffet. Il faut aussi combattre ceux qui veulent avilir la vie, ceux qui veulent rendre la vie laide et triste : ceux qui promeuvent le désespoir, la drogue, la prostitution, la pornographie, et la mauvaise éducation sexuelle. Or, ce sont ces mêmes fondations qui promeuvent aussi l’avortement et l’euthanasie.
Ce combat pour la vie, nous le menons dans les institutions, à Genève, Strasbourg, New York, Bruxelles, Washington, San José et ailleurs ; nous menons ce combat comme des soldats sur un champ de bataille. Mais cela ne suffit pas, nous devons voir plus loin, nous devons aussi nous engager pour que la société soit de nouveau conquise par la culture de vie. C’est le deuxième niveau d’action, véritablement politique.
- Action au niveau politique: il faut aimer la vie et croire en son destin
Les peuples européens n’ont plus d’enfants parce qu’ils ont perdu le goût de la vie et ne croient plus en leur avenir, en leur destin.
Le vrai problème est que les peuples européens sont devenus dépressifs; c’est cela le problème principal : ils ne croient plus en leur avenir. Trop d’européens sont résignés au suicide démographique et au remplacement par l’immigration.
La culture de vie, aujourd’hui exige de renverser cette dépression terrible. Il faut rendre aux peuples européens le goût de la vie et la vision de leur avenir.
Je vois deux conditions pour cela :
Il faut d’abord aimer la vie, et il faut croire en son destin.
Aimer la vie. Cela paraît évident, mais il y a un travail énorme à faire, en particulier avec la jeunesse qui a grandi dans une culture sinistre. Il faut dire et répéter que la vie est magnifique, et que le monde est splendide. Il faut cultiver la vie, la culture et la joie.
La seconde condition pour lutter contre la dépression des peuples européens, est de croire en notre avenir, en notre destin.
Un peuple qui a honte de son passé et qui ne croit plus en son destin est déjà sorti de l’histoire.
À l’inverse, les « migrants » qui traversent l’Afrique et la Méditerranée au risque de leur vie ont une force immense, car ils doivent doit lutter pour vivre et croire en leur destin. Parmi eux, les musulmans immigrés en Europe savent pourquoi ils ont des enfants: ils croient que leur avenir est de conquérir l’Europe. Même s’ils sont pauvres, ils savent pourquoi avoir des enfants.
Il en est de même du peuple juif qui survit et traverse toutes les épreuves parce qu’il croit en son destin, et il sait pourquoi avoir des enfants.
C’est dans la dynamique d’un destin collectif, familial, professionnel et national que les personnes deviennent fécondes, qu’elles parviennent à l’excellence. Il faut cette dynamique vitale.
Pour cela, il faut des chefs politiques capables de donner le goût de la vie et la vision du destin national.
Le Président français Emmanuel Macron, comme d’autres dirigeants européens, n’a pas d’enfants, et il ne croit pas que la France, ni même l’Europe, puissent encore avoir un destin qui leur soit propre. Il a renoncé au destin national, et l’a échangé contre une illusion de futur mondial. Mais c’est une illusion. Les dirigeants tels que Macron n’ont pas compris qu’ils sont les seuls à faire ce rêve mondialiste. Les autres peuples ne veulent pas se dissoudre dans l’athéisme absurde de la mondialisation occidentale, ils ne veulent pas disparaître. Ils croient encore en leur raison d’être. Ils n’ont pas honte de leur histoire.
À l’opposé d’Emmanuel Macron, il y a Donald Trump: il incarne la vitalité américaine. Il aime la vie avec puissance, et c’est pour cela qu’il la défend. L’autre force de Donald Trump, c’est qu’il a été capable de rendre aux Américains leur propre destin. Il les a convaincus et entrainés dans la dynamique de Make America Great Again (rendre à l’Amérique sa grandeur).
Avoir ces deux forces est essentiel, mais cela ne suffit toujours pas, car l’homme a besoin de se dépasser lui-même, de se transcender. Et ce serait une erreur que de l’oublier. La patrie est trop étroite pour l’homme.
3. C’est le troisième niveau d’action : le niveau de la transcendance
Les communistes, les socialistes et les néolibéraux ont compris la force de cet idéal d’autodépassement, mais ils l’ont orienté contre la personne, la famille, la nation et l’Eglise, pour en «libérer» l’homme. Ce dépassement est présenté comme un progrès, mais il est surtout une destruction de la condition humaine.
Nous voyons aujourd’hui le résultat de cette «libération»: elle détruit l’homme.
L’autre autodépassement de l’homme qui est proposé à présent, c’est le rêve scientiste et transhumaniste. Mais c’est aussi une illusion.
Les rêves d’autodépassement communiste et scientiste ont en commun le rejet de Dieu et sont des alternatives désastreuses à la religion.
C’est parce que le peuple s’est détourné de la religion qu’il a adhéré à ces idéologies de substitution, et c’est pour cette raison aussi qu’il est devenu dépressif. Car un peuple athée qui rejette son passé et refuse son destin mène une existence absurde.
Une fois encore, regardons le peuple juif.
Le peuple juif survit et traverse toutes les épreuves non seulement parce qu’il aime la vie et croit en son destin, mais surtout parce qu’il sait que son destin est lié à sa fidélité à son alliance avec Dieu.
Les Chrétiens aussi ont une Alliance avec Dieu; les peuples européens ont été baptisés et sanctifiés par des saints innombrables. C’est cette Alliance avec Dieu – qui est source de toute vie – qui est la Vie – qu’il faut rénover.
La défense de la culture de vie exige de lutter contre l’athéisme criminel, et de rendre à la société l’amour de la vie, la confiance en son destin et la respiration de son âme.
Je vous remercie.