Ces derniers jours, le taux de fréquentation de belgicatho a battu tous ses records ; il est vrai que nous nous sommes postés sur toute une série de « fronts ». Nous avons emboité le pas aux adversaires français du « mariage pour tous », nous avons dénoncé un « traquenard » médiatique dans lequel la RTBF aurait attiré des jeunes « pro life », nous avons attiré l’attention sur des actes d’hostilité visant les chrétiens dans de nombreux pays, nous avons pointé des dérives dans l’enseignement et l’éducation, etc.
A tout moment en effet, en circulant d’un site ou d’un blog à l’autre, il y a moyen de trouver un nouveau fait, un nouveau contenu, de nouveaux échos susceptibles d’être relayés. Et cela jusqu’à notre dernier souffle ou jusqu’à une catastrophe qui nous priverait de l’Internet. Au risque de se laisser complètement accaparer par cette course à l’info et de déserter le monde concret où se joue notre existence, là où nous sommes impliqués au cœur des réalités quotidiennes : familiales, professionnelles, sociales, paroissiales, etc.
Bien sûr on ne peut imaginer abandonner le champ de l’information à ceux qui le labourent quotidiennement pour en extirper ce qui reste encore de notre culture chrétienne et y semer inlassablement les germes d’une mentalité individualiste, matérialiste, relativiste, etc. Il est donc bon que nous continuions à faire ce travail, tout particulièrement dans un contexte belge où, en-dehors des "médias catholiques" officiels, il n’existe pas grand-chose pour exprimer un point de vue catholique, en toute liberté et toute indépendance.
C’est d’autant plus urgent que, comme nous y avons déjà insisté, le monde médiatique francophone de Belgique se nourrit d’un consensualisme uniforme sans que personne ne vienne en perturber la troublante harmonie. Sur les questions de société, on ne trouve quasiment aucune discordance entre les discours tenus sur la RTBF, sur RTL, dans le Soir, dans la Libre ou dans le Vif. Nous vivons, plus sans doute que partout ailleurs, dans un contexte médiatique parfaitement homogène, tout à fait unilatéral, régi par la pensée unique, où toute prise de position discordante fait illico l’objet de dénonciations unanimes auxquelles l’establishment politique se joindra aussitôt. On se souvient encore de ces protestations émises officiellement par nos « responsables » politiques contre des positions du pape à propos du préservatif ou de l’homosexualité.
Mais s’il faut poursuivre ce travail, il faut aussi éviter de se laisser manger par lui au point de ne plus avoir de temps à consacrer à autre chose. Si nos visiteurs, et ils sont de plus en plus nombreux, apprécient notre travail, nous les invitons à y participer, à être moins consommateurs et davantage acteurs. Il leur suffit de nous adresser leurs commentaires, leurs suggestions, les infos dont nous ne disposons pas, leurs réflexions et leurs propositions. Ils contribueront ainsi à rendre ce blog plus vivant et plus attractif. Nous les attendons ; tout message adressé à belgicatho@gmail.com sera le bienvenu.
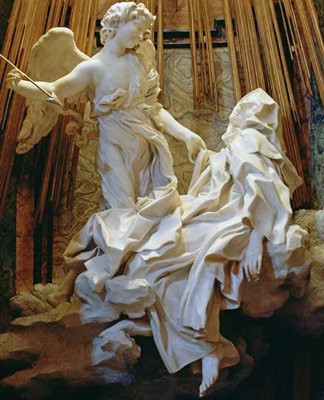
 Le Bethléem verviétois fêtera cette année son 150ème anniversaire. Il sera accessible du 22 au 30 décembre, au Musée d'Archéologie et de Folklore, rue des Raines 42 à Verviers.
Le Bethléem verviétois fêtera cette année son 150ème anniversaire. Il sera accessible du 22 au 30 décembre, au Musée d'Archéologie et de Folklore, rue des Raines 42 à Verviers. Les baroqueux, avec leur souci de restitution « authentique » ont introduit la controverse au sein du monde de la musique et des interprètes du chant choral ancien. Le site du magazine « Muse baroque » consacre un article à cette question :
Les baroqueux, avec leur souci de restitution « authentique » ont introduit la controverse au sein du monde de la musique et des interprètes du chant choral ancien. Le site du magazine « Muse baroque » consacre un article à cette question :