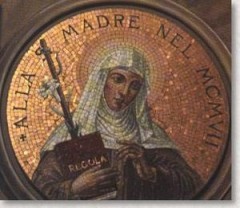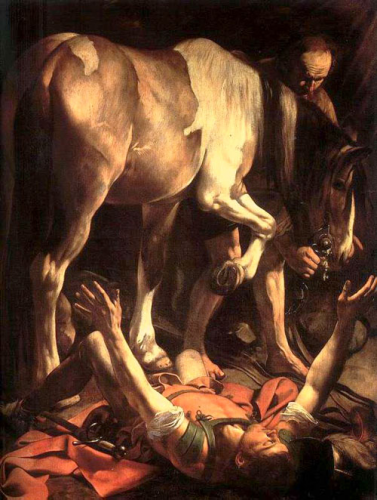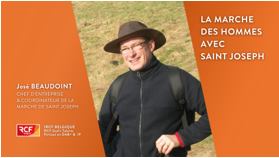Note de l'éditeur : Cet article est une couverture élargie de la Troisième Convocation internationale des Confréries du clergé catholique. La première partie comprenait des commentaires des cardinaux Robert Sarah, Gerhard Müller et Raymond Burke .
ROME — Les prêtres occidentaux sont aujourd’hui confrontés à une série de défis, allant de la baisse de la fréquentation des églises aux conditions financières critiques dans de nombreuses paroisses, qui, selon eux, sont aggravées par des messages confus et le peu d’encouragement venant du Vatican et des évêques.
Mais ils voient aussi des signes d’espoir — surtout parmi les jeunes — alors que les gens sont attirés par la beauté, la vérité et la bonté de la foi et commencent à exiger de l’Église des liturgies respectueuses, une doctrine saine et un sentiment de stabilité et de transcendance dans un monde désordonné.
Ce ne sont là que quelques-unes des observations faites par des membres du clergé d'Australie, des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Espagne qui se sont entretenus avec le Register en marge de la troisième Convocation internationale des confréries du clergé catholique qui s'est tenue du 13 au 17 janvier à Rome.
Fondée par le père américain Robert Levis en 1975, la Confraternité du clergé catholique est une association populaire de plus de 500 prêtres catholiques du monde entier, née des troubles post-conciliaires des années 1970.
« À l’époque, de nombreux prêtres partaient, et la confrérie a donc été fondée pour les encourager à rester », a déclaré Thomas McKenna, directeur exécutif de la confrérie. « Depuis, de nombreux prêtres ont déclaré qu’ils devaient leur décision de rester prêtres à la confrérie. »
Environ 75 prêtres ont assisté à l'événement qui comprenait des conférences des cardinaux Robert Sarah, Gerhard Müller et Raymond Burke .
Le père Paul Chandler, curé de la paroisse d'Inverell, dans l'archidiocèse de Brisbane, en Australie, a déclaré que « l'un des plus grands défis est le déclin de la foi », ce qui conduit à une diminution de la fréquentation des messes dans certaines églises de son diocèse, presque à zéro, car « les personnes âgées meurent et ne sont pas remplacées ».
D’autres prêtres ont fait écho à ce même problème. Le père Carlo Santa Teresa, un jeune prêtre de Camden, dans le New Jersey, a noté à la fois « une faible fréquentation de la messe et un manque de catéchèse ». Le père Philip De Freitas, curé de Tonbridge, en Angleterre, a également souligné ce déclin et l’a lié à une « perte de foi dans l’Eucharistie, la présence réelle du Christ ».
« Les gens ne s’en soucient plus vraiment », a-t-il dit. « Il semble y avoir une perte de respect à cause de la communion dans la main et de la liturgie en général, et tout le reste en découlera. »
La baisse considérable de la fréquentation des messes affecte naturellement les finances des paroisses. Un autre prêtre australien, qui a demandé à ne pas être nommé, a fait remarquer que les conditions financières étaient « choquantes » dans de nombreuses paroisses de son pays.
Encouragement des laïcs
D'autres prêtres présents à la conférence ont parlé d'un moral généralement bas, affirmant que même s'ils recevaient souvent des encouragements bienvenus de la part des fidèles laïcs, ils étaient fréquemment « découragés » par la hiérarchie et particulièrement par Rome.
Le père Chandler a déploré que le Vatican se concentre sur des questions telles que « les questions LGBTQ et le changement climatique » plutôt que d’écouter les préoccupations du clergé. Il a ajouté que c’était également « démoralisant parce que nous essayons, jour après jour, d’enseigner aux gens la foi, de les amener à la sainteté », mais a ajouté que ce n’est pas ce qui « semble préoccuper Rome ».
Mgr Charles Portelli, de l'archidiocèse de Melbourne, en Australie, a critiqué les « signaux contradictoires qui se font entendre en permanence » de Rome, et a cité comme exemples les ambiguïtés qui ont suivi la publication de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia du pape François en 2016 et de la déclaration du Vatican Fiducia Supplicans de 2023 , qui autorisait la bénédiction des couples de même sexe. « Ils ne cessent de déplacer les poteaux de but, et cela rend les évêques incertains ; ils ne savent pas trop quoi faire », a-t-il déclaré. « Et cela érode en fait les relations, en particulier la relation entre les prêtres et leurs évêques, qui devraient être comme celles d'un père et d'un fils, ou au moins d'un frère à un frère. »
Le père Nicholas Leviseur, prêtre de l'Ordinariat de Notre-Dame de Walsingham, qui permet aux anciens anglicans de devenir catholiques tout en conservant leur liturgie et leur patrimoine anglicans, a déclaré que « le plus grand défi auquel nous sommes confrontés est le diable. Je ne veux pas paraître plat, car c'est ce que tout prêtre devrait dire, mais ils ne le disent pas. Et cela est aggravé par un problème dans la société où les gens ne sont tout simplement pas prêts à assumer personnellement la responsabilité de quoi que ce soit. »
Il a également critiqué les évêques qui « refusent d’accepter qu’ils ne sont rien de plus ni de moins que des serviteurs du Christ et que leur tâche est le salut des âmes », une compréhension qui, selon lui, a été perdue, bien que le salut des âmes soit « le but principal du prêtre et le seul but du droit canon ». En conséquence, a-t-il déclaré, de nombreux évêques orthodoxes qui prêchent ces vérités centrales sont « pétrifiés par Rome », craignant d’être sanctionnés ou destitués, comme cela est arrivé à certains évêques et prêtres qui se sont exprimés sur ces questions.
Malgré ces griefs importants, les prêtres ont gardé espoir et se sont réconfortés des signes d’un renouveau de la foi dans leurs pays. Plusieurs d’entre eux ont affirmé que ce que les jeunes et les autres recherchent dans l’Église, c’est l’authenticité, la conviction, la beauté, la vérité et la bonté, ainsi qu’un sens de la transcendance et du surnaturel.
« Il peut parfois être très difficile de répondre à la crise actuelle », a déclaré le père Santa Teresa, « mais en même temps, malgré tout, les gens veulent toujours connaître la Parole ; ils ont ce désir de le connaître, de l’aimer. Ils cherchent toujours la vérité même s’ils disent qu’ils ne la recherchent pas. »
Les prêtres ont parlé avec enthousiasme du Jubilé de l'Espérance de cette année, et plusieurs d'entre eux dirigeront des pèlerinages à Rome plus tard dans l'année.
Des signes d’espoir
Il est intéressant de noter que de nombreux prêtres ont vu de l’espoir dans la messe traditionnelle en latin, même si peu d’entre eux la célébraient. Le père Chandler a déclaré que ses plus grandes congrégations et les paroissiens les plus jeunes assistaient à sa messe de rite ancien en semaine. « L’ancienne forme de la messe incite les gens à prier », a-t-il déclaré. « C’est un signe d’espoir. »
Le père Santa Teresa a déclaré qu'il avait « certainement » vu des signes d'espoir similaires dans la messe traditionnelle. « Dans un monde très chaotique, dans un monde qui semble avoir perdu tout sens de l'ordre, voir la précision de la liturgie traditionnelle, voir la beauté, les sons, chaque aspect de nos sens mobilisés, aide nos jeunes », a-t-il déclaré. « Les catholiques de mon âge désirent atteindre quelque chose de plus élevé que ce que le monde cherche à être. »
« Les jeunes sont attirés par la transcendance, mais ils veulent aussi une continuité historique », explique un prêtre qui a requis l'anonymat. « Ils savent qu'on leur a vendu un citron, après avoir lu l'histoire, et ils veulent trouver de l'authenticité. »
Un autre prêtre, s’exprimant également sous couvert d’anonymat, a déclaré que, tout comme en politique, en ces temps incertains, où les gens recherchent une « société beaucoup plus robuste », les gens recherchent également « un ensemble d’exigences beaucoup plus robustes » de la part de l’Église. Et cela nécessite en partie, a-t-il dit, « une plus grande clarté en termes d’enseignement et un environnement liturgique beaucoup plus sûr dans lequel ils peuvent prier et venir à Dieu ».
« Ils ne veulent pas que nous donnions des informations sur l'environnement, ils peuvent les obtenir en consultant The Guardian », a-t-il déclaré, faisant référence au journal socialiste britannique. « Ils recherchent des prêtres pour être prêtres. »
En réponse à la crise de l’Église et à ces signes d’espérance, le père Miguel Silvestre Bengoa, prêtre espagnol de l’Œuvre de l’Église, institut ecclésial de droit pontifical approuvé par saint Jean-Paul II en 1997, a souligné l’importance de mettre l’accent sur « le divin » dans l’Église, sur la « richesse de l’Église qui est Dieu lui-même qui habite en elle » plutôt que sur « la partie humaine : nos péchés, les scandales et la corruption ».
« Nous devons toujours regarder l’Église du point de vue surnaturel », a-t-il dit, et « essayer vraiment de montrer par notre vie la sainteté et la sainteté de l’Église ». Si chaque chrétien essayait de présenter la beauté de l’Église, a-t-il ajouté, « cela changerait beaucoup de choses ».
Il a particulièrement exhorté tous les prêtres à « se rapprocher de l’Eucharistie, de l’adoration » et à faire chaque jour une Heure Sainte devant le Saint-Sacrement, car « c’est le centre de notre vie ».
« Nous sommes appelés à être saints, et être saints signifie être avec le Saint, puis prêcher », a-t-il déclaré. Si les prêtres faisaient cela et évitaient de « tomber dans l’activisme », a déclaré le père Silvestre, « ils amèneraient les gens à l’Eucharistie, et tant de problèmes disparaîtraient ».