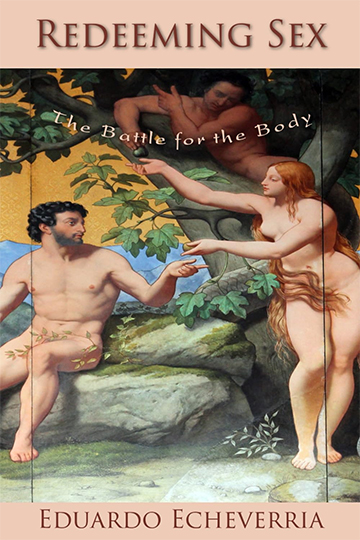Il n’est pas toujours évident de bien comprendre le pape Léon XIV lorsqu’il parle de paix. Dès sa première salutation après son élection, il l’a qualifiée de « désarmée et désarmante » — une formule à la fois poétique et exigeante, difficile à traduire en actes dans les nombreux conflits qui déchirent le monde.
Mais il l’a aussi qualifiée de « sauvage », dans son message solennel « urbi et orbi » de Noël (photo ci-dessus), en citant le poète israélien Yehuda Amichai (1924 – 2000) dans son anthologie publiée aux États-Unis : « Qu’elle vienne comme les fleurs sauvages, à l’improviste, car le champ en a besoin : une paix sauvage. »
« Amichai ne croit pas à la paix comme miracle », commente Sara Ferrari, spécialiste d’hébreu à l’Université de Milan. « La vraie paix ne naît pas de l’innocence, mais de la conscience d’être capable du mal. C’est un message profondément biblique. »
Et Léon n’atténue pas la réalité d’un mal qui envahit la terre. Dans son homélie de Noël — jour où « le Verbe a établi parmi nous sa fragile tente » — il a
poursuivi sans détour :
« Et comment ne pas penser aux tentes de Gaza, exposées depuis des semaines à la pluie, au vent et au froid, et à celles de tant d’autres réfugiés et déplacés sur chaque continent, ou aux abris de fortune de milliers de personnes sans-abri dans nos villes ? Fragile est la chair des populations vulnérables, éprouvées par tant de guerres en cours ou terminées, laissant derrière elles des ruines et des blessures ouvertes. Fragiles sont les esprits et les vies des jeunes contraints de prendre les armes, qui, sur le front, ressentent l’absurdité de ce qui leur est demandé et le mensonge dont sont imprégnés les discours grandiloquents de ceux qui les envoient mourir. »
Il n’est guère étonnant que nombre de ses propos — notamment ceux sur les soldats forcés à se battre sans raison, ou sur la course effrénée aux armements — soient repris et relayés par des mouvements pacifistes, catholiques ou non, pour défendre leurs thèses. Le message du 1er janvier pour la Journée mondiale de la paix, notamment, a fourni un terrain fertile aux pacifistes, dénonçant un réarmement démesuré allant « bien au-delà du principe de légitime défense ».
Mais c’est justement ce rappel à la « légitime défense » qui inscrit la condamnation des armes par Léon au sein du cadre de la doctrine bimillénaire de l’Église sur la guerre et la paix.
De la même manière, on ne peut imputer aux soldats ukrainiens — qui, depuis quatre ans, sacrifient héroïquement leur vie pour défendre leur pays et l’Europe — « le mensonge de ceux qui les envoient mourir ». Ce mensonge est en revanche imputable à l’agresseur, la Russie.
Dans ses discours, le pape évite de nommer explicitement ses cibles. Mais quand il dénonce avec force, dans son homélie des vêpres du 31 décembre, ces « stratégies armées visant à conquérir marchés, territoires, zones d’influence, dissimulées derrière des discours hypocrites, des déclarations idéologiques ou de faux motifs religieux », il ne fait pas référence à l’Ukraine ou à l’Europe mais bien à la Russie et à Vladimir Poutine, le patriarche Cyrille — ainsi qu’au maître de la Maison Blanche.
Pour dissiper tout malentendu sur le fond de sa pensée, le pape Léon a adopté une forme de communication informelle, presque chaque mardi soir, à son retour à Rome après sa journée de repos à Castel Gandolfo. C’est l’occasion pour lui se de prêter brièvement au jeu des questions et réponses avec les journalistes sur des sujets d’actualité avant de monter en voiture. Il répond en des termes sobres mais clairs, ou parfois par un silence dont il ne manque pas d’expliquer la raison.
Le 9 décembre, après avoir reçu à Castel Gandolfo le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a déclaré, à propos des enfants ukrainiens déportés en Russie, que le travail du Saint-Siège « se déroulait en coulisses » et « malheureusement très lentement ». Ajoutant : « Je préfère donc ne pas commenter, mais continuer à travailler pour ramener ces enfants dans leurs maisons, à leurs familles. »
Quant au plan de paix en 28 points proposé par Donald Trump — en concertation évidente avec Poutine —, le pape a répondu qu’il ne l’avait pas lu en entier, mais que : « Malheureusement, je crois que certaines parties de ce que j’ai vu apportent un changement considérable à ce que beaucoup ont considéré être pendant de nombreuses années, une véritable alliance entre l’Europe et les États-Unis. Je pense en effet que le rôle de l’Europe est très important, surtout dans cette affaire. Il n’est pas réaliste de chercher un accord de paix sans inclure l’Europe dans les négociations. La guerre se déroule en Europe, et je pense que l’Europe doit faire partie des garanties de sécurité que l’on recherche aujourd’hui et demain. Malheureusement, tout le monde n’a pas l’air de le comprendre. »
Il est évident que les « garanties de sécurité » invoquées par Léon pour l’Ukraine et l’Europe reposent largement sur les armes et les armées. Mais le pape rappelle souvent qu’il y a un autre chemin vers la paix — celui qu’il a par exemple rappelé lors de l’Angélus de la fête de saint Étienne, le protomartyr : « Ceux qui croient aujourd’hui en la paix et ont choisi la voie désarmée de Jésus et des martyrs sont souvent ridiculisés, exclus du débat public, et accusés de favoriser les adversaires et les ennemis. »
Il y a donc, dans la prédication de Léon, une distinction fondamentale entre d’un côté, une paix « désarmée » relevant d’un choix strictement personnel pouvant aller jusqu’au sacrifice de soi, comme l’a fait Jésus sur la croix, face au mépris du monde ; et d’un autre côté une paix « désarmée et désarmante », à travailler dans le monde civil, pour le bien de tous, afin que la force du droit l’emporte sur la force des armes.
Flavio Felice, président du centre d’études Tocqueville-Acton et professeur d’histoire des doctrines politiques dans plusieurs universités européennes et américaines — dont l’Université pontificale grégorienne —, a mis en lumière cette distinction dans un article publié dans le journal « Il Foglio » du 2 janvier :
« Le martyre est un acte suprême de la conscience qui engage la personne qui le choisit et dont les conséquences ne peuvent que retomber que sur cette dernière. On ne peut donc pas choisir le martyre pour autrui. Si un frère est attaqué, ne pas le secourir au nom de la paix équivaut simplement à le condamner à la défaite. Il n’y a aucune noblesse dans une telle omission qui ne peut résulter en une paix ‘désarmante’, il s’agit au contraire d’un ordre criminel et funeste, où le bourreau aura triomphé de la victime. »
En revanche, dans un cadre civil et à la lumière de la doctrine sociale de l’Église, la paix « désarmée et désarmante » dont parle Léon XIV « peut naître aussi de la légitime défense et de la dissuasion, afin que le bourreau ne triomphe pas de la victime, en œuvrant pour un ordre
institutionnel susceptible de rendre improbable le recours à la guerre et de remplacer la force brute par le droit. »
Ces considérations du professeur Felice rejoignent celles d’un autre analyste politique renommé, qui, dans l’éditorial du dernier numéro de la revue catholique progressiste « Il Regno » —
qu’il dirige depuis 2011 —, parvient à cette conclusion :
« Quand l’annonce chrétienne affirme que la paix est la synthèse de tous les biens messianiques, elle ne nie pas l’histoire ni la réalité. Et quand cette réalité est celle du mal, ce mal doit être combattu par tous les moyens moralement et juridiquement licites. Il y a un droit à la vie, à commencer par soi-même. Il est légitime — et c’est le magistère de l’Église qui l’affirme — de faire respecter ce droit. Et ce droit devient un devoir envers les autres, surtout pour ceux qui ont des responsabilités publiques, comme l’enseigne ‘Gaudium et spes’. Ainsi, la légitime défense, en plus d’être un droit, peut également devenir un devoir grave pour celui qui est institutionnellement responsable de la vie d’autrui. Défendre la vie de populations entières — en raison de leur faiblesse et de leur impuissance — exige de mettre l’agresseur hors
d’état de nuire, y compris par la force, si nécessaire. Ne pas intervenir, alors qu’on pourrait le faire, constitue une complicité par omission — et donc une faute. Le chrétien ne peut collaborer au mal. C’est ce que nous avons vécu en Europe à cause d’opportunismes, d’omissions et de peurs dans les années 1930. L’odeur était âcre, et la couleur était gris-cendre. »
Le pape Léon ne se berce pas d’illusions. Mais il ne capitule pas non plus. Il a réaffirmé à plusieurs reprises — y compris lors de son entretien avec les journalistes ce 9 décembre — que « le Saint-Siège est prête à offrir un lieu et des opportunités pour des négociations ». Et quand cette offre n’est pas acceptée — comme ça a été le cas — il répète : « Nous sommes prêts à chercher une solution, une paix durable et juste. »
Car le Saint-Siège a un rôle particulier à jouer en vue d’une paix « désarmée et désarmante », et Léon n’entend pas y renoncer. « Le Saint-Siège ne se positionne pas comme un acteur géopolitique parmi d’autres, mais comme une conscience critique du système international, une sentinelle dans la nuit qui voit déjà poindre l’aube, qui appelle à la responsabilité, au droit, à la place centrale de la personne », comme l’a souligné l’archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour les Relations avec les États, dans un entretien à l’agence SIR de la Conférence épiscopale italienne le 1er janvier.
Mais c’est surtout la vision grandiose du « De civitate Dei » de saint Augustin qui guide Léon XIV : les deux cités qui coexistent dans l’histoire et la conscience de chaque homme : la cité de Dieu, « éternelle, marquée par l’amour inconditionnel de Dieu, auquel est uni l’amour
du prochain », et la cité terrestre, « centrée sur l’amour égoïste de soi, la soif de pouvoir et la vaine gloire qui conduisent à la destruction ».
Le pape Léon XIV a largement développé cette distinction dans son discours annuel au corps diplomatique, le 9 janvier. Selon lui, saint Augustin «
souligne que les chrétiens sont appelés par Dieu à séjourner dans la cité terrestre avec le cœur et l’esprit tournés vers la cité céleste, leur véritable patrie. Mais le chrétien, vivant dans la cité terrestre, n’est pas étranger au monde politique et cherche à appliquer l’éthique chrétienne, inspirée des Écritures, au gouvernement civil. »
Respect du droit humanitaire même en temps de guerre, vérité des paroles dans les relations entre États, liberté d’expression, liberté de conscience, liberté religieuse en tant que « premier des droits humains », inviolabilité de la vie du sein maternel jusqu’à la mort naturelle : tels sont les fruits de ce regard tourné vers la cité de Dieu, à laquelle « notre époque semble plutôt encline à nier le droit de citoyenneté », a déclaré le pape aux diplomates.
Sur chacun de ces points et bien d’autres encore, Léon XVI s’est exprimé avec la transparence qui le caractérise. Concernant la persécution des chrétiens — « un sur sept » —, il n’a pas fait preuve de langue de bois devant « la violence djihadiste ». À propos du « court-circuit des droits humains », il a dénoncé la « limitation, au nom de prétendus nouveaux droits », des libertés fondamentales de conscience, de religion « et même de la vie ». Au sujet de la liberté d’expression, il a mis en garde contre « un langage nouveau, à l’odeur orwellienne, qui, dans sa volonté d’être toujours plus inclusif, finit par exclure ceux qui ne se conforment pas aux idéologies qui l’animent ». Concernant le conflit israélo-palestinien, il a appelé à la paix et la justice pour les deux peuples sur leurs propres terres. Et sur l’Ukraine, il a dénoncé « le fardeau de souffrances infligé à la population civile », avec « la destruction d’hôpitaux, d’infrastructures énergétiques, de logements », à la suite d’un « acte de force pour violer les frontières d’autrui ».
Ce discours du 9 janvier du pape Léon mérite d’être lu dans son intégralité dans la mesure où il s’agit presque d’un manifeste de son pontificat. Léon XIV y revisite saint Augustin à la lumière du monde actuel, un monde dans lequel « la guerre est revenue à la mode, et où une ferveur guerrière est en train de se répandre ».
— — —
Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l'hebdomadaire L'Espresso.
Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur diakonos.be en langue française.
Ainsi que l'index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.