 Chaque année, dans tous les diocèses du monde, prêtres, diacres et fidèles se réunissent pour célébrer la Messe Chrismale. Elle se célèbre normalement au matin du Jeudi Saint mais peut être anticipée. Ainsi dans de nombreux diocèses elle est célébrée le soir du Mercredi Saint et même avant.
Chaque année, dans tous les diocèses du monde, prêtres, diacres et fidèles se réunissent pour célébrer la Messe Chrismale. Elle se célèbre normalement au matin du Jeudi Saint mais peut être anticipée. Ainsi dans de nombreux diocèses elle est célébrée le soir du Mercredi Saint et même avant.
La Messe Chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au cours de cette célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.
Avec le Saint Chrême qui est l’objet d’une consécration spéciale, deux autres huiles sont bénites : l’Huile des Catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands ; et l’Huile des Malades qui sert dans la célébration du Sacrement des malades .
Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration qui manifeste l’unité de toute la communauté diocésaine autour de son évêque.
Elle nous offre un point de départ pour réfléchir au sens du sacerdoce royal du Christ dont dérivent le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel, deux modes qu’il convient de distinguer soigneusement l’un de l’autre, comme le démontre l’abbé Bruno Jacobs dans l’article ci-dessous paru dans le magazine « Vérité et Espérance - Pâque Nouvelle » (n°82, 1er trimestre 2012) Une réflexion d’autant plus appropriée qu’au soir même du Jeudi-Saint on célèbre aussi, à la messe commémorative de la Dernière Cène, l’institution des sacrements de l’Eucharistie et de l’ordre:
« Pourquoi les laïcs ne peuvent-ils pas présider l’Eucharistie, alors que tous les baptisés ont part au sacerdoce du Christ ? Pourquoi faire une distinction entre prêtres et laïcs ? Et d’ailleurs, le Christ n’était pas prêtre… Il arrive que des chrétiens d’aujourd’hui posent des questions ou font des remarques de ce genre, en rappelant que le Concile Vatican II a insisté sur le sacerdoce commun de tous les fidèles baptisés. Mais que signifie cette expression ? Récemment, je lisais dans un bulletin paroissial une réflexion semblable : … les laïcs peuvent exercer des charges dans l’Église… on appelle cela le sacerdoce commun des fidèles. S’agit-il seulement d’un droit de présider des célébrations, d’aider, voire de remplacer les prêtres devenus trop rares ? Lorsque le sens des mots n’est pas clair, le sens des textes – en l’occurrence ceux du Concile Vatican II, a peu de chances d’être compris. Il convient donc de clarifier les choses.
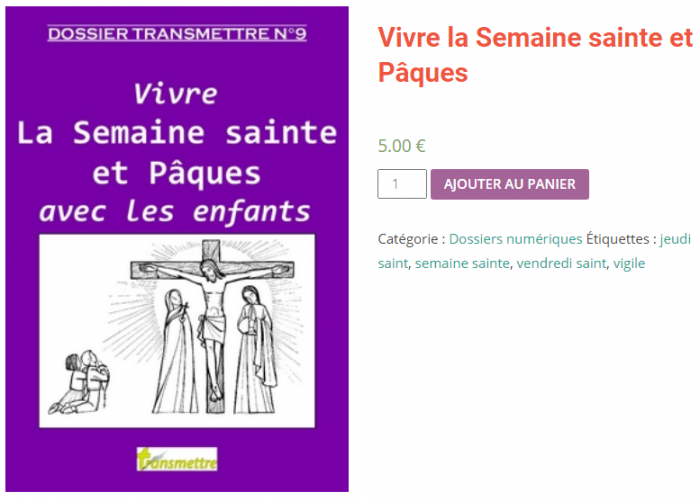

 Il y a trois ans tombait Arnaud Beltrame. Pour lui, le Ciel n’était pas loin :
Il y a trois ans tombait Arnaud Beltrame. Pour lui, le Ciel n’était pas loin :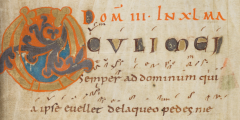 Aux Ve et VIe siècles, ce dimanche était pour les catéchumènes un jour de « scrutin », c’est-à-dire de réunion préparatoire au baptême, au cours de laquelle se pratiquaient des exorcismes. Si les textes que nous lisons aujourd’hui ne sont plus ceux de l’ancienne messe de scrutin, ils ne manquent pas d’un certain rapport avec les exorcismes de notre baptême où s’est ouverte notre lutte contre Satan.
Aux Ve et VIe siècles, ce dimanche était pour les catéchumènes un jour de « scrutin », c’est-à-dire de réunion préparatoire au baptême, au cours de laquelle se pratiquaient des exorcismes. Si les textes que nous lisons aujourd’hui ne sont plus ceux de l’ancienne messe de scrutin, ils ne manquent pas d’un certain rapport avec les exorcismes de notre baptême où s’est ouverte notre lutte contre Satan.
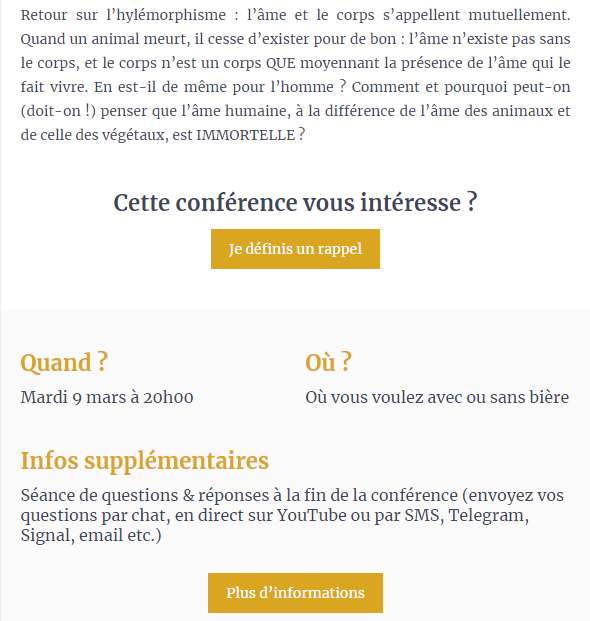
 Steven Van Gucht assure que le vaccin est sûr et ce, peu importe la marque. Après la période compliquée que nous avons vécue, le début vaccination est un signe d’espoir, souligne-t-il. L’évêque d’Anvers, pour sa part rappelle que nous avons reçu la vie de Dieu et que nous sommes tenus d’en prendre soin. Il appelle la communauté à se faire vacciner. C’est aussi la seule façon d’atteindre un seuil de sécurité suffisant que pour reprendre les activités au sein de l’Église, précise-t-il.
Steven Van Gucht assure que le vaccin est sûr et ce, peu importe la marque. Après la période compliquée que nous avons vécue, le début vaccination est un signe d’espoir, souligne-t-il. L’évêque d’Anvers, pour sa part rappelle que nous avons reçu la vie de Dieu et que nous sommes tenus d’en prendre soin. Il appelle la communauté à se faire vacciner. C’est aussi la seule façon d’atteindre un seuil de sécurité suffisant que pour reprendre les activités au sein de l’Église, précise-t-il.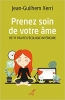 Dans cet épisode de La Foi prise au mot Régis Burnet reçoit la théologienne Marie-Dominique Trébuchet et le psychanalyste et essayiste Jean-Guilhem Xerri
Dans cet épisode de La Foi prise au mot Régis Burnet reçoit la théologienne Marie-Dominique Trébuchet et le psychanalyste et essayiste Jean-Guilhem Xerri 