C'est avec le plus grand sérieux que le Planning familial, organisme d'éducation populaire, nous assène des absurdités scientifiques. D'abord il y a eu cette campagne d'affichage : deux hommes enlacés, le ventre de l'un d'eux présentant une étrange rotondité. Et au-dessus cette légende : « Au Planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. » Qu'importe l'impossibilité biologique. Ensuite, il y a eu le lexique trans du Planning familial, « lexique rangé dans l'optique d'un apprentissage progressif ». Petit florilège.

« Sexe : Construit social basé sur des observations moyennes des différences biologiques entre les genres. Il est communément admis scientifiquement que le sexe est un spectre. Peut également désigner l'appareil génital.
Assignation à la naissance : À la naissance, les médecins décident, selon des normes de longueur du pénis/clitoris, si l'individu est un garçon ou une fille.
Changer de sexe : Les caractéristiques sexuelles de personnes, qu'elles soient cis ou trans, ne sont pas binaires et peuvent changer tout au long de leur vie ».
Nous serions heureux de connaître la « science » qui admet que chez l'Homo sapiens le sexe est un spectre. Il y a probablement confusion avec les crépidules ou autres animaux changeant naturellement de sexe au cours de leur vie. Nous serions également heureux de connaître la longueur critique de l'organe sexuel permettant de différencier un garçon d'une fille.
Mâle et femelle, des injures bien connues
Si vous n'avez pas bien compris, après quelques termes en novlangue tels que « Cis-passing, Stealth, Out, Dicklit, Femmis/Ladyck ou Morinom », le Planning nous présente gracieusement une liste de « Termes à ne pas utiliser » parmi lesquels viennent en premier lieu « Mâle/femelle » et « Masculin/féminin ». Des injures bien connues… C'est à partir de ce dogme antiscientifique, quasi-sectaire, de l'intersectionnalité – mot « savant » dont se pare l'idéologie woke – que le Planning se targue « d'éduquer » les enfants de la maternelle au lycée. Pour « Parler Lgbtphobie avec des collégien.nes » ajoutant prudemment « … en la présence d'un.e professionnel.le de l'établissement lors des séances avec l'animateur.rice du Planning familial » et invitant enseignants et élèves à « consulter le lexique trans » susmentionné ! L'écriture inclusive, cette écriture que l'on ne peut pas lire, étant bien sûr de rigueur !
Nos enfants, nos adolescents sont en danger. L'adolescence est un séisme physiologique, morphologique et psychologique. Dans cette période critique, l'adolescent est fragilisé, en proie au doute. Il recherche des appuis auprès de ses pairs mais aussi auprès de sources diverses, malheureusement pas forcément fiables ou bien intentionnées. C'est cette fragilité qu'exploitent les réseaux (si peu) sociaux où les contre-vérités foisonnent. Avec des résultats désastreux.
Le fourvoiement du Planning familial
Il n'est qu'à voir les résultats de la récente enquête Ifop menée pour les Fondations Jean-Jaurès et Reboot. On y apprend, par exemple, que 16 % des jeunes de 11 à 24 ans interrogés croient que la Terre est plate, proportion qui passe à 29 % chez les habitués de TikTok. C'est aussi par ce biais que sont véhiculés les messages outranciers incitant enfants et adolescents à changer de sexe. D'où l'effarante explosion des demandes de transition chez les jeunes, les filles surtout, que les pays occidentaux connaissent depuis quelques années. Certains pays, d'abord libéraux, désormais effrayés par l'ampleur du phénomène, font marche arrière et posent des jalons. La France ne semble pas encore s'émouvoir de ce nouveau scandale sanitaire.
Comment peut-on laisser un organisme tel que le Planning familial se fourvoyer dans une politique qui est à l'opposé de sa vocation originelle ? Où sont les luttes ayant permis la loi Neuwirth et la loi Veil ? Qu'est devenu le Planning qui a aidé de nombreuses jeunes filles et de nombreuses femmes (osons le terme) à accéder à la contraception et à l'avortement ? Depuis 2018 et sa conversion à l'intersectionnalité, ce n'est plus une dérive mais un naufrage. Le Planning est devenu le refuge de militants transactivistes. À ce scandale social s'ajoute un scandale financier. Car le Planning est un organisme financé par l'État et les diverses collectivités à hauteur de 2,8 millions d'euros par an. C'est-à-dire financé par le contribuable. À l'heure où il est nécessaire de contrôler des dépenses publiques surabondantes, il est urgent de conditionner les subventions du Planning familial au respect strict de ses orientations et finalités originelles.
Le Planning familialest l'une des trois associations ayant attaqué l'État en justice pour le contraindre à respecter la loi concernant l'éducation à la sexualité à l'école. Ces associations semblent ignorer que depuis de nombreuses années l'éducation à la santé et à la sexualité est inscrite aux programmes scolaires des différents niveaux. Il apparaît, en revanche, que le Planning familial s'est disqualifié et ne devrait plus être autorisé à intervenir auprès des écoliers, des collégiens et des lycéens. Tout du moins tant que l'organisme ne pourra pas garantir la refonte que nous préconisons, et la scientificité rigoureuse de ses propos, les formations du Planning familial constituent un danger pour la santé publique.
La diffusion subventionnée de telles contre-vérités scientifiques auprès d'adolescents en souffrance, en attente d'aide, est un véritable scandale. Il est urgent que des élus responsables et les ministères concernés se saisissent de ce problème de société. D'où notre cri d'alarme.
Signataires :
Claudio Rubiliani – physiologiste de la reproduction, docteur d'État et ancien inspecteur de l'Éducation nationale
Céline Masson, professeur des universités en psychopathologie clinique
Caroline Eliacheff, pédopsychiatre
Élisabeth Badinter, philosophe
Jean-François Braunstein, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne
Nathalie Heinich, sociologue
Xavier-Laurent Salvador, maître de conférences HDR, président du LAIC
Pierre Vermeren, historien et président du conseil scientifique du LAIC
Pierre-André Taguieff, philosophe et politiste, CNRS
Jean Szlamowicz, linguiste et professeur des universités
Claude Habib, professeur émérite de littérature
Marie-jo Bonnet, historienne, féministe, écrivaine
Nicole Athea, gynécologue endocrinologue
Gérard Rabinovitch, philosophe, essayiste
Leonardo Orlando, docteur en science politique
Jean-Pierre Winter, psychanalyste, essayiste
Béatrice Guilbault Finet, enseignant chercheur
Caroline Valentin, avocat
Israël Nisand, professeur émérite de gynécologie obstétrique
François Richard, professeur émérite à l'université Paris Cité, psychanalyste membre formateur de la Société psychanalytique de Paris
Patrick De Neuter, professeur émérite de l'université de Louvain
Marianne Baudin, professeur émérite de psychopathologie
Nicole FARGES, psychologue, psychanalyste
Christian Godin, philosophe
Louise L. Lambrichs, écrivain
Nadia Geerts, militante laïque et auteur belge
Stanislas Korczynski, assistant spécialiste en psychiatrie au CPN Nancy
Catherine Jongen, thérapeute de couple et sexothérapeute
Caroline Calba, professeur agrégé
Robert Naeije, médecin, ancien professeur des universités
Maurice Berger, pédopsychiatre, ex-professeur associé de psychopathologie de l'enfant
Fadila Maaroufi, directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles
Hala Oukili, journaliste
Paul Denis, neuropsychiatre, membre de la Société psychanalytique de Paris
Véronique Segonne, psychanalyste, ancienne attachée des hôpitaux de l'AP-HP
Michaël Saada, psychiatre, psychothérapeute
Jean-Marie Lacroix, professeur des universités (microbiologiste)
Monette Vacquin, psychanalyste
Nora Markman, psychanalyste-psychologue clinicienne
Sonia TIMSIT, psychiatre et psychanalyste.
Anne-Laure Boch, neurochirurgien
Beryl Koener, pédopsychiatre, MD PhD
Isabelle Denys, gynécologue médical, praticien hospitalier hôpital de Valenciennes
Michel Bruno, psychologue-psychanalyste
Laurent Le Vaguerèse, psychiatre-psychanalyste
Celine Pina, journaliste
Guillaume Gillet, psychologue clinicien, psychothérapeute
Jacqueline Schaeffer, membre titulaire formateur honoraire de la SPP (Société psychanalytique de Paris)
Fabienne Ankaoua, psychanalyste-dramaturge
Dominique Hof Mouzin, psychanalyste
Jean-Daniel Lalau, PU-PH au CHU d'Amiens (endocrinologie-nutrition)
Marie-Laure Léandri, psychanalyste membre titulaire de la SPP
Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes
Anne Paulsen, pédiatre endocrinologue
Yana Grinshpun, maître de conférences en sciences du langage
Georges Lecoq, psychologue
Anne Verheggen-Lecoq, psychologue
Houria Abdelouahed, psychanalyste
Geneviève Bourdellon, psychiatre, psychanalyste, membre formateur de la SPP
Assaf Gérard Fitoussi, psychologue médical et psychanalyste
Olivier Halimi, psychologue, psychanalyste. Membre de la Société psychanalytique de Paris
Rhadija Lamrani Tissot, psychanalyste
Caroline Calba, professeur certifié et agrégé d'anglais.
Christian Mosbah, psychiatre, psychanalyste
Monique Lauret, psychiatre, psychanalyste. Membre de la SPF
Anne Santagostini, psychiatre et psychanalyste
Catherine Jongen, thérapeute de couple et sexothérapeute
Sophie Audugé, déléguée générale et porte-parole SOS Éducation
Kérel Proust, psychologue
Michel Tibayrenc, généticien, directeur de recherche émérite institut de recherche pour le développement
Irène Nigolian, psychiatre, psychanalyste
Anna Cognet, psychologue clinicienne
Laetitia Petit MCF-HDR Aix-Marseille université
Dany-Robert Dufour, philosophe
Marie-Pierre Sicard Devillard, psychanalyste – SPF
Frédéric Jongen, philosophe, thérapeute de couples et sexothérapeute
Dominique A. Crestinu, gynécologue
J-Y Chagnon, psychologue et professeur des universités
Joseph Ciccolini, professeur de pharmacocinétique
Patrice Lévy, psychologue clinicien
Jean Marie Brohm, professeur émérite des universités
Brice Couturier, journaliste
Brigitte Letombe, gynécologue médicale
Georges Lecoq, psychologue
Ghada Hatem-Gantzer, praticien hospitalier médecin-chef de la Maison des Femmes
François Roudaut, professeur des universités
Gilbert Abergel, Comité Laïcité République
Mikhaïl Kostylev, journaliste
Emmanuelle Hénin
Renée Fregosi, philosophe et politologue
Gilles J. Guglielmi, professeur de droit public
Pierre-Henri Tavoillot, philosophe
André Tira, professeur de sciences économiques émérite
Michel Fichant, professeur émérite, Sorbonne Université
Albert Dojan, professeur d'anthropologie, université de Lille
Mireille Quivy, universitaire
Michel Messu, sociologue, professeur honoraire des universités
Alain Silvestre, médecin
Catherine Louveau, sociologue, professeure émérite
Guylain Chevrier, formateur et enseignant à l'université. Ancien travailleur social
Frank Muller, professeur des universités émérite
Catherine Louveau, sociologue, professeure émérite
François Vazeille, directeur de recherche émérite
Dominique Triaire, professeur émérite, université de Montpellier
Jean-François Mattei, médecin, anc. ministre de la Santé
Anne-Marie Le Pourhiet, professeur émérite de droit public
François Rastier, linguiste, directeur de recherche, CNRS
Vincent Tournier, maître de conférences de science politique
Michèle Tribalat, démographe
Aurélien Marq, haut fonctionnaire
Jean-Pierre Sakoun, Unité Laïque
Michèle Vianès, présidente de Regards de Femmes
Pascale Belot Fourcade, psychiatre
Sophie Dechêne, psychiatre infanto-juvénile
Luis Fernando Macias Garcia, professeur de sciences sociales et de philosophie
Ypomoni – collectif de parents d'ados en questionnement de genre
Liliane Kandel, sociologue et essayiste féministe
Sylvie Zucca, psychiatre
Didier Sicard, médecin, ancien chef de service de médecine interne
Gilles Falavigna, auteur
Patrick Miller, psychiatre et psychanalyste
Laurent Jolissaint, physicien, PhD
Fabien Ollier, directeur des éditions QS et de la revue Quel Sport ?

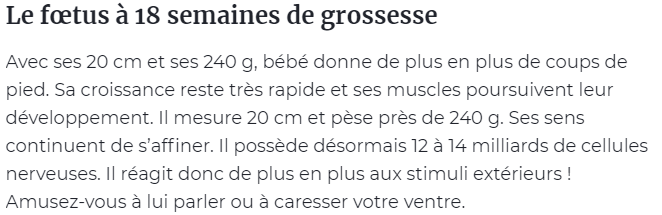




 « Les communications du Vatican, celles que le pape François gère personnellement, sont désormais une réalité très liquide et indéchiffrable. Cependant, il est certain qu'elles créent une grande confusion et désorientation.
« Les communications du Vatican, celles que le pape François gère personnellement, sont désormais une réalité très liquide et indéchiffrable. Cependant, il est certain qu'elles créent une grande confusion et désorientation.