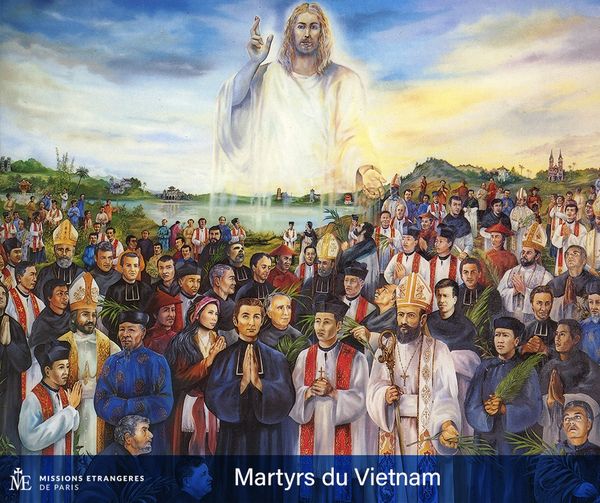En 2014, Ashur Sarnaya a fui l'Irak pour se réfugier en France afin d'échapper à l'État islamique. Plus de dix ans plus tard, le même sort l'a frappé. Alors que ce chrétien témoignait de sa foi devant une caméra, il a été assassiné par un inconnu. Un cas extrême, certes, mais loin d'être isolé : en Europe aussi, des personnes meurent parce qu'elles sont chrétiennes.
Le rapport annuel publié aujourd'hui par l'Observatoire de l'intolérance et de la discrimination envers les chrétiens (OIDAC) est alarmant : les agressions physiques contre les chrétiens – y compris les meurtres – ont augmenté en Europe en 2024. La pression juridique sur les chrétiens et les positions chrétiennes s'accroît également dans de nombreux pays : des zones d'exclusion autour des cliniques pratiquant l'avortement et l'interdiction des symboles chrétiens dans les espaces publics aux restrictions de la liberté de conscience et des droits parentaux, l'OIDAC a recensé de nombreux cas qui suscitent l'inquiétude au sein des communautés chrétiennes en Europe.
Les chiffres seront présentés au Parlement européen mardi.
Mardi, l'OIDAC présentera également son rapport à l'Intergroupe du Parlement européen sur la liberté de religion, de conviction et de conscience. Il s'agit d'une étape importante, car les discours politiques et médiatiques contribuent aussi à créer un climat qui favorise les actes antichrétiens.
Ce point a également été souligné dans un guide de l'OSCE publié en juin sur la lutte contre les actes antichrétiens. Ce guide attribue aux États une responsabilité centrale en matière de protection des communautés chrétiennes et souligne que, dans certains cas, « les discours et récits politiques ont contribué au maintien des préjugés et des stéréotypes antichrétiens ». L'OIDAC fait référence à des études internationales montrant que les médias véhiculent souvent des représentations stéréotypées ou déformées des questions religieuses : des exemples provenant de plusieurs pays démontrent comment la présentation négative et répétée des acteurs chrétiens peut abaisser le seuil de déclenchement de la violence.
En présentant ce rapport au Parlement européen, Anja Tang, directrice d'OIDAC Europe, souhaite « initier un débat factuel, dénué de toute considération politique et visant à trouver des solutions constructives ». La liberté de religion doit être davantage prise en compte, notamment en ce qui concerne les lois susceptibles de restreindre indirectement ce droit fondamental, a-t-elle expliqué à ce journal. Sa revendication spécifique : « Nous plaidons pour la création d'un poste de coordinateur européen de la lutte contre les crimes de haine antichrétiens, à l'instar des dispositifs existants contre l'antisémitisme et la haine antimusulmane. »
La collecte de données en Allemagne doit être améliorée.
Selon l'OIDAC, les pays les plus touchés par les actes antichrétiens sont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. L'organisation basée à Vienne a recensé 2 211 crimes de haine antichrétiens. Ses conclusions reposent sur sa propre documentation, les données officielles de la police et les documents d'autres organisations internationales, collectés annuellement par l'OSCE. Les infractions les plus fréquentes sont le vandalisme, les incendies criminels, les profanations, les agressions physiques, les vols et les menaces, auxquels s'ajoutent plusieurs incidents à motivation terroriste, dont certains ont été déjoués par les services de sécurité, précise le rapport. L'Allemagne arrive en tête du classement des incendies criminels d'églises en 2024 : 33 des 94 incendies criminels recensés – soit près du double de l'année précédente – ont eu lieu en Allemagne.
L’OSCE et l’OIDAC appellent les États européens à améliorer la collecte de données sur les crimes antichrétiens. En Allemagne, les crimes de haine antichrétiens sont actuellement enregistrés exclusivement dans le cadre de la criminalité à motivation politique. De ce fait, les infractions sans mobile politique évident – comme le vandalisme ou les incendies criminels – n’apparaissent tout simplement pas dans les statistiques. Tang a expliqué à ce journal : « Cela crée une image faussée. De nombreuses attaques restent invisibles, alors que la réalité sur le terrain est tout autre : de plus en plus d’églises doivent rester fermées en dehors des offices pour des raisons de sécurité. »
En 2023, les statistiques policières relatives aux crimes à motivation politique n'ont recensé aucun incendie criminel à caractère antichrétien. L'OIDAC, quant à elle, en a documenté 12 durant la même période. Le directeur de l'OIDAC déplore : « Malgré ce constat, le gouvernement fédéral ne juge pas nécessaire d'agir. C'est problématique. Il est urgent de mettre en place un système de statistiques indépendant recensant les crimes de haine antichrétiens et de proposer une formation ciblée aux policiers afin que ces incidents soient correctement identifiés et enregistrés. »
Le nombre de cas non déclarés est bien plus élevé.
Le rapport indique clairement que le nombre réel d'actes antichrétiens est probablement bien plus élevé dans de nombreux pays : l'OIDAC cite une étude anonyme menée en Pologne, selon laquelle près de la moitié des prêtres interrogés ont subi des agressions au cours de l'année écoulée, mais plus de 80 % n'ont pas signalé ces incidents, qui ne figurent donc pas dans les statistiques officielles. Les personnes interrogées font également état d'un sentiment d'insécurité croissant dans les espaces publics et pointent fréquemment du doigt les représentations médiatiques négatives qui, à leurs yeux, contribuent à ce climat hostile. Une étude espagnole a abouti à des conclusions similaires. Une autre étude menée en Grande-Bretagne confirme ces résultats : de nombreux chrétiens y font état de discriminations dans leurs milieux professionnels et sociaux, discriminations qui, elles aussi, sont souvent tues.
Les positions chrétiennes seront-elles bientôt illégales ?
Le rapport décrit en détail les restrictions légales croissantes qui affectent les chrétiens en Europe. Il met notamment l'accent sur la criminalisation de l'enseignement chrétien et de l'accompagnement pastoral . Par exemple, en Grande-Bretagne, plus de 1 000 responsables d'Églises chrétiennes ont averti qu'une nouvelle loi encadrant les prétendues « thérapies de conversion » pourrait aboutir à une interdiction de facto de l'éthique sexuelle chrétienne, car ses dispositions sont formulées de manière si vague que même les sermons, les prières ou les entretiens pastoraux pourraient être criminalisés.
Le rapport conclut que, dans ces conditions, même la transmission de croyances religieuses fondamentales comporte des risques juridiques. Les positions chrétiennes, comme la défense du fait – également prouvé biologiquement – de la binarité des sexes chez l’être humain, risquent d’être qualifiées de discours haineux et, par conséquent, de faire l’objet de discriminations, même en Allemagne.
L'éducation laïque est préférable à l'éducation religieuse.
Un autre chapitre aborde la restriction des droits parentaux et de l'éducation religieuse. Le rapport explique que les normes internationales relatives aux droits humains garantissent clairement aux parents le droit de déterminer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants. Néanmoins, l'OIDAC documente plusieurs cas d'ingérence grave. On peut notamment citer un arrêt de la Cour constitutionnelle espagnole interdisant à un père protestant d'emmener son fils à l'église ou de lire la Bible avec lui, conférant ainsi à la mère laïque l'autorité exclusive en matière d'éducation religieuse. L'OIDAC critique cet arrêt car il considère l'éducation laïque comme « neutre » et qualifie l'éducation religieuse de potentiellement nuisible, constituant ainsi une atteinte manifeste aux droits parentaux et à la liberté de religion.
Le rapport mentionne également des cas illustrant les tensions croissantes entre la présence religieuse dans l'espace public et les interprétations de plus en plus restrictives de la neutralité de l'État. Parmi ceux-ci figurent la menace de fermeture d'hospices catholiques en Grande-Bretagne suite à de nouvelles lois sur l'euthanasie, l'interdiction d'un crucifix dans une école bavaroise par un tribunal allemand et le retrait, ordonné par la justice, d'une crèche à Beaucaire, en France.
Selon l'OIDAC, de tels exemples témoignent d'une tendance qui problématise la visibilité publique du christianisme et relègue les expressions religieuses hors de la sphère publique.