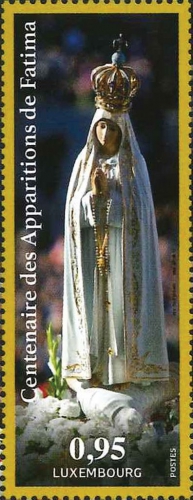A l’Université de Liège, le 4 avril prochain: un débat sur le thème « Immigration, identité et multiculturalité » organisé par l’Union des étudiants catholiques et le groupe de réflexion « Ethique sociale ». Plus que deux jours pour s’inscrire:
A l’Université de Liège, le 4 avril prochain: un débat sur le thème « Immigration, identité et multiculturalité » organisé par l’Union des étudiants catholiques et le groupe de réflexion « Ethique sociale ». Plus que deux jours pour s’inscrire:
Téléphone 04.344.10.89
email : uniondesetudiantscatholiqueliege@skynet.be
Annie Laurent est écrivain, journaliste et spécialiste du Moyen-Orient. Titulaire d’une maîtrise en Droit international, elle a obtenu un doctorat d’État en sciences politiques pour sa thèse sur « Le Liban et son voisinage ». Elle est, entre autres livres, l’auteur de « L’islam peut-il rendre l’homme heureux ? », aux éditions Artège. Le pape Benoît XVI l’a nommée experte au synode spécial des évêques pour le Moyen-Orient qui s’est tenu à Rome en octobre 2010. Elle a fondé un site consacré aux rapports du christianisme avec l’islam : «association Clarifier ».

Annie Laurent : « L’Islam est fragile »
Quand Annie Laurent répondait aux questions posées par le site « Aleteia » (2015) :
«L’islam est actuellement associé à une série d’événements désastreux : terrorisme, disparition des chrétiens d’Orient, etc. Comment l’expliquez-vous ?
Annie Laurent : L’islam connaît en ce moment une profonde remise en cause. Les musulmans ont accès à Internet partout dans le monde, même en Arabie saoudite ; ils voient d’autres formes de pensées, d’autres façons d’appréhender la religion. Une partie d’entre eux vivent dans des pays dont les racines sont chrétiennes, et cela se traduit naturellement par des interrogations sur leurs propres racines. Certains notamment sont agacés par la prétention de l’islam à régir leur vie avec des règles arbitraires. Chaque année, au Maroc, des jeunes gens mangent dans des squares en plein ramadan, bravant l’interdit religieux. Ils sont d’ailleurs régulièrement arrêtés par la police.
Pourtant, dans de nombreux pays, comme l’Irak, l’Arabie saoudite ou le Pakistan, l’islam se fait-il plus rigoureux, et volontiers violent. Le voyez-vous vraiment comme en déclin ?
La violence est un signe de faiblesse ! Je ne dis pas que l’islam va s’effondrer demain, mais qu’il va s’effondrer, inexorablement, et que cela occasionnera de grandes souffrances pour les musulmans et pour ceux qui vivent à leur contact. Cela prendra des décennies, et se traduira par des chocs terribles ! L’une des forces de l’islam, c’est qu’il prend en charge tout l’être humain. C’est une religion très encadrée, dans laquelle la conscience n’est pas interpellée. Chaque personne qui sortira de ce cadre connaîtra une profonde crise existentielle.
Ne pourrait-on pas imaginer un « Concile Vatican II de l’islam » ?
Plusieurs choses s’y opposent. Il manque d’abord à l’islam une structure faisant autorité sur l’ensemble des musulmans. Depuis la fin du Califat en 1924, il n’y a plus de Commandeur des croyants. Mais plus fondamentalement, la nature même du Coran fait obstacle à son évolution. Il s’agit d’un texte qui vient de Dieu Lui-même qui est incréé ! Dieu dit qu’Il a donné un Coran en arabe, qui est la copie d’un livre gardé auprès de Dieu. Personne n’a le droit d’y toucher. Or, ce texte immuable contient des commandements incompatibles avec la paix et la liberté.
Pourtant, certains intellectuels musulmans osent interroger leur foi…
Il y a une émulsion intéressante du côté de ce qu’on appelle « les nouveaux penseurs de l’islam ». Je
pense à Abdelmajid Charfi, auteur de L’islam entre message et Histoire. Un autre tunisien, Mohammed Charfi, tenait une chaire sous Ben Ali, il a écrit Islam et liberté. Mais ils sont souvent mal reçus ! Contrairement à ce que l’on imagine souvent, ils ont encore plus de mal à s’exprimer depuis le Printemps arabe. Le destin de ces intellectuels, comme Nasr Abou-zeid, qui a été banni comme apostat et a dû fuir aux Pays-Bas, ne me rend pas optimiste sur la possibilité d’une transition « en douceur » de l’islam.
Vous pensez donc que nous allons vers des temps difficiles…
Les musulmans, les premiers, vont vivre des dissensions terribles et de grandes souffrances. Tous les ingrédients de la violence sont là ! Il y a un texte qui la légitime pour affronter les infidèles et qui ne souffre aucune controverse, en plus d’un contexte géopolitique pour le moins compliqué. Je crois que l’islam va imploser et que ce sera violent. En tant que chrétiens, nous avons pour responsabilité de venir en aide aux musulmans qui souhaitent sortir de leur religion. »
Annie Laurent,"Immigration, identité,multiculturalité": lunch débat mardi 4 avril 2017 à 18h00, à la salle des professeurs, Université de Liège, bâtiment du Rectorat, place du 20 août 7, 1er étage (accès par l'entrée principale, parcours fléché). Renseignements et inscriptions: 04.344.10.89.
JPSC
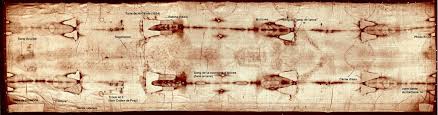



 « Au cours de cette session de 5 jours, les participants ont préparé le répertoire grégorien du Mercredi des Cendres. Les différents Offices de la journée, laudes, tierces, sextes, nonnes ainsi que la messe ont été chantés dans différentes basiliques de la ville, notamment Sainte Marie Majeure et Saint Paul hors les murs ainsi que Saints Jean et Paul al Celio, dont Mgr Joseph De Kesel est le Cardinal-prêtre. Ce fut donc une journée de pèlérinage chantant à travers toute la Ville Sainte. Une expérience inoubliable.
« Au cours de cette session de 5 jours, les participants ont préparé le répertoire grégorien du Mercredi des Cendres. Les différents Offices de la journée, laudes, tierces, sextes, nonnes ainsi que la messe ont été chantés dans différentes basiliques de la ville, notamment Sainte Marie Majeure et Saint Paul hors les murs ainsi que Saints Jean et Paul al Celio, dont Mgr Joseph De Kesel est le Cardinal-prêtre. Ce fut donc une journée de pèlérinage chantant à travers toute la Ville Sainte. Une expérience inoubliable.