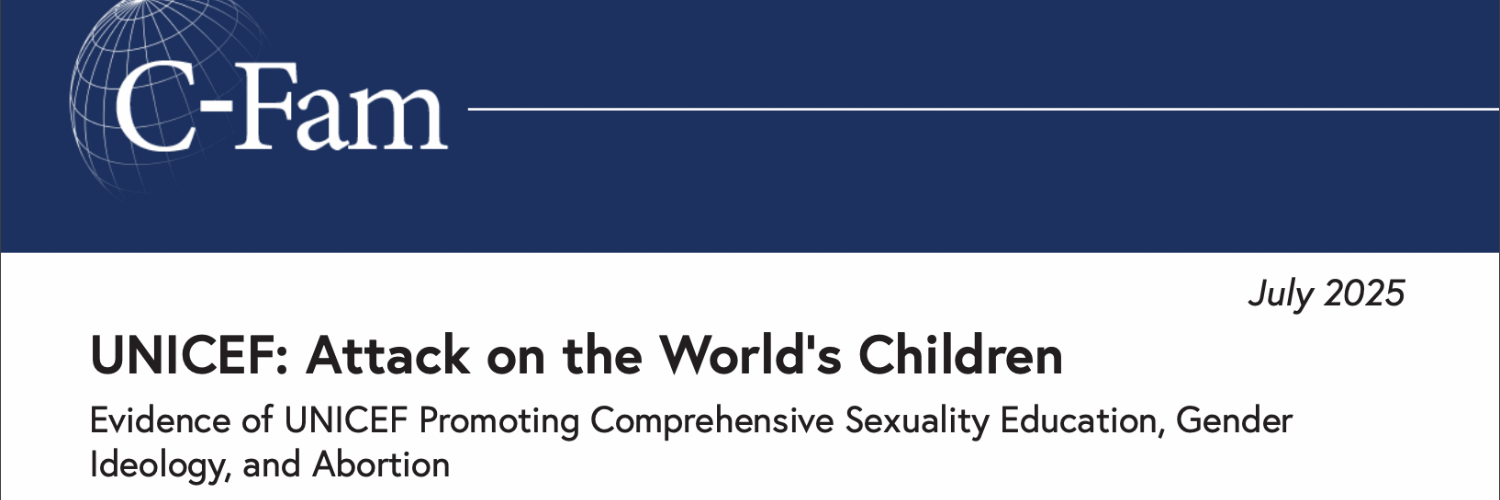Le pape Léon XIV a appelé les fidèles du monde entier à prier et à jeûner pour la paix ce vendredi 22 août, jour de la commémoration de la royauté de la Bienheureuse Vierge Marie.
« Marie est la Mère des croyants ici sur terre », a déclaré Léo à la fin de son audience générale mercredi, « et elle est également invoquée comme Reine de la Paix, alors que notre terre continue d'être blessée par les guerres en Terre Sainte, en Ukraine et dans de nombreuses autres régions du monde. »
Le pape Léon XIV a invité « tous les fidèles à consacrer la journée du 22 août au jeûne et à la prière, en implorant le Seigneur de nous accorder la paix et la justice, et de sécher les larmes de ceux qui souffrent à cause des conflits armés en cours ».
« Marie, Reine de la Paix », priait Léon, « intercède pour que les peuples trouvent le chemin de la paix. »
L'appel du pape faisait suite à une catéchèse dans laquelle Léon réfléchissait sur le récit de Jean de la Dernière Cène, en particulier sur le mystère du pardon, dramatisé par l'offrande d'un morceau de nourriture par le Christ au traître Judas Iscariote.
Léon XIV a qualifié cet épisode de « l’un des gestes les plus frappants et les plus lumineux de l’Évangile », affirmant qu’il s’agissait « non seulement d’un geste de partage », mais « bien plus encore ; c’est la dernière tentative de l’amour pour ne pas abandonner ».
Judas, cependant, rejette l’offre du Christ.
« Ce passage nous frappe », dit Léon, « comme si le mal, jusque-là caché, se manifestait après que l’amour eut montré son visage le plus sans défense. »
« C’est précisément pour cela », dit Léon, « que cette bouchée est notre salut : parce qu’elle nous dit que Dieu fait tout – absolument tout – pour nous atteindre, même à l’heure où nous le rejetons. »
« C'est ici que le pardon révèle toute sa puissance et révèle le véritable visage de l'espoir. Ce n'est ni un oubli, ni une faiblesse », a déclaré Léon XIV. « L'amour de Jésus ne nie pas la vérité de la douleur », a-t-il ajouté, « mais il ne laisse pas le mal avoir le dernier mot. »
La paix et le pardon – dons gratuits du Christ – qui ne permettent pas au mal d’avoir le dernier mot, sont des thèmes que Léon a abordés pour la première fois depuis la loggia au-dessus de la basilique Saint-Pierre, le soir de son élection.
« La paix soit avec vous tous ! » furent les tout premiers mots de Léon XIV aux fidèles.
« Dieu nous aime », a également déclaré Léon ce soir-là, « Dieu vous aime tous, et le mal ne prévaudra pas ! »
Léon XIV est revenu à plusieurs reprises sur ces deux thèmes – la paix et le pardon – au cours de ses premiers mois de mandat, et ils deviennent rapidement un leitmotiv de son pontificat encore très jeune.
Dans un message adressé au sommet AI For Good en juin, le pape a explicitement invoqué la célèbre description de la paix comme « la tranquillité de l’ordre » formulée pour la première fois par saint Augustin d’Hippone, le père spirituel de l’homme qui est devenu Léon XIV.
Dans son discours au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, le 17 mai, Léon XIV a déclaré que la paix « se construit dans le cœur et à partir du cœur, en éliminant l’orgueil et la vindicte et en choisissant soigneusement nos mots ».
Le « cœur » est un autre thème typiquement augustinien.
Pour saint Augustin, le cœur n’est pas seulement, ni même principalement, un organe ayant une fonction et un but physiologiques, mais le siège de notre désir le plus intime.
Cor en latin, le cœur est l'endroit où nous trouvons Dieu qui nous attend.
Il convient peut-être de mentionner ici que Cor ad cor loquitur – « Le cœur parle au cœur » – est la devise de saint John Henry Newman, le grand prêtre oratorien anglais converti au catholicisme du XIXe siècle, que Léon XIII créa cardinal en 1879.
Newman a été canonisé en 2019, après avoir été béatifié en 2010, et le dernier jour de juillet, Léon XIV a annoncé son intention de déclarer saint John Heny Newman docteur de l'Église.
Parmi la multitude d'articles parus ce week-end dernier pour marquer les 100 premiers jours de Léon XIV au pouvoir - reportages, rétrospectives, analyses, commentaires - la chaîne locale NBC 5Chicago a accordé une interview exclusive au frère de Léon, John, dans laquelle l'aîné Prevost (John est le deuxième, Louis Jr. est l'aîné et Robert - désormais Léon XIV - est le plus jeune) a qualifié son frère de « pape du peuple ».
Même si l'on peut dire à juste titre que le point de vue de John Prevost est partial, les fidèles – en particulier les jeunes – ont bien réagi à Léon, qui a attiré un million de personnes à une messe jubilaire pour les jeunes le 3 août.
Là aussi, Léon a parlé de l’importance vitale de cultiver des cœurs sincères.
« Nous ne sommes pas faits pour une vie où tout est acquis et statique », a déclaré Léon aux jeunes réunis pour la messe au parc Tor Vergata de Rome, « mais pour une existence constamment renouvelée par le don de soi dans l'amour. »
« C'est pourquoi nous aspirons continuellement à quelque chose de « plus » qu'aucune réalité créée ne peut nous donner », a déclaré Léon, « nous ressentons une soif profonde et brûlante qu'aucune boisson dans ce monde ne peut satisfaire. »
« Sachant cela, dit Léo, ne trompons pas nos cœurs en essayant de les satisfaire avec des imitations bon marché ! »
Les observateurs du Vatican attendent que Léon XIV prenne les grandes décisions et les décisions difficiles qui doivent arriver, mais peut-être que Léon a déjà plus que commencé à dévoiler son programme : il a l’intention d’être un pape du cœur.