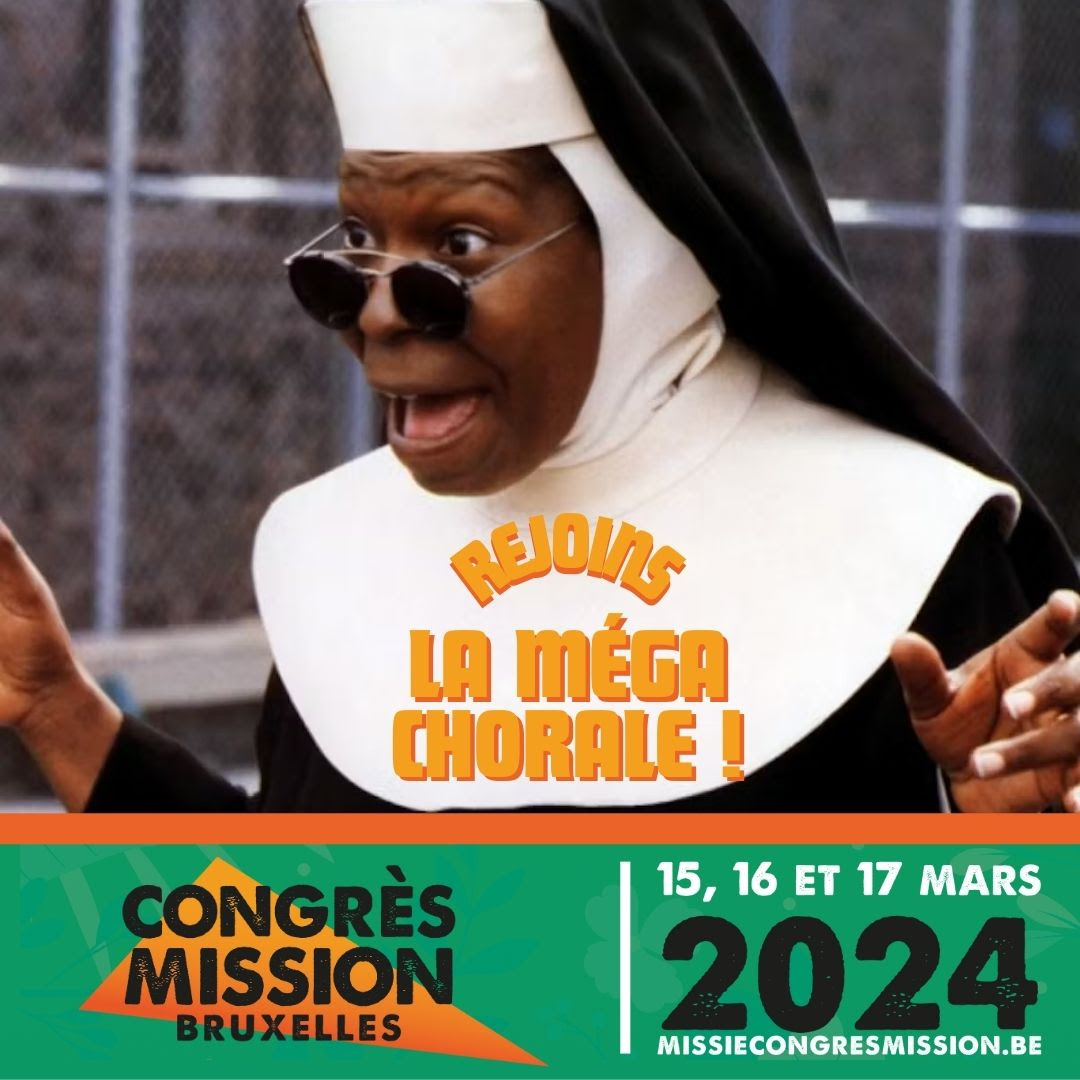Du blogue d'Edward Pentin :
" Fiducia Supplicans " n'appartient pas au magistère authentique; le Père Bux appelle le cardinal Fernández à démissionner.
25 janvier 2024
Un ancien consulteur du Dicastère pour la Doctrine de la Foi a déclaré qu'il croyait que parce que Fiducia Supplicans "n'appartient pas au Magistère authentique", elle n'est pas contraignante et donc "on ne peut même pas y adhérer avec l'assentiment religieux de la volonté et de l'intellect".
Il a également demandé la démission ou le renvoi de son auteur principal, le cardinal Víctor Manuel Fernández, car "le soupçon d'ignorance et de mauvaise foi pèsera sur [lui] dans tout document qu'il signera par la suite".
Dans une interview accordée à ce site le 18 janvier, le père Nicola Bux, théologien respecté et ami du défunt pape Benoît XVI, a évoqué les retombées de la publication de la déclaration qui autorise les bénédictions entre personnes de même sexe sous certaines conditions.
Fiducia Supplicans, approuvée par le pape François, a été signée par le cardinal Fernández, préfet du dicastère de la doctrine de la foi, et le secrétaire du dicastère, Mgr Armando Matteo, et publiée le 18 décembre.
Le père Bux explique comment le document a été reçu en Italie, ce qu'il a pensé du communiqué de presse du 4 janvier visant à clarifier la déclaration, et ce que tout cela pourrait signifier pour l'avenir de l'Église et le prochain conclave.
"Le drame de l'Église aujourd'hui est la séparation de la pastorale et de la doctrine, c'est-à-dire de l'amour et de la vérité", déclare le père Bux. "Et nous le payons cher, comme l'avait prédit Jean-Paul II.
Le pape François devrait annuler Fiducia Supplicans et remplacer le préfet par un homme à la "doctrine sûre, solide et pure", pour reprendre les mots de l'apôtre à Tite.
Père Bux, quelle a été la réaction générale à la Fiducia Supplicans en Italie - plutôt contraire, à votre avis, favorable ou ambivalente ?
En raison de leur proximité avec le Siège apostolique, les évêques italiens semblent être comme des chiens muets : ils approuvent ou ils s'opposent, ou ils craignent les "représailles". Parmi les fidèles et les non-pratiquants, il y a ceux qui considèrent Fiducia Supplicans, et les tentatives de la justifier, comme une insulte à leur intelligence. Et puis il y a ceux qui connaissent la doctrine de la foi et de la morale, en particulier les normes de la Révélation, et qui posent le premier dubium [doute ou question] aux cinq cardinaux envoyés l'été dernier : L'Église peut-elle aujourd'hui enseigner des doctrines contraires à celles qu'elle a déjà enseignées en matière de foi et de morale, que ce soit par le pape ex cathedra, par les définitions d'un concile œcuménique ou par le magistère ordinaire universel des évêques dispersés dans le monde entier (cf. Lumen Gentium 25) ?
Il est certain que Fiducia Supplicans n'appartient pas au "Magistère authentique" et n'est donc pas contraignant parce que ce qui y est affirmé n'est pas contenu dans la parole écrite ou transmise de Dieu et que l'Église, le Pontife romain ou le Collège des évêques, soit définitivement, c'est-à-dire par un jugement solennel, soit avec le Magistère ordinaire et universel, propose de croire comme divinement révélée. On ne peut même pas y adhérer par un assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence.
Que pensez-vous du communiqué de presse du 4 janvier visant à clarifier la déclaration ? A-t-il résolu quoi que ce soit ?
L'ignorance prédomine dans la majorité des baptisés, du fait que pendant des décennies, les questions sociales ont été préférées à la catéchèse ; pour les couples hétérosexuels et homosexuels en situation irrégulière, ce qui s'applique aujourd'hui est : l'amour est l'amour. Ceux qui utilisent la logique s'y opposent et c'est alors que surgit le deuxième dubium des cardinaux : Est-il possible que, dans certaines circonstances, un pasteur puisse bénir des unions entre personnes homosexuelles, suggérant ainsi que le comportement homosexuel en tant que tel ne serait pas contraire à la loi de Dieu et au chemin de la personne vers Dieu ? À ce dubium s'en ajoute un autre : L'enseignement soutenu par le magistère ordinaire universel reste-t-il valable, à savoir que tout acte sexuel en dehors du mariage, et en particulier les actes homosexuels, constitue un péché objectivement grave contre la loi de Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il a lieu et l'intention avec laquelle il est accompli ? La déclaration du 4 janvier est donc une tentative classique de masquer les fissures.
Êtes-vous d'accord avec le fait que la déclaration a mis en évidence des divisions qui étaient déjà présentes mais qui sont maintenant étalées au grand jour ?
Benoît XVI, dans ses Notes du 11 avril 2019, a décrit l'origine de la débâcle de la morale catholique, et donc aussi des divisions entre catholiques, du fait de considérer que la cohabitation d'un couple hétérosexuel et d'un couple homosexuel n'est pas un péché. La division ou le schisme, auparavant submergé, a maintenant émergé. Nous verrons si elle sera officiellement déclarée lors d'un prochain événement ecclésial, tel qu'un synode ou un conclave. Il est certain que le prochain pape devra faire les comptes et décider s'il faut approfondir la division ou la réparer en convoquant un concile. Quel que soit le candidat au poste de pape, il devra être invité, lors des congrégations pré-conclaves, à répondre aux dubia accumulés depuis 2015, faute de quoi la division de l'Église s'aggravera.
Pourquoi pensez-vous qu'il y a eu une opposition principalement en Afrique, en Europe centrale et orientale et pas tellement aux États-Unis et dans d'autres pays principalement occidentaux ?
Car dans ces régions, c'est-à-dire dans l'hémisphère nord et occidental, après Vatican II, l'Église a été confrontée à l'idéologie relativiste qui avait pénétré la morale et démoli la loi naturelle, la formation à la doctrine et la vie dans le Christ - c'est-à-dire la morale catholique, en lutte contre la pensée néo-païenne. Demandez ensuite à un juif s'il s'agit d'une bénédiction (berakah) lorsqu'elle n'a pas de caractère sacré (disons qu'elle n'est pas liturgique) et si l'on peut bénir quelque chose que Dieu maudit et abhorre, comme un péché contre la nature. Un ami juif qui a entendu parler de Fiducia Supplicans m'a dit : "Le pape ne connaît-il pas la Bible ? Sans parler de la ridiculisation des musulmans et de l'éloignement des orthodoxes qui déclarent désormais impossible l'unité avec les catholiques. Fiducia Supplicans et les communiqués qui ont suivi sont le résultat de l'ignorance du préfet Fernandez.
Quelle est la meilleure façon de résoudre la confusion et la division résultant de Fiducia Supplicans ?
Expliquez qu'il n'y a rien de pastoral sans "pasto" (repas) car "la doctrine est en fait comme la nourriture, dont le possesseur est celui qui la distribue" (St. Grégoire Nazianze). La doctrine est donc pastorale, mais si le berger ne l'a pas, il ne peut pas faire de pastorale. Le drame de l'Église aujourd'hui est la séparation de la pastorale et de la doctrine, c'est-à-dire de l'amour et de la vérité. Et nous le payons cher, comme l'avait prédit Jean-Paul II. Le pape François devrait annuler Fiducia Supplicans et remplacer le préfet par un homme à la "doctrine sûre, solide et pure", pour reprendre les mots de l'apôtre à Tite.
Comment pensez-vous que cette affaire affectera le prochain Conclave ?
Il est certain que le prochain pape, s'il ne veut pas l'être seulement pour une partie de l'Eglise, devra se poser la question : quelle est la mission de l'Eglise ? Se conformer au monde ou le sauver ? L'unité de l'Église catholique est compromise par Fiducia Supplicans parce que, sur une vérité morale aussi essentielle, elle accepte, dans la pratique, des points de vue opposés entre les Églises dispersées dans le monde. Un exemple : Le nouvel évêque de Foggia a déclaré que son église serait "l'église de François qui bénit tout le monde". Mais l'Église n'est-elle pas celle de Jésus-Christ ?
Fernandez s'est discrédité en publiant un document à l'opposé de celui de son prédécesseur, [le cardinal Luis] Ladaria, en 2021. S'agirait-il d'un "développement" ou plutôt d'une hétérogénéité de la doctrine ? Le dicastère et le Saint-Siège se sont humiliés. Quelqu'un a déjà rebaptisé le Dicastère "pour la destruction de la foi". Le soupçon d'ignorance et de mauvaise foi pèsera sur Fernandez dans tout document qu'il signera ultérieurement. Il devrait démissionner.