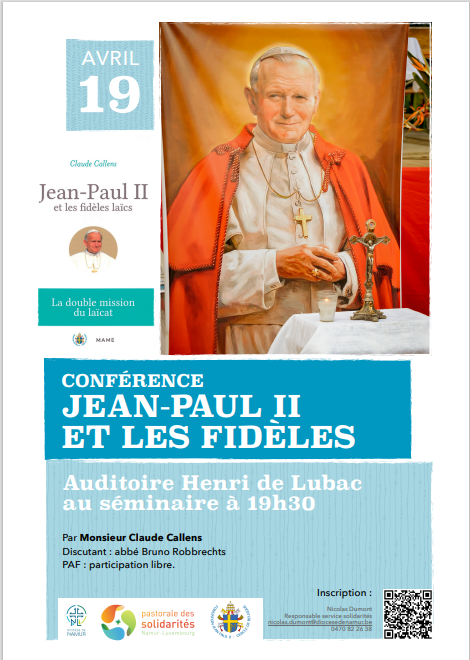DISCOURS DU SAINT-PÈRE FRANCOIS AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION RELIGIEUSE DES INSTITUTS SOCIO-SANITAIRES (ARIS)
Salle du Consistoire / Jeudi 13 avril 2023
Chers frères et sœurs, bonjour !
Je remercie le Président, le Père Virginio Bebber, pour ses paroles et je vous souhaite à tous la bienvenue. Je salue le Directeur du Bureau pour la pastorale de la santé de la Conférence épiscopale italienne.
Je suis heureux de rencontrer votre Association, qui s'occupe de la gestion de structures sanitaires d'inspiration chrétienne, comparables à l'auberge du Bon Samaritain (cf. Lc 10, 25-37), où les malades peuvent recevoir "l'huile de la consolation et le vin de l'espérance" [1]. J'exprime mon appréciation pour le bien qui a été fait dans tant d'instituts de santé en Italie, et je les encourage à continuer avec la persévérance et l'imagination de la charité, caractéristiques des nombreux fondateurs qui leur ont donné vie.
Les soins de santé religieux en Italie ont une belle histoire, vieille de plusieurs siècles. L'Église a beaucoup fait, à travers les soins de santé, pour écouter et prêter attention aux segments pauvres, faibles et abandonnés de la société. Dans ce domaine, il n'a pas manqué de témoins autorisés, capables de reconnaître et de servir le Christ malade et souffrant jusqu'au don total de soi, même au prix du sacrifice de leur vie. Nous pensons à saint Camillus de Lellis, à sainte Joséphine Vannini, à saint Joseph Moscati, à saint Augustin Pietrantoni et à bien d'autres encore. Reconnaissants pour le passé, nous nous sentons donc appelés à habiter le présent avec un engagement actif et un esprit prophétique. Dans le secteur de la santé, la culture du rebut peut, plus qu'ailleurs, montrer ses conséquences douloureuses, parfois de manière évidente. En effet, lorsque la personne malade n'est pas placée au centre et considérée dans sa dignité, cela engendre des attitudes qui peuvent aller jusqu'à la spéculation sur les malheurs des autres [2], ce qui doit nous rendre vigilants.
Demandons-nous en particulier : quelle est la tâche des institutions sanitaires d'inspiration chrétienne dans un contexte, comme celui de l'Italie, où il existe un service sanitaire national, universel par vocation, et donc appelé à soigner tout le monde ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de retrouver le charisme fondateur de l'assistance sanitaire catholique afin de l'appliquer dans cette nouvelle situation historique, tout en sachant qu'aujourd'hui, pour diverses raisons, il est de plus en plus difficile de maintenir les structures existantes. Nous devons entreprendre des chemins de discernement et faire des choix courageux, en nous rappelant que notre vocation est de nous tenir à la frontière du besoin. En tant qu'Église, nous sommes appelés à répondre avant tout aux demandes de santé des plus pauvres, des exclus et de ceux qui, pour des raisons économiques ou culturelles, voient leurs besoins ignorés. Ce sont les plus importants pour nous, ceux qui viennent en tête de la file d'attente.
Le retour de la "pauvreté sanitaire" prend des proportions importantes en Italie, surtout dans les régions marquées par des situations socio-économiques plus difficiles. Il y a des personnes qui, par manque de moyens, ne peuvent pas se faire soigner et pour qui même le paiement d'un ticket modérateur est un problème ; et il y a des personnes qui ont des difficultés à accéder aux services de santé à cause des très longues listes d'attente, même pour des visites urgentes et nécessaires ! Le besoin de soins intermédiaires s'accroît également, étant donné la tendance croissante des hôpitaux à laisser sortir les malades en peu de temps, en privilégiant le traitement des phases les plus aiguës de la maladie par rapport à celui des pathologies chroniques : par conséquent, ces dernières, en particulier pour les personnes âgées, deviennent un problème sérieux également d'un point de vue économique, avec le risque de favoriser des lignes d'action peu respectueuses de la dignité même de la personne. Une personne âgée doit prendre des médicaments et si, pour économiser de l'argent ou pour telle ou telle raison, on ne lui donne pas ces médicaments, il s'agit d'une euthanasie cachée et progressive. Nous devons le dire. Toute personne a droit aux médicaments. Et souvent - je pense à d'autres pays, en Italie je ne suis pas très au courant, dans d'autres pays je le suis - les personnes âgées doivent prendre quatre ou cinq médicaments et ne parviennent à en obtenir que deux : c'est une euthanasie progressive, parce qu'on ne leur donne pas ce dont elles ont besoin pour se guérir.
Les soins de santé d'inspiration chrétienne ont le devoir de défendre le droit aux soins, en particulier pour les groupes les plus faibles de la société, en donnant la priorité aux endroits où les gens souffrent le plus et sont le moins soignés, même si cela peut nécessiter la conversion de services existants en nouveaux services. Toute personne malade est par définition fragile, pauvre, en manque d'aide, et parfois les riches se retrouvent plus seuls et abandonnés que les pauvres. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les possibilités d'accès aux soins ne sont pas les mêmes pour ceux qui ont de l'argent et pour ceux qui sont plus pauvres. Alors, en pensant à tant de congrégations, nées à différentes périodes historiques avec des charismes courageux, demandons-nous : que feraient ces Fondateurs et Fondatrices aujourd'hui ?
Les hôpitaux religieux ont avant tout la mission de prendre soin de ceux qui sont rejetés par l'économie de la santé et par une certaine culture contemporaine. Telle a été la prophétie de tant d'institutions sanitaires d'inspiration chrétienne, à commencer par la naissance des hôpitaux eux-mêmes, créés précisément pour soigner ceux que personne ne voulait toucher. Que ce soit aussi votre témoignage aujourd'hui, soutenu par une gestion compétente et claire, capable de combiner recherche, innovation, dévouement aux plus petits et vision d'ensemble.
La réalité est complexe et vous ne pourrez y faire face de manière adéquate que si les institutions sanitaires d'inspiration religieuse ont le courage de se réunir et de travailler en réseau, en évitant tout esprit de concurrence, en unissant les compétences et les ressources et en créant peut-être de nouvelles entités juridiques, à travers lesquelles elles pourront aider en particulier les petites réalités. N'ayez pas peur d'emprunter de nouvelles voies - risque, risque -, afin d'éviter que nos hôpitaux, pour de simples raisons économiques, ne soient aliénés - c'est un danger et même un danger actuel : ici à Rome, je peux vous envoyer la liste -, anéantissant ainsi un patrimoine longtemps chéri et embelli par tant de sacrifices. C'est précisément pour atteindre ces deux objectifs urgents, et à la demande des institutions sanitaires d'inspiration catholique elles-mêmes, qu'est née en décembre 2015 la Commission pontificale pour les activités du secteur sanitaire des personnes morales publiques de l'Église, avec laquelle je vous invite à avoir une collaboration active et constructive.
Enfin, je voudrais vous recommander d'accompagner les personnes que vous accueillez dans vos institutions avec une attention intégrale, qui ne néglige pas l'assistance spirituelle et religieuse des malades, de leurs familles et des agents de santé. Là aussi, les établissements de santé d'inspiration chrétienne doivent être exemplaires. Et il ne s'agit pas seulement d'offrir une pastorale sacramentelle, mais d'accorder une attention totale à la personne. Personne, personne ne doit se sentir seul dans la maladie ! Au contraire, chacun doit être soutenu dans ses questions de sens et aidé à parcourir avec une espérance chrétienne le chemin parfois long et fatigant de l'infirmité.
Chers frères et sœurs, gardez vivant le charisme de vos fondateurs, non pas tant pour imiter leurs gestes, mais pour accueillir leur esprit, non pas tant pour défendre le passé, mais pour construire un présent et un avenir où annoncer, par votre présence, la proximité de Dieu avec les malades, surtout les plus défavorisés et marginalisés par la logique du profit. Que la Vierge vous accompagne. De tout cœur, je vous bénis et je bénis votre travail. Et je vous recommande de ne pas oublier de prier pour moi. Je vous remercie.
____________________________________________
[1] Missel romain, Préface commune VIII.
[2] Cf. Discours à la Commission épiscopale pour le service de la charité et de la santé de la CEI, 10 février 2017.