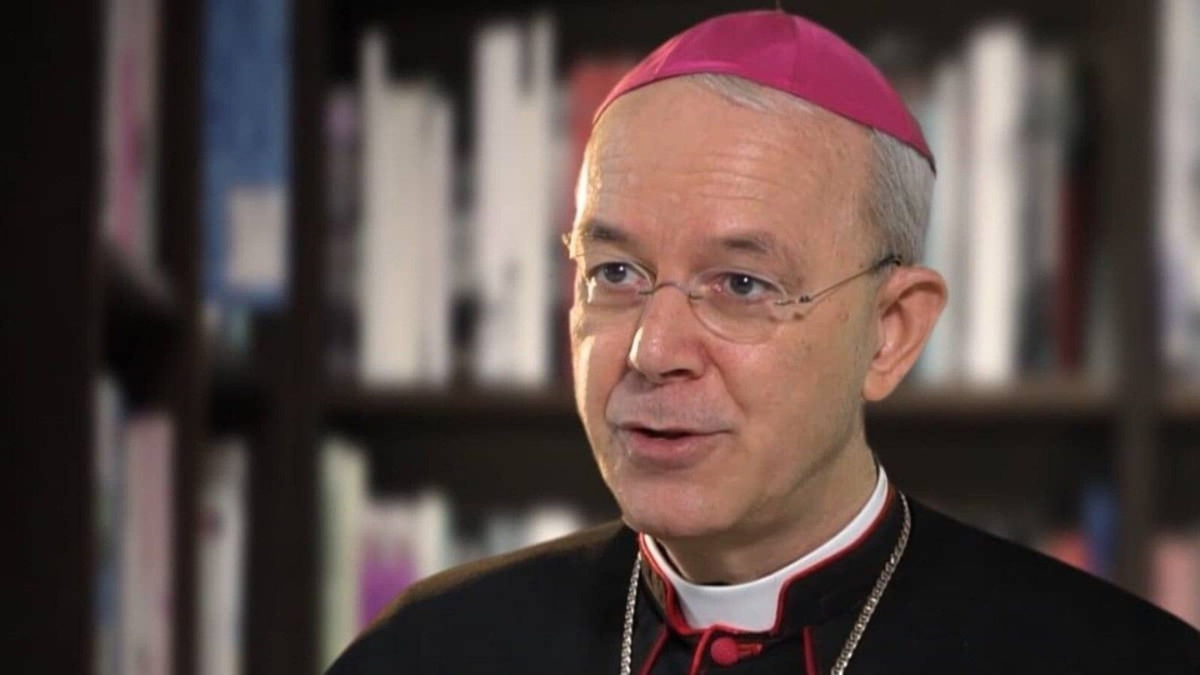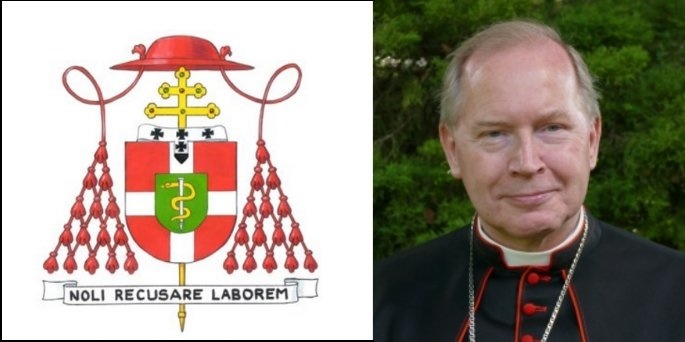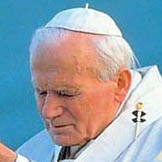Je vous remercie pour vos aimables paroles et pour l’invitation à venir ici, au Quirinal, un palais si étroitement lié à l’histoire de l’Église catholique et à la mémoire de nombreux papes.
En tant qu’Évêque de Rome et Primat d’Italie, il est important pour moi de renouveler, par cette visite, le lien fort qui unit le Siège de Pierre au peuple italien que vous représentez, dans le cadre des relations bilatérales cordiales qui existent entre l’Italie et le Saint-Siège, profondément marquées par une amitié sincère et une collaboration mutuelle efficace.
Il s'agit, après tout, d'une union heureuse, ancrée dans l'histoire de cette péninsule et dans la longue tradition religieuse et culturelle de ce pays. On en voit les signes, par exemple, dans les innombrables églises et clochers qui parsèment le paysage, souvent de véritables trésors d'art et de dévotion, où la créativité innée de ce peuple, alliée à sa foi authentique et solide, nous a laissé un témoignage d'une grande beauté : artistique, certes, mais surtout morale et humaine.
Je saisis l'occasion de notre rencontre pour exprimer la profonde gratitude du Saint-Siège pour ce que les autorités italiennes ont fait et continuent de faire à l'occasion de divers événements ecclésiaux difficiles, centrés sur Rome et de résonance universelle.
Je voudrais exprimer ma gratitude particulière pour les efforts déployés à différents niveaux après le décès de mon vénéré prédécesseur, le pape François. Ici même, au Quirinal, il déclarait : « Mes racines sont dans ce pays » ( Discours lors de la visite officielle au Président de la République italienne, 10 juin 2017), et son amour pour la terre et le peuple italiens a certainement trouvé ces jours-là un écho touchant et chaleureux, qui s'est également manifesté dans l'engagement profond et réfléchi qu'il a pris lors du conclave qui a suivi pour l'élection du nouveau pontife.
Je voudrais une fois de plus vous exprimer mes sincères remerciements, Monsieur le Président, ainsi qu'à tout le pays, pour le bel exemple d'hospitalité et d'organisation efficace que l'Italie offre depuis des mois durant l'Année jubilaire, sous divers aspects – logistique, sécurité, préparation et gestion des infrastructures et des services, et bien plus encore –, ouvrant les bras et montrant son visage hospitalier aux nombreux pèlerins qui affluent du monde entier. L'Église universelle célèbre le Jubilé de l'espérance. Le pape François , dans la bulle Spes non confindit , par laquelle il l'a annoncé en mai 2024, a souligné l'importance de « prêter attention au grand bien présent dans le monde afin de ne pas céder à la tentation de se croire submergé par le mal et la violence » (n. 7). Je pense que la belle synergie et collaboration que nous vivons ces jours-ci constitue déjà un signe d’espérance pour tous ceux qui viennent avec foi franchir la Porte Sainte et prier sur les tombeaux de Pierre et des Apôtres.
Dans quelques années, nous célébrerons le centenaire des Accords du Latran. À cet égard, il me paraît d'autant plus opportun de réaffirmer l'importance de la distinction mutuelle entre ces domaines. C'est pourquoi, dans un climat de respect cordial, l'Église catholique et l'État italien collaborent pour le bien commun, au service de la personne humaine, dont la dignité inviolable doit toujours primer dans les processus de décision et dans l'action, à tous les niveaux, pour le développement social, en particulier pour la protection des plus vulnérables et des plus démunis. À cette fin, je salue et encourage l'engagement mutuel à fonder toute collaboration sur le Concordat de 1984 et dans son plein respect.
Comme il est malheureusement évident, nous vivons une époque où, à côté de nombreux signes d’espoir, de nombreuses situations de grave souffrance affectent l’humanité dans le monde entier et nécessitent des réponses urgentes et clairvoyantes.
Le premier engagement que je voudrais rappeler à ce propos est celui en faveur de la paix. De nombreuses guerres ravagent notre planète, et en regardant les images, en lisant les nouvelles, en écoutant les voix, en rencontrant les personnes qui en sont douloureusement affectées, les paroles de mes prédécesseurs résonnent avec force et force. Comment oublier l'avertissement irréfutable, mais ignoré, de Benoît XV pendant la Première Guerre mondiale (cf. Lettre aux chefs des peuples belligérants, 1er août 1917) ? Et, à la veille de la Seconde, celui du vénérable Pie XII (cf. Message radiophonique aux gouvernements et aux peuples en danger imminent de guerre, 24 août 1939) ? Regardons les visages de ceux qui sont bouleversés par la férocité irrationnelle de ceux qui planifient sans pitié la mort et la destruction. Écoutons leur cri et rappelons-nous, avec saint Jean XXIII , que « tout être humain est une personne, c'est-à-dire une nature douée d'intelligence et de libre arbitre ; il est donc sujet de droits et de devoirs qui découlent immédiatement et simultanément de sa nature même : droits et devoirs qui sont donc universels, inviolables, inaliénables » (Lettre encyclique Pacem in terris , 11 avril 1963, n. 5). Je renouvelle donc mon appel pressant à continuer d'œuvrer pour le rétablissement de la paix dans toutes les parties du monde et à cultiver et promouvoir toujours davantage les principes de justice, d'équité et de coopération entre les peuples, qui en sont le fondement indispensable (cf. saint Paul VI, Message pour la célébration de la Première Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1968).
À cet égard, je tiens à exprimer ma gratitude au gouvernement italien pour son engagement à répondre aux nombreuses situations difficiles liées à la guerre et à la pauvreté, en particulier celles des enfants de Gaza, notamment en collaboration avec l'hôpital Bambino Gesù. Ces efforts constituent des contributions fortes et efficaces à la construction d'une coexistence digne, pacifique et prospère pour tous les membres de la famille humaine.
À cette fin, l'engagement commun que l'État italien et le Saint-Siège ont toujours manifesté et continuent de manifester en faveur du multilatéralisme est certainement bénéfique. Il s'agit d'une valeur très importante. Les défis complexes de notre époque rendent en effet plus que jamais nécessaires la recherche et l'adoption de solutions communes. Il est donc essentiel de mettre en œuvre ces dynamiques et ces processus, en rappelant leurs objectifs initiaux, visant principalement à résoudre les conflits et à favoriser le développement (cf. François , Lettre encyclique Fratelli tutti , 3 octobre 2020, 172), en favorisant un langage transparent et en évitant les ambiguïtés susceptibles de provoquer des divisions (cf. Ibid., Discours aux membres du Corps diplomatique , 9 janvier 2025).
Nous nous apprêtons à célébrer, l'année prochaine, un anniversaire important : le huitième centenaire de la mort de saint François d'Assise, saint patron de l'Italie, le 3 octobre 1226. Cet événement nous offre l'occasion de souligner l'urgence de prendre soin de notre « maison commune ». Saint François nous a appris à louer le Créateur dans le respect de toutes les créatures, lançant son message du « cœur géographique » de la Péninsule et le transmettant de génération en génération jusqu'à nous, à travers la beauté de ses écrits et le témoignage de lui-même et de ses frères. C'est pourquoi je crois que l'Italie a reçu de manière particulière la mission de transmettre à ses peuples une culture qui reconnaît la terre « comme une sœur avec laquelle nous partageons notre existence, et comme une belle mère qui nous accueille dans ses bras » ( François , Lettre encyclique Laudato Si' , 1).
Ces dernières décennies, comme nous le savons, l'Europe a connu une baisse significative de la natalité. Cela exige un engagement à promouvoir des choix favorables aux familles à différents niveaux, en soutenant leurs efforts, en promouvant leurs valeurs et en protégeant leurs besoins et leurs droits. « Père », « mère », « fils », « fille », « grand-père » et « grand-mère » sont, dans la tradition italienne, des mots qui expriment et évoquent naturellement des sentiments d'amour, de respect et de dévouement, parfois héroïque, pour le bien de la communauté familiale et, par conséquent, pour celui de la société dans son ensemble. Je voudrais en particulier souligner l'importance d'assurer à toutes les familles le soutien essentiel d'un emploi digne, dans des conditions équitables et en tenant compte des besoins de la maternité et de la paternité. Faisons tout notre possible pour redonner confiance aux familles, en particulier aux jeunes familles, afin qu'elles puissent envisager l'avenir avec sérénité et grandir en harmonie.
Dans ce contexte, nous voyons l'importance fondamentale, à tous les niveaux, de respecter et de protéger la vie, à toutes ses étapes, de la conception à la vieillesse, jusqu'au moment de la mort (cf. François, Discours à l'Assemblée plénière de l'Académie pontificale pour la Vie, 27 septembre 2021). Je souhaite que cette conscience continue de croître, également en ce qui concerne l'accessibilité des soins médicaux et des médicaments, selon les besoins de chacun.
Je remercie ce pays pour l'aide généreuse qu'il offre aux migrants, de plus en plus nombreux à frapper à sa porte, ainsi que pour son engagement dans la lutte contre la traite des êtres humains. Ce sont des défis complexes de notre époque, auxquels l'Italie n'a jamais renoncé. Je vous encourage à toujours maintenir une attitude dynamique d'ouverture et de solidarité. Je tiens également à souligner l'importance d'intégrer de manière constructive les nouveaux arrivants aux valeurs et aux traditions de la société italienne, afin que le don mutuel qui naît de cette rencontre entre les peuples soit véritablement enrichissant et bénéfique pour tous. À cet égard, je souligne combien il est précieux pour chacun d'entre nous d'aimer et de transmettre sa propre histoire et sa propre culture, avec ses signes et ses expressions : plus nous nous reconnaissons et nous aimons sereinement, plus il est facile de rencontrer et d'intégrer les autres, sans peur et avec un cœur ouvert.
À cet égard, on observe aujourd'hui une certaine tendance à sous-estimer, à divers niveaux, les modèles et les valeurs qui se sont développés au fil des siècles et qui façonnent notre identité culturelle, tentant parfois même d'en effacer la pertinence historique et humaine. Ne dédaignons pas ce que nos ancêtres ont vécu et ce qu'ils nous ont transmis, même au prix de grands sacrifices. Ne nous laissons pas séduire par des modèles massifiants et fluides, qui ne favorisent qu'un semblant de liberté, mais qui rendent les personnes dépendantes de formes de contrôle telles que les modes passagères, les stratégies commerciales ou autres (voir Cardinal Joseph Ratzinger, Homélie lors de la messe d'élection du Pontife romain, 18 avril 2005). Préserver la mémoire de ceux qui nous ont précédés, préserver les traditions qui ont fait de nous ce que nous sommes, est important pour envisager le présent et l'avenir avec conscience, sérénité, responsabilité et perspective.
Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais vous adresser mes vœux les plus chaleureux de réussite, à vous et, à travers vous, à tout le peuple italien. L'Italie est un pays d'une immense richesse, souvent humble et cachée, qui a donc parfois besoin d'être découverte et redécouverte. C'est dans cette merveilleuse aventure que j'encourage tous les Italiens à se lancer, à y puiser de l'espoir et à affronter avec confiance les défis présents et futurs. Merci.