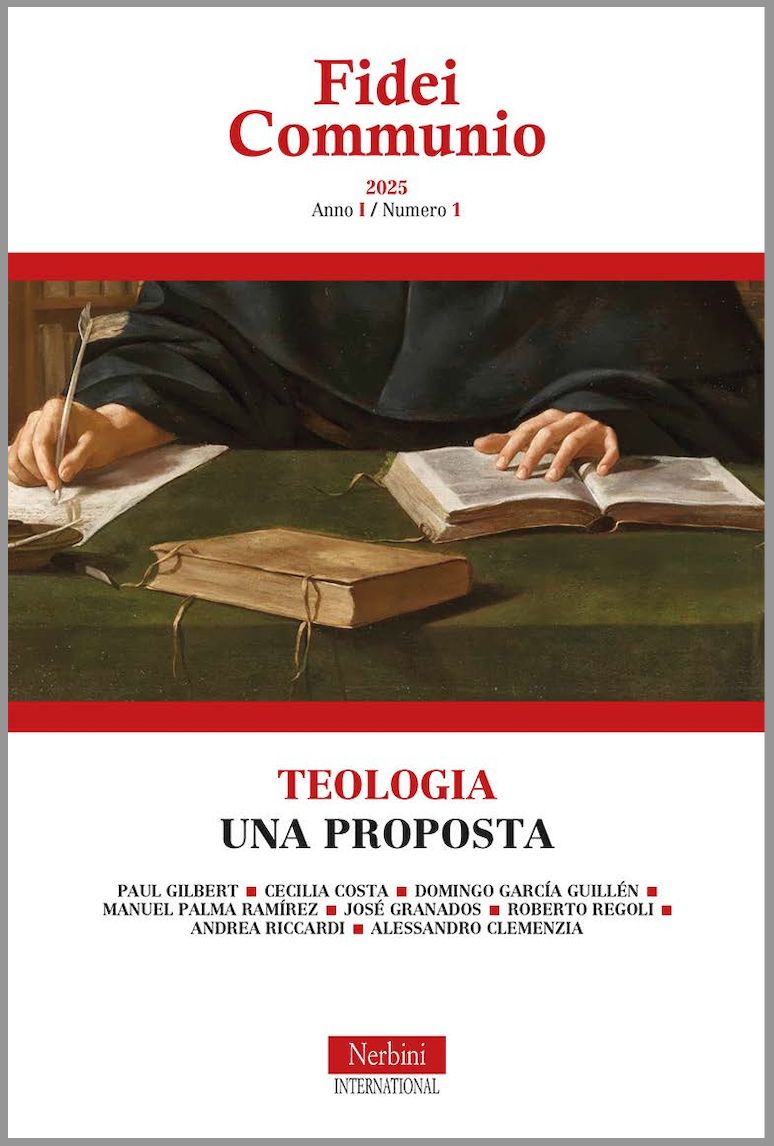D'Andrea Gagliarducci sur Monday Vatican :
Léon XIV : l'art d'écouter
26 janvier 2026
Avant le conclave qui a élu Robert Francis Cardinal Prevost OSA pour succéder au pape François sur le siège de Pierre, le légendaire journaliste spécialisé dans les affaires du Vatican John L. Allen Jr. – décédé la semaine dernière à l'âge de 61 ans – décrivait l'homme que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de pape Léon XIV comme un excellent auditeur qui savait habilement garder ses opinions pour lui.
Le pontificat encore très jeune de Léon XIV met en effet en évidence le rôle central de l'écoute en tant que valeur fondamentale du leadership.
Plutôt que de mettre en œuvre des changements radicaux dès son arrivée, Léon XIV adopte une approche mesurée face au paysage complexe du Vatican, apportant des réformes subtiles qui reflètent une préférence pour la compréhension et la patience plutôt que pour une transformation brutale.
L'approche du pape concernant les nominations clés de son nouveau pontificat montre une certaine continuité. Bien que ces décisions soient attendues avec impatience, elles ont été prises avec parcimonie et sans fanfare. La dernière nomination notable remonte au 22 janvier : l'archevêque Roberto Maria Redaelli de Gorizia est devenu secrétaire du Dicastère pour le clergé.
Âgé de 70 ans, Mgr Redaelli était président de Caritas Italia depuis 2019, ce qui laisse penser qu'il était connu – et recommandé au pape – par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet du Dicastère pour l'évangélisation. En réalité, le pape le connaissait peut-être aussi en tant que membre de la commission Delicta Riservata.
Redaelli est avant tout un canoniste, et c'est une caractéristique qui semble dominer les choix de Léon XIV.
Son profil est similaire à celui de Filippo Iannone, que Léon a nommé à la tête du Dicastère pour les évêques, et à celui du nouvel assesseur de la Secrétairerie d'État, Mgr Anthony Ekpo, surtout connu pour son livre sur la réforme de la Curie.
Cela soulève une question clé : comment le style de leadership de Léon XIV, fondé sur l'écoute, s'est-il manifesté dans la pratique ?
Tout d'abord, Léon XIV a démontré qu'il avait saisi l'essence même de certains des problèmes les plus urgents auxquels Rome est confrontée, et qu'il avait déjà une compréhension approfondie des questions fondamentales lorsqu'il est entré en fonction.
À son arrivée à la Curie romaine en 2023, Prevost a immédiatement dû s'occuper de la réforme de la Curie souhaitée par le pape François et des ajustements nécessaires. Souvent, dans les discussions entre prélats de haut rang, il était précisément fait référence à un manque d'organisation, à la nécessité d'harmoniser la réforme avec le droit canonique et à la nécessité d'une restructuration.
Leo XIV a jusqu'à présent choisi des canonistes aux connaissances éprouvées et a généralement – voire scrupuleusement – évité les personnalités en quête de notoriété dans ses choix pour les postes clés. Il a écouté, identifié les problèmes et cherché des solutions sans faire de bruit.
Les décisions du pape ne laissent transparaître que très peu d'idéologie.
La nomination de Redaelli s'est accompagnée des plaintes habituelles des partisans de la messe selon ce que nous appelions autrefois l'usus antiquior, qui s'empressent de souligner que Redaelli n'avait pas soutenu la libéralisation du rite. Mais cette question n'a pas été déterminante dans le choix du pape. La compétence personnelle et même l'estime générale ont été les critères centraux de cette nomination.
Le pape François a souvent encouragé l'attention aux périphéries, allant même jusqu'à démanteler la tradition pour apporter de nouvelles perspectives au centre.
Léon XVI, par nature, n'est pas un personnaliste, et ses premiers choix non seulement correspondent à son caractère et à son tempérament institutionnalistes, mais sont également marqués par son souci de maintenir un lien constant avec la tradition, y compris la tradition des symboles.
La tradition est mémoire et héritage, et Léon XIV a immédiatement compris qu'au moins au Vatican, elle est cruciale.
Pour sélectionner les responsables des dicastères, Léon XIV préfère les candidats issus d'Églises historiques, comme les récentes nominations italiennes : des canonistes élevés dans des traditions établies, indépendamment de leur idéologie.
En fait, élargissant son raisonnement, Léon XIV a également choisi un Italien comme nonce en Israël et délégué apostolique en Palestine, appelant l'archevêque Giorgio Lingua pour succéder à l'archevêque Tito Yllana.
Faire de l'origine géographique un enjeu n'est pas une attitude provincialiste.
Le pape ne réitalianise pas la Curie, il la réinstitutionalise ; c'est pourquoi les récentes nominations tendent à favoriser les Églises ayant des traditions historiques plus profondes et des liens plus forts avec le centre.
Cela signifie-t-il que le pape détourne son attention des périphéries pour la porter sur le centre ?
Pas nécessairement.
Cet équilibre entre le centre et la périphérie confirme encore davantage l'intuition de John Allen : Léon XIV dirige en écoutant et en s'abstenant de tout parti pris personnel, en se concentrant sur le discernement collectif. Ce que Léon XIV a accompli jusqu'à présent, c'est un rééquilibrage général de la Curie. Il n'y a eu qu'une seule purge, qui a concerné le Dicastère pour le clergé, où l'ancien secrétaire, André Gabriel Ferrada Moreira, a été envoyé comme évêque-archevêque de San Bartolomé Chillán, un diocèse de peu d'importance au Chili.
La plupart des autres hauts fonctionnaires restent en place, à l'exception de quelques changements au Secrétariat d'État, concernant principalement le licenciement de l'assesseur.
Dans l'ensemble, ces mesures reflètent une stratégie prudente. Jusqu'à présent, nous n'avons pas une idée claire de ce que le pape a l'intention de faire. Nous avons vu deux profils spécifiques choisis par le pape pour des postes à responsabilité : soit ce sont des canonistes experts (Redaelli a 70 ans, comme Iannone), soit ce sont des personnes en qui le pape a confiance, appelées non pas à des postes de haut niveau, mais à être proches du pape (c'est le cas du vice-régent de la Maison pontificale, l'augustinien Edward Daniang Daleng).
Léon XIV a choisi le nouvel archevêque de Westminster, Richard Moth, parmi un groupe de candidats conservateurs, et le nouvel archevêque de New York, Ronald Hicks, parmi ceux considérés comme des médiateurs.
Dans la nomination des évêques, le pape semble donc également privilégier l'écoute des Églises locales, en sélectionnant des candidats capables de servir de ponts et de surmonter la « guerre civile » qui a commencé dans l'Église avec Vatican II.
C'est un pape de la nouvelle génération qui abordera de manière pragmatique de nombreuses divisions et se tournera vers l'expérience et la tradition lorsque les situations deviendront complexes, mais son pragmatisme est au service de l'Église en tant que réalité institutionnelle avec ses propres traditions, qui sont négligées ou rejetées à ses risques et périls.
C'est du moins ce que nous indiquent les choix qu'il a faits au début de son pontificat.
Aujourd'hui, après une période d'écoute et de rééquilibrage, des actions majeures semblent imminentes. Léon XIV a récemment rencontré les chefs des dicastères, alimentant les spéculations sur les nominations à venir alors que son pontificat commence véritablement.
Nous verrons bien.